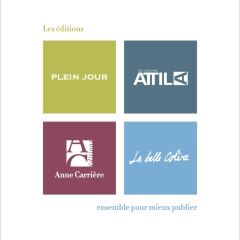REVUE DE PRESSE
France Inter, 8 février 2015
Les crimes de Mary Bell
par Colombe Schneck
Chronique finale de l'émission "Les femmes, toute une histoire", à écouter ici à partir de 51 min. 20 s.
Elle, 19 décembre 2014
Palmarès 2014
Les huit livres de l'année, selon les journalistes de Elle. Nathalie Dupuis a choisi Une si jolie petite fille :
1968, Newcastle, Mary Bell, onze ans, a tué de sang-froid deux garçons de trois et quatre ans. Gitta Sereny a suivi son procès, rencontré les témoins et confessé la meurtrière à sa sortie de prison. Une plongée vertigineuse sur les origines du mal, jusqu'à la découverte d'un terrible secret familial.
Ouest France, 7 décembre 2014
Mary Bell, comment peut-on tuer à onze ans ?
par Florence Pitard
Mary Bell a tué. Deux petits garçons de trois et quatre ans, elle qui était âgée de onze ans seulement. L'horreur brute des faits, qui se sont déroulés à Newcastle, en Angleterre, en 1968, n'incite pas forcément à se plonger dans son histoire...
Pourtant, il faut absolument lire Une si jolie petite fille (...). Le livre est écrit par Gitta Sereny, journaliste talentueuse et engagée qui n'a qu'un but : comprendre comment, si jeune, un être a pu commettre le mal absolu. Un effort que la justice britannique n'a jamais tenté de faire. Gitta Sereny, qui suit le procès en 1968, est traumatisée par ces débats publics où l'on se contente de décrire la fillette comme cruelle, vicieuse, perverse. (...)
L'histoire la hante. Vingt-cinq ans plus tard, elle retrouve Mary Bell, (...) la convainc de lui accorder de longs entretiens. Elle enquête auprès de sa famille, de ceux qui ont encadré son parcours carcéral.
Le résultat est saisissant. (...) Mary Bell a dû, seule, effectuer un travail sur elle-même pour comprendre l'horreur de ses crimes. (...) Gitta Sereny l'aide à cheminer, jusqu'à ce qu'elle avoue le terrible secret qui est sans doute la clé de l'histoire. Un livre bouleversant, dans lequel Gitta Sereny répond parfaitement à la question centrale du livre : croyons-nous à la rédemption ?
Le Parisien Magazine, 5 décembre 2014
Ceci n'est pas un roman
par Isabelle Spaak
En 1968, à Newcastle, en Angleterre, le petit Martin Brown, 4 ans, est retrouvé mort dans une maison en ruine Neuf semaines plus tard, Brian Howe, 3 ans, gît sans vie sur un chantier. Reconnue coupable des deux meurtres, la petite Mary Bell, 11 ans, est jugée comme une adulte. « Psychopathe, vicieuse, cruelle, terrifiante », assène le procureur. (...) Journaliste et écrivain, Gitta Sereny (1921-2012), émue par le sort de l'enfant, lui consacre un premier livre juste apres son procès. Mary sort de prison en 1980 et devient mère en 1984. Trente ans apres les faits, elle rencontre Gitta Sereny. Ensemble, les deux femmes remontent le fil du temps pour tenter de comprendre. Un récit d'une force inouïe sur le pardon, la déshérence affective d'une fillette manipulée par sa mère et la rédemption impossible.
À l'ombre du polar, 3 décembre 2014
(...) Le projet de Sereny est énorme. En écoutant Mary Bell adulte, elle tente certes de cerner les raisons de son acte : « Comment un enfant peut-il agir d’une manière qui lui sera proprement inconcevable une fois adulte ? Y a-t-il dans l’esprit humain, les nerfs, le cœur, quelque chose qui possède le pouvoir de détruire ou de paralyser, puis de recréer ou rétablir, la moralité et la bonté ? J’ai eu et j’ai toujours l’espoir de trouver des réponses à ces questions, aussi monumentales soient-elles, grâce à l’examen minutieux de la vie d’une enfant en particulier », introduit Sereny. Elle ne cherche pas seulement à expliquer, encore moins à justifier, mais à approcher la vérité de la personne en question, en s’armant d’un « détachement » indispensable. Elle ne verse pas dans une empathie suspecte, et comme elle le précise : « Au cours des sept mois d’entretiens et, au total, deux années qu’aura duré l’élaboration de ce livre, pas un seul jour n’a passé sans que je pense aux familles des deux petits garçons ». (...)
Au service de ce projet multiforme, Sereny réussit un livre à la construction redoutablement efficace. D’abord les faits et un procès sidérant, où jamais n’est analysé le contexte familial des deux accusées, à peine effleurée leurs personnalités, et quasiment pas interrogée la notion de bien et de mal pour des filles de 11 et 13 ans grandies dans des conditions plus que traumatiques. Les faits même n’en sortent pas parfaitement élucidés, et Mary devient « le monstre », dangereuse et donc condamnée à la réclusion à vie. La deuxième partie du livre est le long récit de son incarcération, de 1969 à 1973 dans une section spéciale sécurisée d’un établissement d’éducation surveillée (où elle est la seule fille), puis entre 16 et 20 ans (1973-1977) dans une prison pour femme, et enfin, de 1977 à 1980, dans une prison « ouverte » avant sa libération conditionnelle à 23 ans en 1980. Pendant toute cette période, la question de son état psychique, de sa façon de « composer » avec ses actes, n’est quasiment pas abordée. (...)
Dans un dernier volet enfin, Sereny aborde la sortie, la reconstruction chaotique, le jeu du chat et de la souris avec des médias qui piste ses nouvelles identités, le travail délicat des agents de probation, la maternité improbable et pourtant… Et c’est là, concentré sur quelques pages vertigineuses et dérangeantes que l’enfance de Mary ressurgit, foudroyant le lecteur. Les souvenirs remontent, par bribes, intolérables. Jusqu’au « point de rupture », les deux passages à l’acte, la « ouate noire » de l’instant des meurtres, confessés au présent glaçant. On sort totalement bousculé du livre de Gitta Sereny. Qui ne lâche pas le morceau, jusqu’au bout, jusqu’à sa dernière interrogation en conclusion assommante : « Croyons-nous en la rédemption ? ». En ces temps de confusion extrême autour de la violence et de l’insécurité, en sommes-nous encore capable ?
Les Enfants de la psychanalyse, 4 novembre 2014
par Brigitte Lannaud Levy
(...) En 1998, Gitta Sereny revient donc sur cette affaire avec un ouvrage que l’on peut considérer comme magistral, intitulé « Cries Unheard » et aujourd’hui traduit en français sous le titre de « Une si jolie petite fille » par les Éditions Plein Jour. Dans ce document tout à fait exceptionnel, la journaliste raconte ses échanges avec Mary Bell qui, libérée en 1980, sonde l’horreur de ses actes, ses sentiments les plus obscurs, son chaos intérieur et nous livre cette traversée inouïe de douze années de détention sans aucun suivi psychologique. (...)
La puissance singulière de ce texte réside dans l’approche de l’auteur relevant d’une profonde honnêteté intellectuelle et d’une éthique sans faille quant aux limites possibles de son travail. Ici, pas de sensationnalisme, mais de la rigueur et du respect à chaque page, à la fois pour les protagonistes de l’histoire et pour le lecteur qui n’est à aucun moment mis dans la situation malsaine d’un voyeur de fait divers sordide. (...)
Sur plus de 400 pages, nous suivons l’extraordinaire travail d’accompagnement du « re-souvenir » qu’effectue l’auteur aux côtés de Mary. Deux années de rencontres entre silence, non-dits et
révélations où Gitta Sereny explore, armée de sa « neutralité bienveillante », les coins les plus reculés de la mémoire de la jeune femme, les angles morts de sa psyché, broyée par une enfance
assassinée. Tel un sherpa de la mémoire, elle offre à Mary l’occasion unique de tenter de « tout dire », d’organiser ses pensées, trouver les mots pour exprimer l’indicible et essayer de comprendre
ce qui a pu la conduire enfant à commettre des meurtres aussi abominables. 30 ans plus tard, il lui est offert enfin de « rétablir les faits », non pas qu’elle ne soit pas coupable, mais découvrir ce
"qu’un tiers peut, consciemment ou inconsciemment introduire chez un enfant, qui le conduise à des actes profondément incompatibles avec la bonté intrinsèque de l’être humain ».
Le mal est le sujet d’étude de toute une vie pour la britannique Gitta Sereny. Née à Vienne en 1921 et décédée en 2012, elle a travaillé après la guerre de 40 auprès d’enfants dans les camps de
réfugiés d’Allemagne. Auteur d’une biographie remarquée du bourreau de Treblinka Franz Stangl ,elle a consacré toute sa carrière de journaliste d’investigation à comprendre l’origine du mal et
questionner nos sociétés pour trouver les moyens de le combattre ou explorer les chemins possibles de la rédemption. Les questions posées à chaque page de ce livre sont tout simplement vertigineuses
sur l’origine du mal et sur le mystère de l’innocence barbare des enfants meurtriers. Une telle enquête menée dans le temps avec une rigueur extrême au plus près d’une insondable vérité est tout
simplement exceptionnelle et constitue un document rare et précieux.
Le Journal du dimanche, 28 septembre 2014
Gitta Sereny. Crime et châtiment
par Marie-Laure Delorme
(...) Mary Bell est libérée, en 1980, à l'âge de 23 ans. Gitta Sereny la retrouve dix-huit ans après (la petite fille de 11 ans est devenue une mère de famille de 40 ans), pour tenter de restituer et d'éclairer sa trajectoire. (...) Elle écoute, durant des mois, son témoignage. Elle écrit à la suite des entretiens, en 1998, Une si jolie petite fille.
Gitta Sereny est aussi une historienne, auteur d'Au fond des ténèbres, confrontée dans son parcours personnel et professionnel à la question du mal. Mary Bell est une ravissante petite fille, dont l'intelligence est soulignée par tous, incapable d'expliquer ses meurtres. Les deux femmes, opposées en tout, se retrouvent face à la problématique du pardon et de la vérité. L'historienne de l'Holocauste se demande comment faire la paix avec l'Autre ; l'ancienne fillette qui a tué se demande comment faire la paix avec soi-même. Gitta Sereny a écrit un récit passionnant par sa rigueur, son honnêteté, sa compassion. Elle croit en la bonté de l'homme. On pense au Journaliste et l'Assassin de Janet Malcolm, car l'enquêtrice ne se laisse rien passer. Elle ne cesse de suggérer des interrogations et de souligner des limites. Gitta Sereny sait bien, par exemple, que nous formons une seule et même personne. IL est vain de dissocier, en chacun de nous, l'enfant et l'adulte. Alors, comment une petite fille de 11 ans peut-elle assassiner deux fois de suite (...) puis devenir, avec le temps, une adulte responsable ? Gitta Sereny, qui a suivi durant trente ans l'affaire Mary Bell, apporte des tentatives de réponse. (...)
Elle croit en la raison. Elle raconte non pour montrer mais pour penser. L'importance des mots est primordiale. De qui et de quoi parle-t-on ? Une enfant maltraitée et non une enfant tout court, une petite fille et non une petite adulte, une enfant qui a tué et non une enfant meurtrière.
Le récit fait bouger les lignes. Au début : comment une fillette peut-elle tuer, deux fois de suite, deux petits garçons ? À la fin : comment peut-on se reconstruire, sans aucune aide extérieure, après avoir tué deux fois de suite des enfants ? La journaliste donne des esquisses de pistes, après des années d'investigation (...).
Le mur s'effrite, peu à peu, au fil des années. Mary Bell attend l'âge de 18 ans pour tenter de concevoir la souffrance ressentie par les parents des deux petits garçons tués. La jeune femme réussit à s'affronter elle-même par à-coups douloureux. Tout est lent, tout est gelé, tout est noir. Le passé familial resurgit. Les relations destructrices des uns et des autres, cherchant désespérément à sauver leur peau. Gitta Sereny fait de Mary Bell une adulte à la fois coupable et innocente. Les secrets sont partiellement levés. Les crimes de l'enfant font écho aux crimes de la mère.
La Montagne, 28 septembre 2014
L'être criminel
par Daniel Martin
Naît-on criminel ou le devient-on et comment ? Une des grandes questions posées dans ce texte magistral.
Exactement le genre de bouquin que l’on ne voudrait pas lire. En raison de son sujet. Et que l’on referme avec le sentiment d’avoir lu un grand livre. Rien à voir avec ce qui traîne en librairie ces jours-ci, ces textes assez feignasses qui hésitent entre document et fiction.
Un vrai travail d’enquête, d’analyse sur la grande question du mal : est-on criminel par nature ou le devient-on et quel serait alors le rôle ou la responsabilité de toute société ? (...)
En 1995, après la mort de sa mère (...) Gitta Sereny la recontacte. Elle lui a déjà consacré un livre : Meurtrière à 11 ans. Voudrait le parfaire, le compléter. Aborder plus frontalement, plus profondément cette question du mal qui l'obsède.
Mary accepte. C'est-à-dire qu'elle accepte de quitter sa relatie tranquillité pour replonger dans le passé et "rétablir la vérité" : dire ce qu'elle n'a jamais dit de ses premières années. Des pages saisissantes.
Le tout rendu avec d'infinies précautions. Sans jamais oublier les victimes, leurs proches, sans excuser ni minimiser les crimes commis. Mais en venir à ceci : "Qu'est-ce qu'un tiers peut introduire, consciemment ou non, chez un enfant, qui le conduise à des actes profondément incompatibles avec la bonté intrinsèque de l'être humain ?"
Le Monde, 25 septembre 2014
UneMDL.pdf
Document Adobe Acrobat [4.7 MB]
Vivre après tuer
par Macha Séry
(...) Pourquoi une fillette en est-elle venue à étrangler deux enfants ? Et pourquoi consacrer un ouvrage à cette affaire, au risque de raviver les blessures ? De la réponse à la première question, formulée au terme d'une douloureuse et exigeante introspection, découle la seconde. Mary Bell n'a consenti à s'entretenir avec la journaliste que pour élucider sa propre personnalité. "Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment suis-je devenue cette enfant ?" Après tout ce temps, elle-même l'ignorait.
(...) Or Une si jolie petite fille n'est pas, loin s'en faut, une entreprise de justification, mais une captivante odyssée dans la psyché, un modèle rare d'investigation invitant à combattre les préjugés par la lucidité. Il eût été plus simple d'imputer les crimes de Mary Bell à une perversité originelle, laquelle aurait produit un monstre, une "mauvaise graine" ou, selon les mots du procureur ayant instruit le procès de la jeune meurtrière, "une vicieuse", "cruelle" et "terrifiante". Visant une enfant incapable de comprendre le caractère irrémédiable de la mort, pareilles interprétations ne pouvaient satisfaire l'esprit analytique de Gitta Sereny. (...)
Cinq ans plus tard, à 16 ans, l'adolescente colérique ne se rend toujours pas compte de la gravité de ses actes. "Pourquoi ? Qu'ai-je fait ?" Mary Bell ne peut s'avouer qu'elle a tué, ni livrer le moindre détail sur les circonstances des assassinats. Les remords ne l'effleurent pas. Ceux-ci surgissent à sa majorité et sont décuplés à la naissance de sa fille. (...)
Outre un parcours de résilience exemplaire (...), c'est cela qui fascine dans Une si jolie petite fille : les digressions dilatoires de Mary Bell adulte, l'intelligence et l'acerbité de ses remarques, ses inflexions et son vocabulaire changeants, selon qu'elle évoque ses années de détention ou son milieu familial, ses ultimes résistances à ouvrir la boîte de Pandore, doublée de ses efforts tourmentés pour accéder à la vérité. (...) Ce voyage à rebours dans le temps s'achève par l'exhumation de souvenirs liés à sa petite enfance, où elle fut victime d'abus sexuels et de tentatives de meurtre de la part de sa mère. "Croyons-nous à la rédemption ?" questionne Gitta Sereny à la fin de son essai. Au lecteur désormais de répondre.
Le Nouvel Observateur, 18 septembre 2014
Meurtrière à 11 ans
par Didier Jacob
Elle était, pour le philosophe George Steiner, la plus "brillante" des journalistes. En 1968, Gitta Sereny (1921-2012) se passionne pour un fait divers qui défraie la chronique en Angleterre. (...) Interrogeant les témoins, elle tente de comprendre l'horreur de ce crime, et publie un récit : Meurtrière à 11 ans. Trente ans plus tard, Mary, la petite meurtrière, est libérée. Gitta Sereny la persuade de raconter son enfance et sa captivité. Elle en tire un nouveau livre, passionnant. Un classique de l'investigation.
L'Express, 17 septembre 2014
La petite meurtrière
par Jérôme Dupuis
La couverture de ce livre n'a pas fini de nous hanter. On y devine le visage étrange de Mary Bell à 11 ans. Soit exactement l'âge auquel la fillette a tué deux petits garçons de 3 et 4 ans (...). Modèle de persévérance et d'intégrité journalistiques, Gitta Sereny (1921-2012) a suivi le procès de 1968, passé des années à rencontrer les témoins et, enfin, longuement confessé Mary Bell à sa sortie de prison.
Le résultat est éblouissant. (...)
Il est rare qu'une œuvre journalistique se mue en une vertigineuse méditation sur le mal et la rédemption. Une si jolie petite fille y parvient, entre "littérature de fait divers" à la Norman Mailer et psychanalyse des profondeurs. En confessant Mary Bell, Gitta Sereny chemine patiemment avec elle (et nous, lecteurs) vers un terrible secret familial, ramassé en quatre pages insoutenables. Et si, au fond, la fillette au visage étrange de la couverture n'était pas la "véritable" coupable ?
Canal +, 12 septembre 2014
Chronique d'Augustin Trapenard
« Le Grand Journal »
« Voici un livre dont je suis obligé de vous parler, parce que c'est un livre extraordinaire. (...) Il se lit comme un thriller. C'est mieux que tous les romans que j'ai lus qui parlent de faits divers. C'est une histoire hallucinante. Un livre puissant sur l'humain dans ses failles, dans ses secrets. »
À voir ici (à partir de la neuvième minute).
Libération, 11 septembre 2014
Le secret de l'enfant meurtrier
par Pascale Nivelle
Enquêtrice exemplaire, Gitta Sereny remonte aux origines d'un fait divers.
(...) Au procès, Betty (sa mère) jetait des regards noirs à Mary. L'air de dire "tu te tais" et de cacher un secret plus noir encore que la mort des deux petits garçons. Mystère que Gitta Sereny ne parviendra pas à percer au début des années 70, même en interrogeant Mary à plusieurs reprises dans le centre pour jeunes délinquants où elle a été envoyée, seule fille parmi 18 garçons. (...)
Près de trente ans plus tard, Mary, libérée à 21 ans, a refait sa vie. Mère d'une petite fille, elle vit sous des faux noms que les journalistes éventent régulièrement. Gitta Sereny, elle, est devenue une brillante journaliste, auteur d'une biographie remarquée de Franz Stangl, le bourreau de Treblinka. (...)
Toute sa vie, Sereny, née en 1921 et morte en 2012, tentera de comprendre le mal et de trouver comment y échapper. En 1995, elle retrouve Mary, qui accepte de lui parler. A 38 ans, hantée par la culpabilité, surtout depuis qu'elle est mère, Mary Bell ouvre son cœur et sa conscience pour la première fois de sa vie. La psychanalyse sauvage durera trois ans, pendant lesquels Sereny explore chaque détail enfoui dans la mémoire de la jeune femme. Jusqu'à lui faire expulser le terrible secret, source de son mal et de celui qu'elle a fait.
En 1998, paraît Cries Unheard ("cris non entendus"), qui provoque un tollé en Angleterre, notamment parce que Sereny a reversé 50 000 dollars de droits d'auteur à Mary. C'est ce livre, "extraordinairement difficile à rédiger", a-t-elle confié, que publient les éditions Plein Jour. A la fois thriller psychologique, non-fiction novel, réflexion sur la justice et essai philosophique sur le mal, chaque page d'Une si jolie petite fille arrache des larmes au lecteur. Larmes de chagrin, de révolte et d'impuissance face aux enfants qui souffrent, qu'ils s'appellent Martin Brown, Brian Howe ou Mary Bell.
Le Canard enchaîné, 10 septembre 2014
Une enfance meurtrière
par Dominique Simonnot
Nous sommes en 1968, Gitta Sereny, journaliste, assiste, en Grande-Bretagne, pour son journal, au procès de Mary Flora Bell, 11 ans, qui a tué deux petits garçons de 3 et 4 ans. Jugée comme une adulte, selon la loi anglaise, la fillette fait face à des magistrats en perruques, ne comprend rien à leur charabia et leur répond entre deux rires. Son avocat est minable, les deux psychiatres qui l'ont examinée deux fois une demi-heure l'estiment "vicieuse" et "très dangereuse". Le "monstre" est condamné à perpétuité. (...)
Trente ans plus tard, en 1998, sort ce livre, traduit bien tardivement en France et fruit de plusieurs années de discussions avec Mary Bell. Elle a été libérée à 23 ans et, après de longs travaux d'approche, a accepté, à 40 ans, de remettre sa vie entre les mains d'une journaliste qui se passionnait pour elle depuis si longtemps. Ce fut "un livre extraordinairement difficile à rédiger" confie Gitta Sereny, alors âgée de 77 ans. C'est surtout un livre exceptionnel. (...)
Télérama, 10 septembre 2014
par Nathalie Crom
Le fait divers, écrivait Roland Barthes, désigne une information inclassable, relevant du registre hétérogène des « nouvelles informes » : meurtres, agressions, désastres..., qui captivent autant qu'ils épouvantent parce qu'ils renvoient « à l'homme, à son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes, à ses rêves, à ses peurs ». Celui-ci, auquel l'historienne et journaliste britannique Gitta Sereny (1921-2012) a consacré deux ouvrages, est resté longtemps célèbre en Grande-Bretagne, du fait de son caractère exceptionnellement dérangeant. En 1968, à Newcastle, une fillette de 11 ans, Mary Bell, assassina deux petits garçons de 3 et 4 ans. Jugée la même année, elle fut reconnue coupable. Demeurée détenue durant douze ans (dans une unité spécialisée jusqu'à ses 18 ans, puis en prison), elle fut libérée en 1980 et vit depuis sous une nouvelle identité. (...)
C'est à remonter le temps que Gitta Sereny convie Mary Bell lors de leurs entretiens patients, précis, ébranlants. A revenir « au plus près de ses souvenirs », pour se retrouver trente ans plus tôt à Scotswood, le quartier défavorisé de Newcastle où elle grandit. Cela dans le but de voir surgir, au fil des discussions, des pages, la seule chose qui importe à la journaliste : non pas un réexamen de cette histoire, basé sur des indices ou des preuves négligées, mais une relecture orientée vers « la réponse à la question : Pourquoi ? » Vers cette autre interrogation que lui inspire Mary adulte : « Y a-t-il dans l'esprit humain, les nerfs, le coeur, quelque chose qui possède le pouvoir de détruire ou de paralyser, puis de recréer ou de rétablir, la moralité et la bonté ? » Si ce « quelque chose » existe — et pour Gitta Sereny, cela ne fait pas de doute —, il a un nom, la rédemption, mot par lequel l'auteur a choisi de clore ce livre inconfortable et important.
Livres Hebdo, 5 septembre 2014
La vérité sur Mary
par Alexandre Fillon
(...) Comment un enfant peut-il agir d'une manière qui lui sera proprement inconcevable une fois adulte ? Mary Bell, sur laquelle elle avait publié un premier livre, Meurtrière à 11 ans, Gitta Sereny l'a revue en 1995 quand elle eut le projet de lui consacrer un nouvel ouvrage. Elle était alors sous contrôle judiciaire et mère depuis 1984 d'une petite fille. Gitta Sereny revient sur le procès, sur son enfance. Rappelle que sa mère, Betty, hurla : "Débarrassez-moi de cette chose !" quand on lui présenta son nourrisson.
Betty essaya plusieurs fois de se débarrasser de cet enfant non désiré, tenta à quatre reprises de la tuer. Quand Mary fut libérée, sa mère lui affirmait qu'elle était la honte de sa vie et lui demandait de ne jamais dire qu'elle était sa fille... Gitta Sereny a voulu recueillir la version des faits d'une Mary Bell soucieuse de donner sa vérité. Le résultat donne un volume aussi passionnant que vertigineux.
Télérama, 23 août 2014
Rentrée littéraire : nos premiers choix
par Nathalie Crom
(...) Autre voix, non pas nouvelle celle-là, ni romanesque, mais qui s'imposera cet automne comme capitale par la profondeur des enjeux moraux dont elle s'empare : celle de Gitta Sereny (1921-2012). Passionnée par la question du mal et la possibilité d'en saisir les origines, la journaliste et historienne britannique, auteure déjà de l'admirable Au fond des ténèbres, né d'entretiens avec Franz Stangl, ancien commandant des camps d'extermination de Sobibor et de Treblinka, poursuit sa réflexion en se penchant sur la personnalité et le destin d'une enfant meurtrière dans Une si jolie petite fille. Les crimes de Mary Bell.
Le Journal du dimanche, 22 juin 2014
Deux livres phares de la rentrée littéraire
par Marie-Laure Delorme
(...) On retrouve le recours aux mots pour comprendre le passé et la plongée dans un destin étranger dans deux livres phares de la rentrée littéraire. Côté étranger, un document : une fille de ll ans assassine deux garçons de 3 et 4 ans en 1968 en Angleterre. La journaliste Gitta Sereny a retrouvé Mary Bell, près de trente ans plus tard, pour essayer de comprendre ce qui a mené une enfant à tuer d'autres enfants. Une si jolie petite fille (Plein Jour) est dans la droite ligne du Journaliste et l'Assassin, de Janet Malcolm : une enquête sans concession sur la justice, le mal, le pardon. Côté français, un récit: Olivier Rolin part sur les traces du Soviétique Alexeï Féodossevitch Vangengheim, arrêté en 1934 comme « saboteur ». (...)