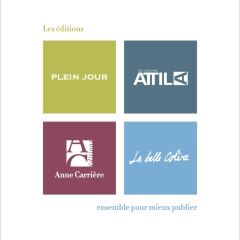En Attendant Nadeau, 17 août 2024
Par David Novarina
L’ancien correspondant à Moscou écrit l’histoire de l’association depuis sa fondation, à la fin de la perestroïka dans les milieux de la dissidence, jusqu’à sa liquidation par la justice russe. Memorial comportait en Russie deux branches, l’une œuvrant à entretenir la mémoire des répressions de masse de l’époque soviétique, l’autre à défendre les droits de l’homme dans la Russie contemporaine. Inlassable aura été pendant ces trente ans l’activité de Memorial sur l’ensemble du territoire russe, en dépit des tracasseries et des persécutions croissantes, rendues possibles notamment par la loi sur les « agents de l’étranger » de 2012.
Comment donner une idée de ce qu’a pu représenter Memorial en Russie ? Peut-être en évoquant trois souvenirs personnels. Moscou, 2015. Je vais voir au siège de Memorial l’exposition « Droit de correspondance, lettres des détenus politiques des camps soviétiques des années 1920 aux années 1980 ». En ce jour de semaine, la salle est vide ; une dame à l’épaisse monture de lunettes très soviétique descend de son bureau et propose de me montrer l’exposition. « Quel est l’état de vos connaissances sur le Goulag ? ». « Assez élémentaire », répondis-je, et nous voilà nous plongeant tous deux dans les lettres d’anciens zeks à leurs proches et observant les traces de censure ; le titre de cette exposition construite à partir d’archives privées léguées à Memorial faisait allusion à l’expression « dix ans sans droit de correspondance », utilisée par le pouvoir soviétique pour occulter les exécutions.
[...]
Étienne Bouche revient sur quelques-unes des très nombreuses activités de l’organisation. Il est notamment question de ce moment majeur qu’est la cérémonie de la restitution des noms, au cours de laquelle sont lus, tous les 29 octobre, sur la place Loubianka et ailleurs, les noms des personnes exécutées par le régime soviétique. Étienne Bouche a aussi assisté en 2017 à la remise des prix du concours « L’homme dans l’histoire. Russie. XXe siècle », qui s’adressait à des lycéens invités à écrire un essai sur une thématique historique ; en dépit des obstructions du ministère de l’Éducation, des lycéens de provinces lointaines avaient fait le voyage. En janvier 2022, le journaliste visite la dernière exposition organisée par Memorial en Russie, consacrée à l’expérience féminine du Goulag, peu avant que la justice ne confirme la liquidation de l’organisation. Quant à l’attribution du prix Nobel en octobre 2022, Étienne Bouche souligne qu’elle est quasiment passée sous silence par les grands médias russes.
Ce qui rend précieux le livre d’Étienne Bouche, c’est notamment la connaissance qu’a acquise son auteur des régions périphériques de la Fédération de Russie. Le livre est construit pour l’essentiel selon une logique géographique, à partir de reportages et de portraits. Un des chapitres évoque le travail de la section de Krasnoïarsk de Memorial, puis la rencontre dans la petite ville de Ienisseïsk avec une professeure d’histoire qui s’intéresse à la déportation des Allemands de la Volga. Dans un autre chapitre, Étienne Bouche décrit le contraste entre la vision monumentale et épique de la « Grande Guerre patriotique » à Volgograd (anciennement Stalingrad) et la perception qu’en donne un passage par la ville d’Elista, capitale de la République de Kalmoukie, où l’on garde mémoire de la déportation collective du peuple kalmouk ordonnée en décembre 1943. À l’aune de la guerre en Ukraine, on lit avec une attention particulière les pages consacrées au musée du camp Perm 36, où furent détenus de nombreux prisonniers politiques du mouvement national ukrainien, tel le poète Vassyl Stous, qui y finit ses jours en 1985. Unique musée de Russie consacré à un camp in situ, le musée de Perm 36, né d’une initiative locale, a été repris en main par les autorités russes en 2014, qui en ont revu la muséographie.
[...]
Le Figaro, 3 février 2024
Par Martin Bernier
Le Monde Diplomatique, février 2024
Memorial face à l'oppression russe
Par Audrey Lebel
Dans un récit incarné, sous la forme d’une série de rencontres avec ses membres fondateurs, Étienne Bouche revient sur la genèse de Memorial au sein de la dissidence soviétique, avant que le groupe n’acquière le statut d’organisation en janvier 1989 sous la présidence de Mikhaïl Gorbatchev. Son but : recenser les victimes et documenter les répressions du régime soviétique, notamment à l’époque stalinienne, et inviter les Russes à un vrai travail de mémoire, condition de la démocratisation espérée pendant la perestroïka. Au-delà des pressions croissantes que l’association subit à partir de l’arrivée de M. Vladimir Poutine au pouvoir en 1999, l’auteur s’interroge sur l’échec de cette entreprise. Car les nouvelles générations n’ont guère poursuivi ce travail mémoriel, laissant le champ libre à une réécriture de l’histoire au service de la légitimation de l’État (nouveaux manuels, réhabilitation de Joseph Staline, célébration de la victoire de la « grande guerre patriotique » comme mythe fondateur). La dissolution de Memorial a été prononcée en février 2022, quatre jours après le début de l’invasion de l’Ukraine.
Sud Ouest, 14 janvier 2024
Contre l'effacement de la mémoire russe
Par Christophe Lucet
Dissoute par Poutine mais « nobélisée » en 2022, l’ONG Memorial tente de survivre malgré la volonté du régime de réécrire l’histoire. En Russie, Étienne Bouche a rencontré ses militants.
De ses sept ans (2013-2020) de correspondance en Russie pour la presse française dont « Sud Ouest », le journaliste Étienne Bouche a rapporté ce remarquable reportage réalisé avant que Vladimir Poutine ne déclenche les foudres de la justice en faisant interdire Memorial, fin 2021. Depuis, l’ONG mémorielle survit clandestinement en Russie, et plus officiellement à l’étranger, grâce à sa structure internationale dont la branche française est dirigée par l’historien Nicolas Werth.
Co-lauréate en 2022 du prix Nobel de la paix avec des défenseurs des droits humains en Biélorussie et en Ukraine, l’ONG créée par le physicien Andreï Sakharov avant la chute de l’URSS avait relayé les combats des dissidents des années 1970-1980, et s’était donné pour mission de perpétuer le souvenir des millions de victimes du goulag et des crimes communistes sous la dictature de Joseph Staline. Un combat qui a fini par insupporter l’actuel régime russe malgré le dégel de la décennie 1990.
Loin de Moscou
Alors qu’on célèbre le 50e anniversaire de la publication en Occident de « L’Archipel du goulag » d’Alexandre Soljenitsyne, ce reportage patient, loin de Moscou, articule les rencontres de l’auteur avec des militants locaux de Memorial qui scrutent les archives et partent sur le terrain reconnaître des lieux sinon oubliés, du moins invisibilisés, car ils renvoient à la terrible époque des déportations, procès iniques et exécutions de masse que la Russie vou- drait oublier.
« Maladie de la mémoire »
Car pour « l’historien en chef » Poutine, réhabiliter Staline et réécrire le passé sans jamais nommer les responsables se veut le moyen de « stabiliser » la société. C’est ainsi que les 6 241 corps du charnier de Sandormokh découvert en 1997 en Carélie par le militant de Memorial Iouri Dimitriev ne sont plus les victimes de la Grande Terreur stalinienne de 1937-1938 mais, contre toute évidence, « des soldats soviétiques exécutés par les Finlandais ». Dimitriev, lui, croupit en prison après un procès inique.
Or ces mensonges anesthésient les Russes, atomisent le corps social, nourrissent la méfiance des citoyens envers le régime et entre eux. C’est ainsi, note l’auteur, que se prolonge cette « maladie de la mémoire qui empêche la Russie de retrouver sa place, la guerre d’Ukraine n’étant que l’effet désastreux de ce passé imprégné de res- sentiment, éloignant tout espoir de guérison ». Noir constat que le livre éclaire par son empathie en suggérant combien les Russes ont besoin de Memorial.
La Croix l'Hebdo, 28 décembre 2023
Par Pierre Sautreuil
Il y a deux ans, alors que Vladimir Poutine massait ses troupes à la frontière ukrainienne, l'association Memorial était interdite en Russie. L'aboutissement d'un processus de harcèlement judiciaire entamé des années plus tôt contre ce promoteur inlassable de la mémoire des victimes de la répression soviétique et de la défense des droits de l'homme.
Dans un essai d’une grande finesse, Memorial face à l’oppression russe, le journaliste Étienne Bouche retrace l'épopée de Memorial, de sa naissance en 1989 à son interdiction et en fait un fil rouge pour retracer la façon dont Vladimir Poutine a kidnappé l'histoire et la mémoire pour en faire des monopoles au service exclusif de l'État. Jusqu'à servir, le moment venu, à justifier l'impensable invasion de l'Ukraine.
[...]
Outre sa vocation historique et pédagogique, Memorial se donne aussi pour mission de défendre les droits de l'homme. Mais cette volonté de former un esprit critique et d'énoncer des vérités embarrassantes se heurte à l'autoritarisme croissant du régime.
[...]
Parallèlement à cette marginalisation de Mémorial, l’idéologie et la manipulation historique s'insinuent dans les manuels scolaires et les musées. La critique de la version officielle
del'histoire devient synonyme d'atteinte aux intérêts de l'État, même quand elle réhabilite Staline. La Seconde Guerre mondiale est érigée au rang de mythe fondateur synonyme de sacrifice volontaire
au service de l'Etat.
L'invasion de l'Ukraine sonne comme un constat d'échec pour les militants de Memorial, qui espéraient s'opposer aux manipulations de l'histoire. Leur mission demeure, malgré l'interdiction de l'ONG,
le seul moyen à leurs yeux pour que la Russie puisse se tourner vers l'avenir. À travers l'histoire de ces militants, Étienne Bouche jette un éclairage remarquable sur les impasses de la Russie
contemporaine.
RTBF, 11 décembre 2023
Librairie Mollat, 7 décembre 2023
RFJ, 17 novembre 2023
Le monde en cause : une ONG symbole de l’oppression russe
Par Alexandre Rossé
Le journaliste français Etienne Bouche consacre un ouvrage à l’organisation Memorial qui a été interdite par le pouvoir russe et qui a reçu en 2022 le prix Nobel de la paix.
Elle a remporté le prix Nobel de la paix l’an dernier. L’ONG russe Memorial qui mène un travail de mise au jour des crimes du communisme est au cœur d’un livre de notre ancien correspondant à Moscou, Etienne Bouche. Le journaliste français a longuement rencontré des militants du mouvement et évoqué avec eux leur activité devenue aujourd’hui clandestine. L’ONG Memorial a, en effet, été dissoute en décembre 2021 par le pouvoir russe. Etienne Bouche s’est intéressé à l’organisation, car elle constitue l’incarnation de la société civile en Russie, selon lui. Dès sa naissance à la fin des années 80, le mouvement Memorial a eu comme objectif de procéder à un examen critique de ce qu’il s’est passé, notamment sous Staline.
Etienne Bouche explique que le message du Memorial a eu du mal à passer à l’époque. Le mouvement a progressivement été assimilé à une structure qui était à la solde d’états étrangers par le pouvoir russe, explique l’ancien correspondant en Russie. Selon lui, Memorial s’est aussi attiré une certaine méfiance de la société. Aujourd’hui, l’entité n’a plus d’existence officielle juridique.
Pour réécouter l'émission, c'est ici.
Le Nouvel Esprit public, 29 octobre 2023
L’Argentine entre deux populismes / L’Europe et la sécurité
Brève présentée par Michel Eltchaninoff
"Je vous recommande ce livre d’Etienne Bouche, journaliste longtemps correspondant en Russie, qui connaît parfaitement le pays. Mémorial est une association, créée à la fin des années 1980 pour documenter les crimes du stalinisme, mais s’est aussi spécialisée dans la dénonciation des atteintes aux droits de l’Homme dans la Russie contemporaine, faisant ainsi un lien entre les crimes du régime soviétique et ceux de l’Etat russe qui a suivi (notamment en Tchétchénie). Le livre raconte l’histoire de Mémorial, de sa création à sa dissolution fin 2021, juste avant l’invasion de l‘Ukraine. Cette dissolution était le signe de cette agression à venir, un peu comme l’assassinat du commandant Massoud juste avant le 11 septembre, on sentait qu’il s’agissait de faire taire la « conscience » de la Russie que représentait Mémorial. Etienne Bouche ne passe pas sa vie à écouter et commenter les discours du Kremlin, il prend des trains en 3ème classe et parcourt tout le pays. Il nous raconte comment l’Etat russe modèle et transforme la mémoire, comment il rend les Russes amnésiques. Dans telle ville, on construit une Église glorifiant les forces armées, à côté d’un musée d’Histoire de la Russie dans lequel on explique que les révolution « de couleur » sont financées par les Américains et très dangereuses, etc. Comment, d’un point urbanistique, on interdit aux Russes de s’interroger sur leur propre identité historique. L’auteur en conclut qu’il est impossible pour les Russes de faire société ou d’imaginer un autre futur tant qu’ils seront ainsi empêchés de faire ce retour sur eux-mêmes. "
TV5 Monde, 18 octobre 2023
La Presse du soir, 15 octobre 2023
Par Michel Tagne Foko
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur ce sujet ? Peut-on en connaître les coulisses ?
Après plus de sept ans passés en Russie, je ressentais la nécessité de restituer par écrit des réflexions sur le pays et de la société, des impressions rapportées de mes reportages et qui, bien souvent, se retrouvaient hors cadre. L’immobilité à laquelle nous avait tous contraints le Covid-19 permettait ce travail réflexif.
En Russie, il est frappant de constater que la mémoire est à la fois omniprésente et enfouie, et cette empreinte mémorielle semblait inévitablement apparaître en filigrane quels que soient les sujets que j’abordais dans mon travail. Éclairer le rapport des Russes à leur passé, en identifier les angles morts, s’est révélé la meilleure approche pour parler de la société russe d’aujourd’hui, qui suscite tant d’interrogations.
La liquidation de l’organisation Memorial, que j’avais refusée d’envisager, a été annoncée au moment où la structure du livre prenait forme. Cette décision a logiquement bousculé l’écriture, tout en confortant la force et la pertinence du sujet.
En quoi la situation de Mémorial, mouvement issu de la société civile russe, vous a-t-elle interpellé en tant que journaliste et écrivain ?
Les organes judiciaires du pays ont ciblé le mouvement le plus emblématique issu de la société civile. Memorial s’était fixé une mission double : faire la lumière sur les crimes commis par l’État soviétique et accompagner la transformation de la société. Dire la vérité sur le passé, affronter les traumatismes de l’Histoire pour ne jamais les répéter. De cette manière, Memorial entendait forger des consciences indépendantes, capables d’esprit critique. L’organisation aspirait à créer une authentique société civile en Russie.
a dissolution de Memorial symbolisait la disparition des fragiles liens horizontaux qui s’étaient constitués depuis la chute de l’URSS. L’État s’est employé à liquider l’héritage de 1991. Dans le contexte de guerre contre l’Ukraine, il a réduit au silence les dernières voix qui en défendait les acquis – le centre Sakharov, qui défendait les droits de l’Homme, et le grand journal d’investigation Novaïa Gazeta, pour ne citer qu’elles.
Le choix de mettre en avant l’histoire de l’historien Iouri Dmitriev, emprisonné depuis 2016, était-il une décision délibérée pour illustrer les persécutions dont sont victimes les membres de Mémorial ?
Le cas de Iouri Dmitriev, que j’ai couvert en tant que correspondant, est cruellement représentatif de la pression exercée sur ceux qui oseraient contester le récit historique imposé par l’État.
Un historien se retrouvait sur le banc des accusés. Au sens propre, Dmitriev avait déterré le passé : il avait exhumé un charnier de la Grande Terreur stalinienne et en avait identifié les milliers de victimes. Ce qu’il révélait à ses compatriotes était inacceptable pour l’État qui minimise, quand il ne les dissimule pas, les répressions soviétiques.
L’emprisonnement de Iouri Dmitriev a pour principal objectif l’intimidation : ce militant de Memorial a été visé par un kompromatinfamant, une pratique qui consiste à diffuser un document compromettant – et fabriqué – destinée à saper la réputation d’un individu. C’est un procédé redoutable, qui marginalise et discrédite durablement. Il permet de rallier la majorité car, dit-on, « il n’y a pas de fumée sans feu ».
Comment expliquez-vous le paradoxe selon lequel l’Église orthodoxe russe, censée représenter Dieu, source d’amour et de miséricorde, participe au processus de révision mémorielle en étant associée à la guerre plutôt qu’à la paix ?
L’Église orthodoxe russe a été persécutée par le régime communiste. L’État post-soviétique lui a redonné une place prépondérante, soucieux de renouer avec son héritage spirituel. Il fallait redonner des repères à une société déboussolée. Le pouvoir politique a utilisé l’Église pour rétablir l’autorité de l’État. A la recherche d’une nouvelle idéologie, Vladimir Poutine a voulu faire des mœurs conservatrices le socle fédérateur d’un pays fragmenté et resté multiculturel. L’Église orthodoxe a soutenu ce nouvel agenda : elle retrouvait son rang en échange de sa loyauté.
Il est cependant inexact de penser que l’Église orthodoxe fait figure d’autorité morale au sein de la société. L’institution est décriée. Par contre, dans le contexte de guerre, elle formule un message partagé par la majorité : la nécessité, dans l’adversité, de se ranger derrière l’intérêt supérieur de État. Car les représentations de l’État et du pays se confondent.
Sur la place de l’Église orthodoxe en Russie, je recommande la lecture des travaux très éclairants de la chercheuse Kathy Rousselet.
Face à la persistance de la guerre et aux conséquences dévastatrices tant pour les parties impliquées que pour le reste du monde, pensez-vous qu’il soit actuellement envisageable pour l’Ukraine de capituler ?
La brutalité de la guerre, les bombardements quotidiens, ont logiquement radicalisé les esprits en Ukraine. L’idée de capituler face à la Russie y est perçue comme insupportable, voire indécente. Mais l’Ukraine fait face à deux lourdes difficultés : son destin dépend en grande partie du soutien prolongé de ses alliés, tandis que la Russie, elle, est prête à envisager une guerre longue. Elle ne peut plus reculer et a préparé sa population. Moscou voudra imposer ses conditions – qui restent aujourd’hui bien peu lisibles – alors qu’aujourd’hui, tout compromis est impossible.
Pourquoi pensez-vous que Poutine a fait de Mémorial son principal ennemi intérieur et en quoi le mensonge historique est-il central pour son maintien au pouvoir ?
En Russie, l’Histoire que l’on écrit est celle de l’État. Dans la Russie post-soviétique, Memorial contestait cet invariant historique. A ce récit unique, Memorial oppose une lecture polyphonique qui donne la parole à l’individu.
En Russie, le pouvoir a transformé la célébration de la Victoire sur l’Allemagne nazie en nouveau culte pour gommer les zones d’ombre – les assassinats de masse, les déportations, l’esclavagisme pratiqué dans les camps.
En reconstituant l’Histoire dans toute sa complexité, Memorial subvertit l’intérêt supérieur de l’État et brise le tabou suprême en désignant des responsables. Pour esquiver ces accusations, le Kremlin perpétue une représentation binaire, « avec nous ou contre nous ». L’État ne saurait être mis en cause.
Que pensez-vous du fait que certaines personnes défendent ardemment l’oppresseur Vladimir Poutine plutôt que la victime ? Comment cela reflète-t-il notre nature humaine, selon vous ?
Beaucoup pensent que la Russie est dans son bon droit en Ukraine. Mais il est important de noter que face à l’arbitraire, l’individu développe des mécanismes intellectuels de défense. Se couper entièrement de la vie politique et renoncer à tout engagement civique en est un ; prendre le parti des « forts » pour ne pas se retrouver victime en est un autre. S’opposer ne va pas de soi, c’est un choix lourd de conséquences qui, généralement, condamne à la solitude.
Expliquer « ce que pensent les Russes » reste pour moi le plus difficile. D’une part, parce que la population est souvent réticente à exprimer le fond de ses pensées – c’est d’autant plus le cas depuis le début de la guerre, qui a réactivé la pratique du « double langage », qui prévalait à l’époque soviétique.
D’autre part, parce que les gens ont été maintenus dans un état d’inertie, si bien que certains ont tout simplement du mal à formuler leurs idées. Avoir un avis ne va pas de soi quand le système politique empêche les vrais débats.
En tant que correspondant en Russie de 2013 à 2020, quelles observations ou expériences personnelles ont contribué à façonner votre compréhension de la société russe et de ses enjeux politiques ?
L’expérience de terrain a été formidablement enrichissante, car la société russe, même si c’est l’image qu’elle renvoie, n’est pas monolithique.
Par contre, j’ai observé que les habitants de ce pays partageaient une même géographie mentale : une vision du monde, des réflexes sociaux, des stratégies d’évitement. Pour ne prendre qu’un seul exemple de ces enseignements, je parlerais de cette incapacité à dépasser ses croyances : comme si elle était une marque de faiblesse, l’expression du doute est souvent absente. C’est ce qui, selon moi, explique en partie certaines représentations figées du « monde extérieur », en dehors de la Russie, tout comme la dureté des rapports sociaux, la difficile empathie et la méfiance à l’égard de l’autre.
Façonner un nouveau système politique commence sans doute par un travail intellectuel collectif : apprendre à se remettre en question pour surmonter ses blocages.
Desk Russie, 14 octobre 2023
« Memorial face à l’oppression russe » : que reste-t-il de la société civile ?
Par Éve Sorin
De nombreux essais sur le régime de Vladimir Poutine, sur le goulag, sur le travail de mémoire et ses enjeux dans la Russie contemporaine, ont été publiés ces dernières années, mais aucune monographie en français n’avait été consacrée à Memorial. Le livre d’Étienne Bouche, Memorial face à l’oppression russe, qui vient de paraître aux éditions Plein Jour, comble ce manque à point nommé.
Selon Étienne Bouche, correspondant en Russie pour différents médias français de 2013 à 2020, il ne fait aucun doute que la guerre déclarée à l’Ukraine et la dissolution de Memorial sont l’avers et le revers d’une même pièce : « L’année 2022 marquait le centenaire de la proclamation officielle de l’Union soviétique. Cette même année, l’État russe a non seulement lancé une guerre infâme contre l’Ukraine, mais il a aussi ordonné la dissolution de Memorial », « sur la base d’un ressentiment mémoriel que Memorial, précisément, s’employait à défaire ».
L’organisation non gouvernementale russe Memorial s’était attelée, dès la fin des années 1980, à l’inventaire des purges staliniennes puis, plus largement, des répressions politiques dans leur ensemble, ainsi qu’à la restauration et à la préservation de la mémoire collective, par l’établissement de listes des victimes du goulag avec la constitution d’« archives du peuple », la mise au jour des charniers de la Grande Terreur, l’identification des tombes, et la restitution des noms par le recueil de témoignages. Et le sort qui a été réservé à cette organisation si renommée a signé de façon emblématique le retour d’une répression des plus féroces contre toute voix discordante en Russie. Memorial, lauréat du prix Nobel de la paix en 2022, conjointement avec le Centre ukrainien pour les libertés civiles et l’opposant bélarusse Ales Bialiatski, avait pourtant résisté le plus longtemps possible aux coups de boutoir du Kremlin — calomnies et intimidations, procès fallacieux et condamnation honteuse de l’historien Iouri Dmitriev, obligation d’apposer l’estampille « agent de l’étranger »… —, jusqu’à sa « liquidation », le 28 décembre 2021, deux mois avant que les troupes russes n’envahissent l’Ukraine.
Memorial face à l’oppression russe repose sur une appréhension spatiale de la Russie contemporaine, en proie à une « maladie de la mémoire ». D’emblée, Étienne Bouche précise que son approche est « journalistique, et volontiers géographique ». Dès son arrivée en Russie, il constate l’omniprésence tapageuse des symboles soviétiques (« le XXe siècle ne nous lâche pas », déclare l’historienne Irina Chtcherbakova, citée par l’auteur) et leur instrumentalisation à des fins politiques : parade du 9 Mai, Régiment immortel, parcs d’attraction dits « historiques », révélant, entre autres, « l’hypermnésie de l’État à l’égard de la Grande Guerre patriotique », le tout à rebours de ce que la majeure partie de l’ancien « bloc de l’Est » s’est appliquée en son temps à condamner et à faire disparaître, par voie de lustration et de décommunisation. D’ailleurs, ainsi que le rappelle Étienne Bouche, l’Ukraine, en rupture avec l’héritage de l’empire, avait, elle, entrepris la mutation de son espace public et engagé son « leninopad », c’est-à-dire la démolition des monuments à Lénine.
Aussi « l’absence de rupture idéologique au sommet de l’État [russe] », malgré les années Eltsine et malgré Memorial, est-elle à l’origine de réhabilitations désastreuses, au premier rang desquelles figurent le passé stalinien, glorifié avec tout ce qui est susceptible d’incarner la « grandeur de l’État » (différents « centres Staline » sont d’ailleurs en construction, près de Nijni Novgorod et dans l’Altaï). Car c’est bien de l’État, dépositaire intangible du passé, qu’il est question. Le récit « historique » ainsi élaboré est jalonné par quelques grands épisodes quasi mythologiques, mêlant « tsarisme et soviétisme [qui] n’entret[iennent] pas un rapport d’opposition » mais « appartiennent à un imaginaire dissocié de l’historicité ».
Dès lors, comment ce qui reste de la dissidence peut-il lutter contre une idéologie qui, toujours prescrite par l’État, se fonde non plus sur le marxisme-léninisme, mais sur une résurgence hybride de la triade d’Ouvarov3 ? Et qui, mieux que Memorial, peut servir de fil conducteur pour comprendre cette résurgence et représenter les tentatives problématiques pour extraire les mémoires individuelles de la gangue du totalitarisme ?
L’essai d’Étienne Bouche, dense et clair, est nourri de nombreuses lectures, mais aussi et surtout de rencontres et d’entretiens avec de grandes figures de Memorial (Alexandre Daniel, Alexandre Tcherkassov…), des responsables de sections locales, aussi bien qu’avec des memorialtsy (membres de Memorial) plus modestes, aux quatre coins de la Russie. Ainsi, à travers Memorial, se dessinent en creux des individualités distinctes : mais que peut-il advenir de cette ébauche de société civile atomisée quand l’histoire, la mémoire collective, sont confisquées par l’État ?
De la société russe, on a tendance à ne voir désormais qu’une masse uniforme dans le sillage de son chef belliqueux, et dont la conscience a été anéantie par des années de propagande. Aujourd’hui, les voix contestataires sont inaudibles, les « piquets » solitaires (sortir seul dans la rue en brandissant une pancarte pour marquer son opposition) paraissent dérisoires, alors que la guerre contre l’Ukraine est menée au nom des Russes dans leur ensemble. Malgré les moyens de communication contemporains (les réseaux sociaux et Internet permettent d’accéder à un autre récit que celui du Kremlin), malgré les trente années d’activité de Memorial, la lutte pour la mémoire et contre « l’inertie de la peur », pour reprendre l’expression d’une autre grande figure de la dissidence soviétique, Valentin Tourtchine, s’est soldée par un échec.
En se penchant sur Memorial, Étienne Bouche invite le lecteur à se poser de multiples questions sans se voir asséner de réponses péremptoires ou prématurées. Et ce n’est pas la moindre qualité de son livre. Les pistes de réflexion qu’il trace sont à chercher du côté des antinomies et de leur articulation : l’État, rouleau compresseur, Moloch ou Léviathan, broie les mémoires individuelles et sacralise des mythes en lieu et place de l’histoire. Or, de la mythification à la mystification il n’y a qu’un pas. La sacralisation, quant à elle, favorise le fanatisme, qui prend la forme de la « zombification des esprits » dont il est si souvent question depuis le début de la guerre.
Est-il trop tard pour contourner l’État et rendre la mémoire et la parole aux Russes de sorte qu’émerge une société civile, celle-là même qu’on avait cru voir apparaître, notamment grâce à Memorial, mais qui aujourd’hui fait défaut de manière effarante ? La société russe est-elle soluble dans le régime qu’elle semble s’être choisi ? Est-elle condamnée à l’être ?
Il n’y a pas de « Russie éternelle », pas plus qu’il ne saurait y avoir de Russie « éternellement irrationnelle ». Étienne Bouche dit avoir fini par détester le trop fameux quatrain du poète Fiodor Tiouttchev (1803-1873) : « La Russie ne se comprend pas par l’intelligence / Ni ne se comprend à l’aune commune / Elle possède son statut propre / La Russie, on ne peut que croire en elle »), dont les Russes se gargarisent si souvent et qui empêche de penser. Sera-t-il possible, un jour, de concevoir une autre Russie, à l’aune des individus qui la composent ?
Si grande que soit la tentation de vouer aux gémonies cette Russie née des décombres de l’empire soviétique et si disposée à dévaster ses voisins, il convient de ne pas délaisser l’étude de son histoire contemporaine, de réfléchir aux traumatismes de sa société. Pour cela et pour l’acuité de ses observations, on ne saurait trop recommander Memorial face à l’oppression russe.
Le Monde libertraire.net, 8 octobre 2023
Par Sylvain Boulouque
L’association Memorial a été interdite en décembre 2021 par le pouvoir tenu par les anciens du KGB dans la Russie post-soviétique montrant que le pays est toujours aux mains des Siloviki – les
anciens cadres de la police secrète.
Le journaliste Étienne Bouche présente dans cette enquête les origines, les développements de ce groupe composé de citoyens russes – historiens, chercheurs, journalistes ou descendant de victimes du
GPU/NKVD/KGB – œuvrant à faire connaître la réalité du passé soviétique et à apporter la connaissance la plus précise possible sur les crimes de l’époque stalinienne et par ailleurs défendant les
droits humains, notamment suite à la destruction de la Tchétchénie par l’armée russe.
Memorial a inscrit son action à la suite des dissidents des années 1960/1970 lorsque quelques-uns d’entre eux ont manifesté sur la Place rouge leur opposition au régime. Le combat s’est dans les
années 1980 et 1990 transformé en bataille de la mémoire. La chute du régime soviétique aidant, l’association a obtenu l’ouverture partielle des archives de la répression. Grâce à elle, une liste
partielle des victimes anonymes de la Grande Terreur, les citoyens assassinés à la suite des procès de Moscou par des tribaux expéditifs dont le seul objectif a été d’effrayer la population par le
meurtre de masses. Les équipes de Memorial se sont aussi attelé à donner un visage à la répression en publiant des enquêtes sur les bourreaux. Au tournant des années 2010, travailler sur les crimes
du régime est devenu exercice périlleux, plusieurs d’entre eux l’ont payé d’une arrestation et d’un emprisonnement qui, pour certains, continue. Ainsi l’historien Iouri Dimitriev est derrière les
barreaux pour avoir découvert plusieurs charniers et fausses communes que le NKVD avait creusé dans les forêts russes en 1937. Les enquêteurs de l’association chargés en charge des crimes de l’armée
russe sont eux aussi pourchassés pour avoir souligné la politique de terreur conduite dans le Caucase. Aujourd’hui Memorial n’existe plus officiellement en Russie, même si ses antennes poursuivent le
travail à l’étranger, informés par quelques dissidents qui ont repris le flambeau des combattants de la liberté des années 1960.
RFI, 28 septembre 2023
Par Frédérique Lebel
Quand les opposants biélorusses d'engagent en Ukraine
La guerre en Ukraine et les combattants venus renforcer l’armée ukrainienne, depuis la Biélorussie voisine ou plutôt le Belarus, comme ils préfèrent l’appeler. En s’engageant contre la Russie, ces jeunes soldats espèrent aussi œuvrer à affaiblir la dictature qui sévit dans leur propre pays. Et pourquoi pas renverser un jour Alexandre Loukachenko dont ils ont fui la répression. Témoignages rares recueillis en Ukraine par Alice Syrakvash et Virginie Pironon à Paris.
Et face à la guerre, que dire de la société russe, de son silence ? Alors que quelques grandes figures de l’opposition comme Alexei Navalny ou Vladimir Kara Mourza paient le prix fort en prison. C’est toute l’interrogation qui sous-tend le livre d’Étienne Bouche. Memorial face à l'oppression russe. Le combat pour la vérité, aux éditions Plein Jour.
France 24, 26 septembre 2023
Par Pauline Paccard
RFI en langue russe, 21 septembre 2023
« En Russie, seul l’État a le droit de dire le passé et le présent »
Par Anna Stroganova
RFI, 16 septembre 2023
Par Sylvie Noël
Memorial France, 14 septembre 2023
Parution : Étienne Bouche, Mémorial face à l’oppression russe.
Par Nicolas Werth
Correspondant en Russie pour divers journaux et médias français, dont RFI et Libération, de 2013 à 2020, Etienne Bouche nous propose à la fois une série de rencontres avec des personnalités de l’ONG Mémorial et une réflexion sur le rapport de la société russe à son passé.
Son ouvrage « Mémorial face à l’oppression russe » débute par un rappel de la dissidence des années 1970-1980, présentée par l’un des membres fondateurs de Mémorial, Alexandre Daniel, rédacteur en chef des recueils Pamiat ( La Mémoire) entre 1973 et 1982. Rejetant toute approche chronologique, Etienne Bouche emmène ensuite le lecteur dans une série de rencontres avec des responsables de Mémorial « en action » : on fait la connaissance de Lena Zhemkova et d’Irina Ostrovskaia en janvier 2022, au moment où les autorités viennent de dissoudre l’ONG et sont sur le point de saisir les bureaux de Mémorial ; d’Alexei Babyi, responsable de Mémorial à Krasnoiarsk, en train de numériser les archives sur les déportés en Sibérie orientale. On suit l’auteur dans son périple sur l’Iénissei, de Krasnoiarsk à Ienisseisk, où une certaine Irina, enseignante d’histoire, organise des expéditions vers des villages reculés où ont été déportés notamment des citoyens soviétiques d’origine allemande. Un long chapitre est consacré à une autre personnalité de premier plan de Mémorial, Robert Latypov, qui a dirigé, depuis 2010, l’importante branche de Perm avant d’être contraint, en 2022, de s’exiler à Brême. Avec chacun, Etienne Bouche essaie de comprendre les raisons de l’échec de Mémorial à guérir la société russe de sa « maladie de la mémoire ». L’ONG n’a visiblement pas su susciter l’intérêt de la nouvelle génération dans une société totalement atomisée qui ne s’est jamais interrogée sur son passé, et en particulier sur les pages les plus sombres de ce passé. Le traitement de ce passé par le pouvoir actuel est abordé dans un certain nombre de chapitres, comme celui consacré au musée du Goulag, où l’auteur, après avoir longuement interrogé l’ancienne directrice du centre de documentation du musée, fait très justement remarquer que la muséographie laisse entièrement de côté la question fondamentale : qui est responsable de tout ça ? Une question absente aussi du monument aux victimes des répressions ( Le Mur de l’Affliction) érigé par les autorités en 2017. C’est précisément pour faire remonter « de l’intérieur » le déroulement des répressions dont un citoyen soviétique sur cinq a été victime durant la période stalinienne que Mémorial a lancé, il y a plus de vingt ans, un concours à l’attention des lycéens, dirigé par Irina Scherbakova, L’Homme dans l’Histoire, les lycéens étant appelés à rédiger un texte à partir de documents familiaux sur le sort d’un de leurs proches. Un long chapitre est consacré à cette inititave-phare de Mémorial. Etienne Bouche rappelle à juste titre, qu’en dépit de l’emprise croissante des autorités sur l’histoire, de l’élaboration d’une histoire officielle, une « information alternative » circule sur divers réseaux sociaux comme Telegram ou Youtube. L’immense succès ( plus de 20 millions de « vues ») du film sur la Kolyma de Iouri Doud en est la preuve. Pour autant, cette information alternative reste, globalement, sans effet. Sans doute – telle est l’hypothèse de l’auteur, à cause de l’ extrême fragmentation de la société. Dans les dernières pages de cette enquête, Etienne Bouche cite longuement le sociologue Boris Gladarev, l’un des auteurs d’un ouvrage collectif Syndrome du mutisme public : « La population de Russie continue de subir les conséquences du chaos social caractérisant les sociétés en transition (…) Elle évoque davantage un archipel formé d’une multitude de « communautés-îlots » qu’un « continent social ».
L’ouvrage d’Etienne Bouche est un livre foisonnant où le lecteur fait la connaissance des principaux acteurs ayant marqué, depuis trente ans, Mémorial, tout en obtenant de nombreuses clés d’explication sur cette « maladie de la mémoire » qui caractérise la société russe d’aujourd’hui.
Le Monde, 13 septembre 2023
L'ONG Memorial, ennemie jurée du Kremlin
Par Isabelle Mandraud
Livres Hebdo, septembre 2023
Par Laurent Lemire
En Russie, depuis 1992, une organisation non gouvernementale s’est donné pour mission de faire la clarté sur les victimes de la répression communiste. « Dès sa création, nous dit Étienne Bouche, Memorial avait entendu prendre en charge trois impensés : le travail de mémoire, l’évaluation juridique et la réflexion intellectuelle sur ces crimes. » Cette manière de faire surgir la vérité n’a pas plu au maître du Kremlin, surtout après l’annexion de la Crimée en 2014. La vérité était trop nue aux yeux du tsar. Il fut donc décidé de salir les historiens. Un dossier fabriqué de toutes pièces envoya Iouri Dmitriev devant un tribunal sous l’accusation de pédophilie. Arrêté en 2016, il est condamné à quinze ans de prison en 2021. Au cours du procès qui devait conduire à la liquidation de Memorial le 28 février 2022, quatre jours après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, le procureur a accusé l’association de « réhabiliter des criminels nazis » en donnant une image « mensongère de l’URSS ».
En enquêtant sur Memorial, Étienne Bouche nous livre une analyse subtile des courants qui irriguent la Russie de Vladimir Poutine. Par ses rencontres
avec des intellectuels et des artistes, le journaliste retrace d’une plume agile l’histoire de cette ONG, son travail de mise au jour des crimes du stalinisme et de défense des droits de l’homme. Elle a d’ailleurs reçu pour son action le prix Nobel de la paix en 2022, après son démantèlement. Le reporter, qui connaît bien ce vaste territoire, présente également les trajectoires de ses membres et les persécutions qu’ils subissent. « Le pays est incapable de se projeter dans l’avenir, car il n’a pas réglé ses comptes avec ce passé obsédant. » Alors il fait la guerre. À l’Ukraine mais aussi à l’histoire. L’Église orthodoxe participe à ce grand lessivage mémoriel. Étienne Bouche a élargi son investigation bien au-delà de Memorial pour tenter de savoir ce que pensent les Russes. Et c’est un dénommé Micha qui donne son point de vue crûment sur cette société malade de son histoire. « Je hais tout ce “glorieux passé” qui a transformé le peuple en masse muette, qui nous a privés du droit d’être nous-même, qui nous a ôté la possibilité de nous épanouir, qui nous a foutus dans des quartiers ouvriers
et rendus complètement dépendant du pouvoir. »