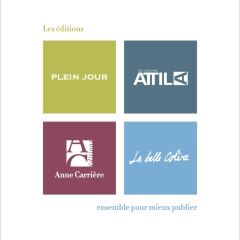En attendant Nadeau, 19 janvier 2022
Enquête sur les enfants invisibles
par Gabrielle Napoli
Menée au début des années 1980, l’enquête de la journaliste britannique Gitta Sereny (1921-2012) auprès d’enfants prostitués en Allemagne de l’Ouest, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui a duré quasiment deux ans et concernait 161 enfants, a été publiée en anglais en 1984. Il aura donc fallu presque quarante ans pour que ce travail remarquable, Les enfants invisibles, soit accessible aux lecteurs français. Gitta Sereny montre qu’elle est une journaliste de tout premier plan.
L’œuvre de Gitta Sereny est aujourd’hui largement reconnue. Ses travaux sur l’Allemagne nazie sont en effet incontournables. Après plusieurs semaines d’entretiens avec Franz Stangl, commandant du centre d’extermination de Treblinka, elle a publié en 1974 le premier grand livre-enquête sur la Shoah, Au fond des ténèbres (traduit en français l’année suivante). Elle a consacré à Albert Speer un ouvrage très documenté et a rassemblé, dans le monumental essai Dans l’ombre du Reich, soixante ans d’enquêtes journalistiques et d’expériences personnelles.
L’autre pan de son œuvre, tout aussi célèbre, est celui qu’elle consacre aux enfants meurtriers (Une si jolie petite fille ou encore La balade des enfants meurtriers). Tout au long de son existence, Gitta Sereny a conservé ces deux lignes de pensée et de recherche, celle de la violence du régime nazi et celle de la souffrance des enfants, les deux se croisant et se nouant tout particulièrement dans Dans l’ombre du Reich.
Ce n’est évidemment pas sans lien avec sa biographie. Alors qu’elle assiste, âgée d’à peine treize ans, au congrès de Nuremberg, elle est littéralement fascinée. Gitta Sereny rappelle dans une note ajoutée à une réédition anglaise des Enfants invisibles que ses engagements après la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle important dans son enquête sur la prostitution enfantine. Pendant l’Occupation à Paris, elle a travaillé auprès d’enfants abandonnés ou réfugiés, mais elle a aussi œuvré après la guerre pour l’UNRRA (ancêtre de l’UNHCR, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) en s’occupant plus spécifiquement, mais pas seulement, d’enfants, notamment ceux qui vivaient dans des camps de personnes déplacées et qu’il fallait alors tant bien que mal faire rentrer chez eux.
Gitta Sereny était une journaliste hors du commun, qui a traversé le XXe siècle en s’impliquant dans la défense des plus vulnérables tout en tentant de cerner ce qui conduit certains individus à sombrer dans le mal. Elle écrit dans l’introduction de Dans l’ombre du Reich : « Ce qui m’a toujours motivée, comme de nombreux autres auteurs de ma génération – une génération qui a connu les deux dictatures les plus dévastatrices de l’histoire du monde –, est la recherche de ce qui entraîne si souvent et si aisément les êtres humains sur la voie de la violence et de l’amoralité. Or, pour moi, la réponse à cette question fondamentale se situe moins dans un registre théorique et intellectuel que sur un plan intime, humain. »
C’est ce travail exceptionnel que nous voulons saluer ici, à l’occasion de la traduction de l’essai consacré à la prostitution des enfants en Occident au début des années 1980, Les enfants invisibles. Le livre est ancien, mais malheureusement le sujet est toujours d’actualité, comme en témoignent les derniers rapports sur la prostitution enfantine en France, qui sont très alarmistes. La méthode adoptée, que Gitta Sereny expose dans une note, est d’une très grande rigueur, à l’image de l’ensemble de ses travaux. Sur les 161 enfants rencontrés, ayant pratiqué occasionnellement ou régulièrement la prostitution, la journaliste a parlé avec 69 d’entre eux plus longuement. Douze d’entre eux apparaissent de manière approfondie dans l’ouvrage. Gitta Sereny détaille les critères selon lesquels elle les a choisis. L’une des conditions était de pouvoir rencontrer leur famille, avec laquelle la plupart d’entre eux ne vivaient plus, ou alors seulement de manière intermittente. Ainsi, les conversations entre la journaliste et les enfants s’éclairent des rencontres avec les familles, du regard de Gitta Sereny sur des parents parfois tout autant brisés que leurs enfants, désemparés, incrédules ou dans le déni. Le livre montre que les familles touchées par la prostitution des enfants ne sont pas majoritairement les plus démunies ou marginalisées, comme certains s’y attendraient, mais que ce fléau touche tous les milieux. Le récit inclut également plusieurs entretiens avec des proxénètes.
La journaliste nous avertit : il ne s’agit ni d’une enquête sociologique, ni d’un rapport, ni de statistiques. C’est d’ailleurs l’invisibilité du sujet qui rend ce travail si ardu et qui fait de chaque rencontre un moment unique et fragile, toujours au bord de la rupture. Le regard que Gitta Sereny porte sur les individus, sans complaisance et jamais surplombant, est pénétrant. Elle réussit à toucher juste, par le mot choisi, par la question posée au bon moment. Les scrupules dont elle fait état ne peuvent que renforcer notre admiration pour son travail : « Je n’ai jamais cessé de douter de mon droit de creuser si profondément dans la personnalité de ces êtres fragiles et vulnérables, cela d’autant plus qu’ils ne sont nullement fermés à l’aide que peuvent leur apporter les adultes désireux de leur tendre la main, et par là si ouverts aux abus. Cependant, sans questions, il ne pouvait y avoir de réponses, ni de compréhension du phénomène. Et sans cadre, des dialogues tels que ceux-ci ne pouvaient qu’intensifier le chaos de leur esprit et de leurs émotions. »
Dans un cadre toujours rigoureux, la journaliste parvient à gagner la confiance de ces enfants âgés de treize quatorze ans, parfois un peu plus. Elle nous fait entendre leurs voix, perdues, amères, douloureuses, nous fait voir les conditions épouvantables dans lesquelles certains d’entre eux se retrouvent, à la merci des proxénètes, prédateurs redoutables, et de clients qui souvent feignent d’ignorer qu’il s’agit d’enfants. La détresse de l’enfance abusée dont elle fait un tableau qui ne peut être qu’effroyable nous rappelle que nous, adultes, nous sommes tous responsables de l’enfance maltraitée, pour ne pas suffisamment la protéger. Gitta Sereny aborde ce que la plupart d’entre nous refusent de voir, notre incapacité à protéger l’enfance, cette phrase que lui lance la jeune Cassie témoignant de cet abandon évident : « Vous pensez que quelqu’un s’en soucie ! », apostrophe que la journaliste a entendue tant de fois dans la bouche de ces victimes : « Car ce sont de jeunes victimes : aucun enfant ne fait délibérément le choix de se prostituer. Ils n’aspirent qu’à être considérés comme des enfants, qu’à être aimés. Il leur tarde d’être des enfants. »
On retrouve au fil des trois parties de l’ouvrage, consacrées successivement aux États-Unis, à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne, des constantes, dans les violences subies, bien évidemment, et dans l’envie que ces enfants ont manifestée, à un moment ou un autre, d’être plus entourés, plus aimés, d’être protégés. Les fugues qui bien souvent précèdent une entrée dans le monde de la prostitution, « La Vie » aux États-Unis, « La Scène » en Allemagne, « Le Jeu » en Grande-Bretagne – autant d’antiphrases pour désigner une descente aux enfers –, traduisent un conflit, un désaccord et surtout le sentiment profond d’être mal aimé. La journaliste met en avant les terribles mécanismes d’autodestruction qui s’enclenchent alors et se révèlent fatals. Ces enfants ont tous cherché l’amour de leurs parents, qui n’ont pas su ou pas pu répondre à cette demande.
La bienveillance dont fait preuve Gitta Sereny lors des entretiens est exigeante comme l’est l’amour véritable. Elle pousse ses interlocuteurs à aller au bout de leurs récits, au risque de souffrir une deuxième fois en racontant les sévices subis, en devenant les témoins d’une enfance sacrifiée. La plupart du temps, ils n’épargnent rien à la journaliste, l’obligeant à réagir, à prendre position. En travaillant à partir des enregistrements, elle note des intonations qui avaient pu lui échapper, un débit qui ralentit, une voix qui blanchit, autant de remarques dont elle ponctue son récit. Si cette lecture est évidemment éprouvante, elle n’en est pas moins nécessaire, nous rappelant combien nous devons exercer sans cesse notre vigilance en tant que parents, éducateurs, adultes tout simplement, et protéger l’enfance comme il se doit. C’est ce qu’exige de nous notre humanité, comme le rappelle Rousseau avec solennité dans Émile ou De l’éducation : « Hommes, soyez humains, c’est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n’est pas étranger à l’homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l’humanité ? Aimez l’enfance. » Et c’est ce que fait Gitta Sereny dans l’ensemble de son œuvre.
Télérama, 17 novembre 2021
Beau geste
par Nathalie Crom
Un ouvrage sur la prostitution enfantine, édifiant, enfin traduit.
De son enquête Au fond des ténèbres (1974) – consacrée à Franz Stangl, le commandant du camp de Treblinka, avec qui elle s’était entretenue à la fin des années 1960, tandis qu’il attendait dans la prison de Düsseldorf le verdict de son procès en appel –, Gitta Sereny (1921-2012) expliquait : « L’intention essentielle de ce livre est de démontrer [...] ce que le manque ou l’absence de courage et de rigueur morale en chacun de nous peut augurer de tragique pour l’histoire des nations et le destin de l’humanité. » L’interrogation sur le courage et la « rigueur morale » – et les séquelles tragiques de leurs défaillances – est au cœur du travail qu’a mené, tout au long de sa vie, la journaliste d’investigation et écrivaine britannique d’origine autrichienne, multi-récompensée pour l’exceptionnelle profondeur et l’implacabilité de sa démarche.
Après Une si jolie petite fille, Les crimes de Mary Bell et La Balade des enfants meurtriers : l’affaire James Bulger, les éditions Plein Jour traduisent Les Enfants invisibles, une enquête au long cours sur la prostitution enfantine que Gitta Sereny a réalisée dans les années 1980, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Rencontrant pour cela cent soixante-neuf enfants, elle s’est attachée plus particulièrement à douze d’entre eux, Cassie, Nellie, Marianne, Alan, Meena..., des adolescents fugueurs, et s’est mise à l’écoute de leur colère et de leur détresse, avec une attention sans complaisance qui ne fait que souligner l’incompréhension et l’insensibilité entourant partout leur sort. Des « enfants invisibles » car exclus des statistiques, devenus la matière première d’un commerce qui mêle prostitution et pornographie – « mais la faute, écrit Gitta Sereny, réside en moi, en vous [...] Elle habite notre siècle, et nos personnes qui, pourtant, au cœur des Lumières, ont [...] créé un mode de vie insupportable pour nos enfants ».
Le Figaro littéraire, 11 novembre 2021
Gitta Sereny à la rencontre des enfants perdus
par Isabelle Spaak
Au début des années 1980, dans une enquête choc, la journaliste et romancière autrichienne stigmatisait la Prostitution enfantine en occident.
Cassie a 15 ans. Elle en avait 12 quand Big Daddy, un proxénète new-yorkais, lui adressa la parole alors qu’elle traînait son ennui dans la petite ville américaine où elle vivait avec ses parents adoptifs. Un couple aisé et aimant mais adepte des punitions corporelles, coups de baguette ou ceinture en cuir. Et ce à partir des 5 ans de leur fille. « On fait ça parce que nous t’aimons, disaient-ils. Ça m’a embrouillée. Je ne savais plus ce que ça voulait dire aimer », reconnaît l’adolescente lorsque la journaliste et écrivain Gitta Sereny l’interroge sur les raisons qui l’ont conduite sur le trottoir de la 11e Avenue à l’angle de la 42e Rue. L’un des quartiers les plus désolés de New York surnommé « l’Évier ».
Lors de cette conversation, Cassie a déjà passé trois ans à se vendre pour six souteneurs différents. Elle a été battue, violée. Comme ceux de Maria, Karen, Anna, Nellie, Ruprecht, Annette ou Alan, son témoignage est terrifiant, sa maturité impressionnante, son désarroi total, ses chances de s’en sortir très minces.
Menée durant dix-huit mois aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre au début des années 1980, l’enquête de Gitta Sereny sur la prostitution enfantine dans le monde occidental est, comme toujours, un modèle du genre.
Dès les premières lignes, l’auteur d’Une si jolie petite fille (Plein Jour, 2014) se positionne. En enquêtrice implacable autant qu’en écrivain. Jamais une once de jugement de sa part mais une réalité crue racontée par la bouche même de ces « enfants invisibles » au nombre de douze parmi les 161 qu’elle a rencontrés. Prostitués réguliers ou occasionnels. Certains parfois juste pour s’offrir des fringues et des entrées en boîte de nuit. Mais la plupart parce qu’ils ont fui leur foyer d’accueil ou parental, du fait de maltraitance, ou se sentant mal aimés ou incompris.
Leurs récits s’entrecroisent à ceux de leurs parents désarçonnés, de leurs éducateurs, de policiers de la brigade des mineurs et même d’un souteneur. C’est la méthodologie Sereny. L’enquête au long cours et par cercle, le croisement des réalités, l’exploration de chaque point de vue, même les plus déviants, les plus durs. Mais surtout la confiance. Celle qu’elle place en ses sujets et celle qu’ils lui vouent. Ce respect mutuel lui permet d’avancer, de confronter.
Les racines du mal
Dans la chronologie des livres-enquêtes de la journaliste d’investigation britannique, Les Enfants invisibles arrive en troisième position d’une bibliographie partagée entre le IIIe Reich et l’enfance en souffrance. Deux volets d’une même obsession : les racines du mal. En 1987 à l’occasion d’une postface, Gitta Sereny (1921-2012) revenait sur le manque d’intérêt des pouvoirs publics vis-à-vis de ces petits êtres vulnérables et en détresse. En leur tendant la main, en faisant entendre leur voix et le chaos qui les habite, elle se donnait pour mission de prévenir ce danger qui guette les familles.
Trente-quatre ans plus tard, malheureusement, Les Enfants invisibles n’ont pas pris une ride. Entre 7 000 et 10 000 jeunes se prostituant ont été dénombrés en France en 2021.
L'Obs, 4 novembre 2021
Mineurs et prostitués
par Didier Jacob
Une des plus grandes journalistes britanniques, Gitta Sereny (1921-2012), ne se démontait pas facilement. Face aux pires proxénètes (on les appelait les « players ») ou aux gamines en rupture qui vivaient dans la rue, et qui lui mentaient la plupart du temps, face aussi à leurs parents qui les avaient souvent maltraitées (raison pour laquelle elles se retrouvaient dans la rue), l’auteur d’Une si jolie petite fille affichait une sérénité sans faille, et continuait d’interroger ses proies jusqu’à obtenir satisfaction. C’est dans les années 1980 que Sereny décide d’enquêter sur la prostitution des enfants mineurs, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Pendant plus d’un an, elle rencontre cent soixante-neuf enfants, filles ou garçons, et en sélectionne plus précisément douze qui vont lui raconter leur vie de maltraitance, de misère et de prostitution. Sans doute les questions de Gitta Sereny reflètent-elles leur époque, mais les témoignages à la fois effarants et poignants de Cassie, de Gaby ou d’Annette pourraient nourrir la réflexion actuelle sur l’esclavage et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Un livre majeur.
Arc Info / Le Nouvelliste / La Côte, 5 octobre 2021
Prostitution infantile : un déni destructeur
par Laurence de Coulon
L’enquête de Gitta Sereny sur la prostitution infantile, « Les enfants invisibles », est publiée pour la première fois en français. Son document effrayant et passionnant date, mais reste d’actualité.
Dans son prologue de 1987, Gitta Sereny écrivait: « Je savais pourquoi je faisais ce livre. Le sujet me consternait, la façon dont il était ignoré par les pouvoirs publics me révoltait. J’étais et je suis toujours certaine que le faire connaître était le seul moyen de con- traindre les autorités à agir ; d’aider les parents à exercer un contrôle plus serré, à percevoir les dangers, les signes annonciateurs chez leurs en- fants; et de permettre aux enfants – qui, je l’espère, liront ce livre à un âge où ils seront capables de le comprendre – d’être avertis de ce qui les attend s’ils sont tentés par ce chemin tragique. »
En lisant son livre, nous sommes partagés entre la douleur face au parcours difficile de ces enfants et l’émerveillement devant le travail de Gitta Sereny, le temps investi, la capacité d’écoute. Son talent d’écriture, aussi. Nous sommes dans la confidence, comme elle, et, avec un temps d’approche, nous apprenons à connaître ces enfants au fur et à mesure.
Des proies vite repérées
Et les confidences sont brutales. Mais un élément frappe, comme il a frappé Gitta Sereny: le besoin d’amour de ces enfants. A 11 ans, 12 ans déjà, après des conflits familiaux devenus insupportables, parfois des violences, des abus, des négligences, d’autres fois une éducation trop stricte, ils ont fugué. A New York, le processus dans les années 1980 était simple: ces proies étaient vite repérées par leurs préda- teurs, des proxénètes qui avaient l’intuition de ce que ces enfants recherchaient : l’amour. Et le leur promettaient, pour mieux les exploiter, exiger des quotas, et souvent, les violenter.
Des faits niés
En Allemagne de l’Ouest, la prostitu- tion infantile se déroule différemment, dans plusieurs villes importantes, de manière visible. Comme elle a discuté non seulement avec 169 jeunes prostituées et prostitués, mais aussi avec de nombreux assistants sociaux et des membres des autorités, Gitta Sereny peut comparer. Là-bas comme en Angleterre, et contraire- ment à New York, la police tendait à nier tout simplement l’existence du phénomène. «Tous savent le risque qu’ils courent si jamais on devait trouver chez eux un mineur, qu’il soit client ou employé. [...] Il est impossible de nous arnaquer», lui répond un policier de Berlin. Tout près de là, dans un peep-show, il faut trente mi- nutes à Gitta Sereny pour apprendre d’une employée qu’elles sont trois à avoir quinze ans ou moins.
Pas de complaisance
Ce n’est que dans sa conclusion que Gitta Sereny s’autorise à condamner de cette manière, même si tout dans sa démarche est toujours moral. Elle donne toute la place aux témoignages de ces enfants, et bien qu’elle ne les juge jamais, n’est pas pour autant non complaisante. Cette situation n’est pas banale et leur fait du mal. Comme elle le dit dans son prologue, elle les a approchés avec l’aide d’assistants sociaux et de médecins et a ensuite passé le relais aux personnes qui pouvaient les aider à se sortir de cette situation. Certains enfants s’en sont sortis, d’autres ont disparu.
Responsabilité des adultes
Dans sa conclusion, elle aborde aussi quelques pistes pour enrayer ce phénomène qui ne devrait pas exister : une meilleure inclusion sociale, de l’aide apportée aux parents démunis, et, comme en Allemagne, des appartements pour les mineurs en fugue qui ne peuvent plus vivre dans leur famille et qui sans cela n’ont d’autres choix que la prostitution. Elle nous permet de réfléchir avec elle à la res- ponsabilité des adultes. La sienne, en tant que journaliste, de ne pas les mettre en danger en dévoilant leur identité. Et celle des parents, sur laquelle elle s’est beaucoup penchée en les rencontrant. Surtout, elle nous a permis de voir Julie, Annette et les autres.
Le Journal du Dimanche, 19 septembre 2021
par Karen Lajon
Gitta Sereny a rencontré 169 enfants âgés de 13 à 17 ans, tous fugueurs et prostitués dans les années 1980, à travers les Etats-Unis, l'Allemagne de l'Ouest de l'époque et la Grande-Bretagne. Son enquête passionnante vient d'être traduite et publier en France.
"De quoi les enfants ont-ils besoin," demande Getty Sereny à la maman de Cassie. "De parler, d'une bonne nourriture, d'éducation, d'une maison et bien sûr de l'amour." De sexe? Je lui ai donné des livres répond la mère, faux rétorque la fille, elle n'a jamais parlé de çà, tellement faux que les parents font chambre à part mais les apparences sont sauves, la famille renvoie une image de bonheur tranquille et c'est tout ce qui compte pour la maman. Tout ce qui vient tordre cette réalité fantasmée est balayé de l'espace mental maternel. Alors il faut parfois punir, le père s'en charge.
La journalistique sort quasiment sa calculette, sur huit ans, on arrive à 200 séances de coups de ceinture. Cassie en rit, s'insurge, non cela ne peut avoir été autant. Plus tard, Gitta Sereny se heurtera à une autre addition, celle de Marianne en Allemagne. 80.000 marks gagnés mais pas touchés entièrement évidemment, divisés par 30 marks par client et vous obtenez 2.666 bonshommes. Sa mère le sait-elle? "Non, elle l'apprendra lorsque j'aurais écrit mon livre lui rétorque Marianne. Si j'ai pu le supporter dans la réalité, elle pourra le supporter en le lisant." Au nom de l'amour, les coups pleuvent, au nom de l'amour on ferme les yeux. Il ne reste qu'une petite expression, "quand cela tourne mal", pour traduire cette stupeur abyssale devant ces sorties de route pourtant basées sur "tant d'amour".
Mais il n'y a pas forcément les coups. Il existe aussi la confusion et l'ambiguïté de certaines cellules familiales comme celle de chez Anna, 13 ans, qui se fait alpaguer par un petit mac à deux balles, Stony, 24 ans, alors qu'elle est là debout à un arrêt de bus. "Il savait". C'est aussi simple que çà, il avait deviné la faiblesse, la proie. Celle qui a subi des attouchements, enfant, la proie idéale selon les critères d'un souteneurs qui n'a pas besoin de diplôme de psychologie pour arriver à ses fins.
D'autant plus facile que la parole d'Anna est niée par la famille et l'entourage. Ce sont des schémas qui se répètent à l'infini, il n'y a pas de découverte majeure dans le livre de la journaliste britannique mais le fait d'avoir pu parler à tous les intervenants concernés donne un ton particulier à l'ouvrage. Et on imagine facilement qu'à l'époque il a dû faire sensation.
[...]
Les confessions d'un proxénète
Slim "le player". On pense à Iceberg Slim qui écrivit un livre choc sur sa vie de proxénète. Il n'est pas dit si c'est le même ou non. Peu importe, les confessions de ce Slim sont captivantes. Pourquoi est-il dans ce business lui demande d'emblée Gitta Sereny. "Le fric, les fringues, les Rolls-Royce, les Bentley, les Cadillacs, toute cette merde." Slim est noir, un élément non négligeable de sa psychologie.
"Étant noir, je n'ai jamais eu beaucoup d'argent et maintenant je peux en avoir." La journaliste est très sensible à la voix, au changement de rythme des ses interlocuteurs, celui de Slim change lorsqu'il parle de ses parents, il accélère alors que quand il parle du job, il prend son temps, il fume d'un air pensif, il fait des ronds avec sa fumée. Il ne prend jamais les Noires "trop de problèmes, elles ne vous donnent pas ce que vous méritez." Tout çà c'est du bidon selon une assistante sociale que Gitta Sereny interroge. "Les Noires connaissent la rue aussi bien que les souteneurs". Alors, pas de blabla, pas de bullshit, le mac veut un pourcentage et elles le savent toutes.
La journaliste rencontre les prostitués de rue et celles que l'on installe dans des bordels légaux comme en Allemage au nom de la "conception du progrès social". Les policiers des mœurs et les assistantes sociales que Marianne désigne non sans un certain humour comme " des boiteux qui conduisent des aveugles". En Ecosse, elle a vu celles prises au piège du "jeu", ces "lassies", très jeunes filles que l'on lâche dans les pattes de vieux pervers en mal de virginité. Et bien sachez que ces enfants invisibles et qui dérangent sont toujours là. L'ouvrage de l'auteur interroge sur cette société qui a produit de telles dérives, il questionne sur le métier de journaliste, il est plus que jamais et tristement d'actualité. Servira-t-il cette fois à quelque chose?
Le Monde, 18 septembre 2021
Enquête sur la prostitution infantile
par Zineb Dryef
A travers des portraits de jeunes rencontrés aux Etats-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne, la journaliste d’investigation britannique Gitta Sereny plonge dans un univers sordide où se retrouvent des adolescents furieusement attachants.
Novembre, années 1980. A l’angle de la 11e Avenue et de la 42e Rue, à Manhattan, il n’y a rien d’autre que des entrepôts fermés et des snack-bars sinistres. C’est dans ce coin sordide de New-York qu’on appelle « L’Evier » qu’apparaît pour la première fois Cassie, aux joues rondes et aux yeux maquillés de bleu, petite blonde de 15 ans qui hantera longtemps le lecteur après qu’il aura fermé Les Enfants Invisibles, de Gitta Sereny. Un livre qui « n’aurait jamais dû exister, puisqu’il parle de quelque chose qui ne devrait pas exister, et dont l’existence est d’ailleurs mise en doute par beaucoup de personnes » : la prostitution des enfants.
Pour mener cette enquête d’ampleur, la journaliste britannique Gitta Sereny (1921-2012) a rencontré 169 enfants âgés de 13 ans à 17 ans, tous fugueurs et prostitués, à travers les Etats-Unis, l’Allemagne de l’Ouest et la Grande-Bretagne. Douze d’entre eux ont accepté de se confier longuement à elle. Cleo, Julie, Alan, Nellie, Annette… et Cassie, qui dit de sa vie qu’elle « ressemblait à un trou » et dont l’urgence, à 13 ans, est devenue d’apprendre à faire jouir les hommes et, « c’est toute la question », à les faire jouir vite. Pour s’en débarrasser et pour atteindre les quotas fixés par Big Daddy, son proxénète.
Violences
Face à cette galerie de portraits d’adolescents furieusement attachants, la défaillance des adultes n’en apparaît que plus révoltante, notamment celle de leurs parents – Gitta Sereny ne se penche que peu sur la responsabilité des institutions de protection de l’enfance. Tous, sans exception, ont été exposés à la violence des adultes et tous ont été esquintés par leur brutalité – victimes d’inceste, de viols, de coups, mais aussi des mots ou de l’indifférence dont on ne se remet pas. Gitta Sereny a cette phrase terrible : « Il existe des enfants – on se déteste de devoir l’admettre – que leur univers familial et leur tempérament prédestinaient à cette vie. » C’est parce qu’ils n’ont plus supporté cette existence que ces enfants se sont effacés. Ils ont fugué. Ils ont volé. Ils se sont mis à se prostituer.
Face à ce choc, la journaliste interpelle : « Où nous sommes-nous trompés dans la hiérarchie de nos priorités et de nos responsabilités pour que les enfants d’une société prospère ne voient rien de mal à vendre leur corps contre un supplément d’argent de poche et, de plus, trouvent un marché tout prêt à les accueillir ? »
Ces gamins, lorsqu’ils s’échappent, deviennent un mystère pour leurs familles. Les parents répètent : « Je l’ai aimé. » « Comme si l’amour expliquait tout, comme s’il justifiait et excusait tout », observe la journaliste. Pourquoi quittent-ils des foyers en apparence confortables ? Par peur, par absence de considération, par dégoût de soi. Comme Julie, que sa mère agonit de « pute, pute, pute » après qu’elle lui a confié avoir été violée et qui finit par y croire : « J’étais devenue une putain » ; ou Cassie, dont les parents lui répètent qu’ils la battent parce qu’ils l’aiment. « Ça m’a embrouillé », remarque la jeune fille.
Aveuglement collectif
On retrouve dans ce texte, paru en 1984 et traduit pour la première fois en France par les éditions Plein Jour, la rigueur et l’humanisme de l’autrice d’Au fond des ténèbres (Tallandier, 2013), une enquête sur Franz Stangl, le commandant de Treblinka, et Une si jolie petite fille (Plein Jour, 2014), sur Mary Bell qui fut condamnée en 1968 pour avoir tué, à l’âge de 11 ans, deux garçons de 3 et 4 ans. L’autrice ne transige jamais avec la vérité, dont la plus dérangeante ici est notre aveuglement collectif.
[...]
Dans la confusion qu’est devenue leur vie, les enfants s’en inventent souvent une : les résidences coquettes de leurs parents deviennent des « palaces » et les après-midi dans les centres commerciaux des vacances à cheval. Le déni leur fait qualifier de « marrants » leurs débuts sur le trottoir. Des fictions patiemment détricotées par la journaliste et une exigence de vérité qui l’a confrontée à des interrogations éthiques difficiles : comment interroger ces enfants sans provoquer un effondrement intérieur ? Comment les préserver des conséquences inévitables de l’introspection ? Comment respecter leurs confidences tout en collaborant avec les médecins, la police, les familles pour les protéger ?
On pense au Journaliste et l’Assassin, de Janet Malcolm, car, en s’attachant à ne rien cacher des doutes qui l’ont traversée, Gitta Sereny livre ici une réflexion passionnante sur le métier de journaliste ainsi que sur la relation si particulière et si ambiguë qui se tisse entre un auteur et son sujet.
Les Échos Week-end, 27 août 2021
Rentrée littéraire : nos 12 coups de coeur
par Alexandre Fillon
Journaliste d'investigation et écrivaine, Gitta Sereny (1921-2012) s'est notamment illustrée avec Au fond des ténèbres, sur Franz Stangl, le commandant de Treblinka, ou une biographie de l'architecte Albert Speer. Les Enfants invisibles date de 1984 et n'avait curieusement jamais été traduit. Gitta Sereny a rencontré 169 enfants entre 13 et 17 ans avant d'en sélectionner douze dans trois pays différents, les Etats-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Tous ont fugué, quitté leurs parents, se sont prostitués pour survivre. Les portraits de ces êtres fragiles et vulnérables brossés par Gitta Sereny sont saisissants. « Ce livre n'aurait jamais dû exister puisqu'il parle d'un sujet qui ne devrait pas exister, et dont l'existence est d'ailleurs mise en doute par beaucoup de personnes », explique-t-elle…
LH Le Mag, Juillet 2021
Jeunesses meurtries
par Laurent Lemire
Dans une enquête bouleversante réalisée à la fin des années 1980, Gitta Sereny plonge dans les rénèbres de la prostitution enfantine.
Gitta Sereny (1921-2012) est une exploratrice des profondeurs humaines. De ces abîmes, elle remonte toujours un bout de vérité qui secoude les esprits. On doit à cette journaliste et écrivaine britannique quelques classiques comme Au fond des ténèbres (Denoël, 1975), une enquête sur Franz Stangl, le commandant de Treblinka, et Une si jolie petite fille (Plein Jour, 2014) sur la jeune Mary Bell qui, à l'âge de 11 ans, a tué en 1968 deux garçons de 3 et 4 ans a Newcastle. À chaque fois, cette investigatrice hors pair fait parler les protagonistes. Ces Enfants invisibles n'échappent pas à sa méthode efficace. Aux États-Unis, Angleterre et en Allemagne, elle est allée pendant trois ans à la rencontre d'enfants fugueurs qui se sont prostitués pour survivre. C'était à la fin des années 1980, les mômes avaient entre 13 et 17 ans.
Dans ces trois pays, elle a longuement interrogé une douzaine d'enfants, mais aussi des proxénètes, des parents, des amis, des policiers qui luttent contre ce commerce et des psychologues quitentent de réparer les dégâts immenses dans ces corps meurtris. Quel que soit le pays, il y a au départ une volonté de quitter un foyer familial qui n'est plus protecteur. Puis survient la rencontre forfuite avec des hommes charmeurs qui jouent la carte du tendre pour masquer leurs intentions. Ces enfants perdus sont enchâinés : Julie violée à 14 ans, Cassie qui commence à travailler pour un noméé Big Daddy à 12 ans [...]. Quand Gitta Sereny les questionne, ils enjolivent leur quotidien, ils lui donnent un peu de couleur pour ne pas montrer à quel point il est sombre [...].
À l'origine de ces situations, on trouve des familles éclatées, mais pas toujours, et des traumatismes enfantins, souvent. Il n'y a pas de règle dans le malheur, justs des exceptions. [...]
L'intérêt de cette enquête, outre le fait qu'elle est, comme toutes les autres, très bien écrite, réside dans cette manière d'aller au-delà du simple fait divers pour élargir le champ d'exploration. Gitta Sereny nous parle de la banalisation de la pornographie et se demande pourquoi des adultes éprouvent le besoin d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. À cela il y a évidemment de multiples réponses, mais comme Franz Stangl ou Mary Bell, on touche à l'indicible, à ces terribles ténèbres qui constituent aussi la nature humaine.
Lire Gitta Sereny, c'est faire cette expérience des limites, avec ce que le journalisme produit de mieux quand il est guidé par des questions et non des réponses. Ces Enfants invisibles d'hier sont aujourd'hui des adultes. Espérons qu'ils ont, en partie grâce à ce livre bouleversant, retrouvé l'apparence des vivants.