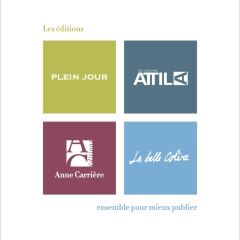Le Monde, 18 juin 2019
« Les Bons Profs » ou la flamme du « passeur de feu »
Par Luc Cédelle
Aymeric Patricot s’appuie sur son expérience de professeur dans le secondaire et sur sa passion de la littérature pour questionner, dans son livre, ce qui fait ou non un « bon » enseignement.
Aymeric Patricot appartient à l’espèce utile à l’intelligence collective des « profs qui écrivent ». Certains ne le font que sur leur expérience d’enseignement, ce qui est déjà appréciable et nourrit le débat public. D’autres, au-delà du vécu ou de l’essai, se situent sur le terrain de la littérature. Lui écrit sur tout. Auteur de plusieurs romans, il a aussi donné dans l’enquête ethnographique avec Les Petits Blancs. Un voyage dans la France d’en bas (Plein jour, 2013), et, auparavant, dans le témoignage avec un Autoportrait du professeur en territoire difficile (Gallimard, 2011), où il rendait compte de ses affres et consternations d’enseignant débutant jeté dans le dur de la banlieue.
Cette fois, la distance parcourue lui fait tenir un propos qui ne doit rien au pittoresque éducatif et tout aux interrogations qu’un professeur à la conscience professionnelle aiguë est conduit à se poser sur son métier en général, et sur sa façon de l’incarner. Cette introspection est maintenue sous tension par l’élégance du style, le goût de la subtilité et la capacité à décortiquer les situations complexes du rapport professeur-élèves.
Elle part de son parcours initial d’élève modèle, bachoteur jusqu’à la névrose, qui, étudiant, se compose un pot-pourri de diplômes tout en parachevant son cursus à HEC. Le futur professeur et écrivain, mû par une pulsion libératrice, va en fait virer de bord et décrocher l’agrégation de lettres modernes, qui lui ouvre les portes de l’enseignement. Il exerce aujourd’hui dans le cadre particulier des classes préparatoires.
« Une énergie folle »
Aymeric Patricot est conscient des limites de cette boucle qui relie le bon élève d’hier à ceux d’aujourd’hui, mais il parvient à les subvertir. S’appuyant sur son expérience et sa passion de la littérature, multipliant les allers-retours entre grands principes et scènes de classe, il développe un questionnement acharné sur ce qui fait – ou non – le bon enseignement. S’il est souvent tenté par la déploration au parfum « réac », c’est un chemin que sa lucidité l’empêche de suivre plus avant. Chez lui, pas de réquisitoire contre le « collège unique ». Et s’il peste contre le règne des « méthodes » et des « compétences » ou encore la mauvaise réputation faite à la dissertation et autres exercices classiques, c’est aussi pour montrer qu’il en a saisi les raisons et qu’il les partage, au moins en partie.
[...]
Marianne, 8 mai 2019
Pressions, convocations... comment #PasDeVague s’est retourné contre les professeurs
Par Anthony Cortes
Alors que la parole des professeurs s'était quelque peu libérée à l'automne dernier avec le hashtag #PasDeVague, des enseignants dénoncent un retour de bâton avec des "pressions" accrues de leur hiérarchie afin de les faire taire.
[...]
"Le problème majeur, c’est la non-définition du devoir de réserve des professeurs", analyse Aymeric Patricot, professeur et auteur de l’ouvrage "Les bons profs" (Plein jour). "Il y a un grand flou autour de cette notion : quand on est enseignant, on ne sait pas vraiment ce que l’on est autorisé à dire et sous quelles conditions. Et je ne suis pas certain que les différents échelons de l'administration le sachent mieux". Bien que la loi du 13 juillet 1983, qui définit les droits et obligations du fonctionnaire, cite notamment "l’obligation de neutralité" comme une règle absolue "dans l’exercice de [leurs] fonctions", elle n’est pas davantage explicitée. D’où l’apparition de conflits, avec des incompréhensions, parfois des abus, de part et d'autre. "Nous avons à la fois l’impression de jouir d’une grande liberté, tout en étant constamment menacés par la possibilité de voir surgir d’éventuels actes d’autorité de notre hiérarchie, comme c'est le cas aujourd'hui, développe le chercheur. Et c’est tout le problème de l’article 1 de la loi Blanquer : il s’inscrit dans la droite ligne de cette ambiguïté qui, finalement, ne fait que prolonger le règne de cette culture du silence qui a la peau dure dans l’Éducation nationale...". Même le hashtag #PasDeVague s'y sera cassé les dents.
France Culture, 4 mai 2019
ELLE, 3 mai 2019
La question de la semaine : Qu'est-ce qu'un bon prof ?
Par Virginie Bloch-Lainé
[...]
Né en 1975, Aymeric Patricot raconte de façon ludique pourquoi il a choisi son métier, et le gouffre d'incertitudes dans lequel il a mariné plusieurs années. Ce fort en thème n'a pas l'âme d'un guerrier, et c'est ce qui le rend si sympathique : à 18 ans, distrait, timide, et assimilant à une tare son attrait pour les livres, il prépare le concours d'entrée des écoles de commerce. Il le réussit. Enfin du concret, de l'action. Seulement il aime la réflexion, si bien qu'il passe l'agrégation de lettres modernes et la décroche. [...] Il lit Bourdieu. Le sociologue peste contre le fameux charisme du professeur qu'il accuse d'être un alibi pour masquer la sélection sociale. [...] Au fil du temps, l'auteur découvre les méthodes qui lui réussissent : ménager des silences, se lancer dans des rapprochements iconoclastes et provocateurs et accepter la fécondité de l'échec. Il ressort de ce viatique que les bons profs sont ceux qui avancent avec des doutes en bandoulière. Comme les bons parents ?
France Culture, 24 avril 2019
RFI, 15 avril 2019
Le Journal du Dimanche, 23 mars 2019
Comment devient-on un bon prof ?
Par Marie Quenet
Alors que se tient dimanche la finale du prix mondial de pédagogie, le gouvernement lance sa réforme de la formation. Mais au fait, c'est quoi un bon prof?
[...]
Mieux vaut aussi maîtriser sa discipline. "Que ce soit au collège, au lycée, en BTS ou à Sciences-Po, ils apprécient qu'il y ait un minimum de savoirs", constate Aymeric Patricot, qui intervient en classe préparatoire. Son dernier livre, Les Bons Profs (Plein jour), pointe deux critères : "Un bon enseignant doit d'abord être efficace mais aussi avoir du charisme, de l'humanité, pour incarner un personnage qui dépasse la matière enseignée."
[...]
Les études internationales confirment l'importance du facteur humain. Au Canada, par exemple, un pays bien classé dans l'étude Pisa comparant les systèmes éducatifs au sein de l'OCDE, la bienveillance fait partie des missions de l'enseignant.
[...]
Mais la formation devrait changer. La réforme engagée pour fixer un cadre national homogène prévoit de renforcer la place des fondamentaux (lire, écrire, compter, etc.), de s'appuyer sur la recherche et de multiplier les modules consacrés aux valeurs de la République. Elle vise aussi à rapprocher théorie et pratique. Un tiers du temps de formation sera désormais assuré par des enseignants en exercice. Tandis que le prérecrutement et l'évolution de la place du concours devraient permettre d'entrer plus progressivement dans le métier.
Il faudra aussi progresser en matière de formation continue. Dans ce domaine, la France est en retard : jusqu'à trois jours et demi par an au collège, contre huit dans l'OCDE (cent heures à Singapour, numéro un du palmarès Pisa !). Mais le gouvernement vient juste d'ouvrir le chantier.
[...]
La Croix, 19 mars 2019
Propos recueillis par Paula Pinto Gomes
La Croix : Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire un livre sur les « bons » profs ?
Aymeric Patricot : J’avais déjà écrit un premier livre en 2010, qui portait sur la question des banlieues ou, plus précisément, sur le premier contact du professeur quand il débarque dans des collèges difficiles. C’était d’ailleurs plutôt un récit, dans lequel je montrais le contraste entre une jeunesse enseignante assez protégée et ces réalités sociales. Après quinze ans d’exercice, j’ai sans doute éprouvé le besoin de faire le point sur le sens du métier aujourd’hui et sur ce qu’il m’a apporté.
Ce travail vous a-t-il permis de saisir ce qu’est un bon pédagogue aujourd’hui ?
A. P. : Ce n’est évidemment pas facile de répondre à cette question car il y a autant de publics que de classes et chaque professeur est différent en fonction des publics. Malgré tout, je dirais qu’un bon pédagogue aujourd’hui doit réunir deux qualités principales. La première c’est l’efficacité. Dans un système de massification scolaire, où à peu près tout le monde passe le bac et suit des études supérieures, l’angoisse du chômage induit une pression de plus en plus forte sur les enseignants pour qu’ils soient efficaces. Malgré tout, on attend aussi d’un bon enseignant qu’il ait du charisme, qu’il soit humain. On ne peut pas tout réduire à la préparation d’examens.
Vous dites que le prof est devenu un rouage dans un système, certes plus égalitaire qu’autrefois, mais qui a renoncé à l’idée d’émancipation par la connaissance, et dont le principal objectif est de faire des élèves « employables ». Ce pragmatisme ne va-t-il pas à l’encontre de votre vison du professeur passeur de feu ?
A. P. : J’enseigne en classe préparatoire, j’assume donc ce côté machine à produire des bons résultats, mais s’il n’y avait que ce côté, ce serait un peu désespérant. Faire des relevés de compétences comme je l’ai vu en BTS avec des référentiels de chiffres, de lettres, par dizaines, est absurde. On parle d’êtres humains.
Pour moi, un prof doit avoir trois ambitions : l’ambition humaniste, celle de Rabelais, de Rousseau et d’autres qui est d’élever les élèves ; l’ambition citoyenne, qui est un peu plus politique, et l’ambition économique qui consiste à insérer les jeunes dans le monde du travail. Le côté « rouage », c’est cette troisième dimension, mais il reste la première qui est la plus belle et à laquelle tiennent tous les enseignants.
Vous parlez de misère existentielle du prof, de solitude... Votre métier est-il vraiment le plus beau du monde ?
A. P. : On le dit souvent, mais j’essaye de montrer dans ce livre que c’est aussi un peu compliqué. C’est un métier répétitif. On passe parfois trente ans dans le même établissement parce qu’il y a très peu de mobilité. On vieillit alors que les élèves, eux, restent les mêmes, on les forme à la vie, alors que nous, au fond, on ne connaît pas le monde. Et puis, le prof est seul. La collaboration avec les collègues n’est pas le cœur du métier et il est peu soutenu par son administration. Sans compter que le métier s’est prolétarisé et que l’image du prof s’est dégradée dans la société.
Quand vous dites « peu soutenu » c’est un euphémisme, dans votre livre vous parlez de chape de plomb...
A. P. : Oui, l’affaire « pas de vagues » [suite à l’agression d’une enseignante à
Créteil, NLDR] m’a frappé. C’est exactement le sujet de mon premier livre, les violences dont les profs étaient victimes mais qui étaient taboues parce qu’il ne fallait pas stigmatiser certains
territoires. Je peux le comprendre, mais lorsque ce réflexe aboutit à une omerta totale, c’est un problème. Là, le mouvement est parti d’enseignants assez jeunes et le plus étonnant c’est qu’ils
ont surtout été recadrés par les syndicats qui ont été les premiers à dire « oui mais ce n’est pas si grave, n’exagérons rien ».
Parler des violences faites aux profs est un tabou très ancré parce que le prof, au fond, symboliquement, se sent du côté des élèves. Ce sont eux qu’il aime. Lorsqu’il se fait agresser par
l’un d’eux, il n’a pas envie de le dénoncer parce qu’il est là pour l’aider.
Il y a une forme de culture du silence de leur part, c’est clair, d’autant que l’administration est très hiérarchisée et que le prof n’est pas forcément là pour dire ce qui ne va pas.
[...]
Le Point, 19 mars 2019
« Les syndicats ont étouffé le mouvement #PasDeVague »
Propos recueillis par Émilie Trevert
Dans « Les Bons Profs », l'écrivain et enseignant Aymeric Patricot livre une réflexion personnelle sur « le plus beau métier du monde ».
Un scaphandre sur la tête relié à une bouteille d'oxygène, il corrige sans relâche ses copies. En apnée et sous pression. Si le dessin de couverture du dernier livre d'Aymeric Patricot est un peu caricatural, le propos, lui, est plutôt nuancé et intelligent. C'est un objet rare et hybride, à la fois récit personnel d'une vocation tardive et réflexion générale sur le métier d'enseignant. Un métier – s'il en est un – « à la fois beau et un peu angoissant », résume l'auteur de Les Petits Blancs, qui enseigne les lettres en classe préparatoire. Celui qui avait déjà dépeint ses premières années de jeune prof de banlieue dans Autoportrait du professeur en territoire difficile (2011) prend le temps, à 44 ans, de faire un « bilan à mi-parcours », après quinze ans dans l'enseignement. Ni plaintif ni donneur de leçons, ni pédago ni réac, il tente de sonder « l'atmosphère » de la profession et de réfléchir à son essence alors que de nombreuses réformes sont en cours et que la violence au quotidien ne faiblit pas. [...]
Cet ancien timide et « cancre à l'envers » (comprendre très, très bon élève) se demande encore 15 ans après comment il a « échoué là », lui qui ne voyait que « misère » dans cette profession avant de s'y jeter à corps perdu. Certes, le métier comporte son lot de frustrations pouvant entraîner parfois des dépressions (il compare le prof à « un Sisyphe
pathétique, sans même le corps d'un héros »), mais Patricot a découvert avec l'expérience ses avantages : rester branché, grâce aux jeunes, à « une sorte d'énergie fondamentale » et ne jamais vraiment entrer dans l'âge adulte. Quel privilège !
C'est quoi être un « bon prof » pour vous ?
Aujourd'hui, avec le système de massification scolaire, le prof doit être perçu comme efficace. Il y a une grosse pression parce que le marché du travail est tendu. Les nouvelles générations attendent que le prof prépare efficacement aux examens et aux concours. C'est une pression beaucoup plus forte qu'il y a 30 ans, un impératif des parents et du système. Les profs pas efficaces ont tout de suite une mauvaise image. Mais, si le prof n'était qu'efficacité, ce serait désespérant... Il faut qu'il ait une dimension humaine, charismatique.
Vous pensez, contrairement à Bourdieu, que le charisme est nécessaire pour faire passer une leçon. Mais les profs charismatiques ne sont-ils pas en voie d'extinction ?
Non. C'est d'autant plus indispensable d'être charismatique aujourd'hui que le système est devenu plus dur. Pour qu'un prof devienne un peu plus humain, il y a toute une série de qualités à travailler.
Par exemple ?
Certains profs que j'ai pu croiser à la fac donnaient l'impression de se confondre avec leurs sujets, ils rayonnaient parce qu'ils avaient l'air d'être l'esprit même de la matière. J'ai remarqué que l'on pouvait admirer des profs aussi parce qu'ils vivaient leur métier comme un sacerdoce. Les élèves respectent la figure du prof sérieux qui est là pour eux. D'autres profs, encore, ont un certain charisme parce qu'on leur prête une vie hors des murs.
Cela vous a-t-il servi ou desservi d'être écrivain ?
Le prestige du livre peut encore jouer, mais à la marge. Je ne me présente jamais comme un écrivain. En général, ils me googlisent et ça les amuse ou les intrigue. Curieusement, alors que les élèves ne lisent plus, écrire des livres impressionne encore.
À côté des profs que les élèves admirent, il y a pléthore de profs que les élèves méprisent. Certains finissent par avoir une attitude démissionnaire...
Malheureusement, oui. J'évoque une qualité essentielle pour être prof : l'énergie. Et il en faut pour affronter une classe de 30 élèves. Je pense que l'âge peut compter. Dans tous les établissements, on connaît des profs un peu usés. Il y a un moment, ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour transmettre. La jeunesse est une des qualités du prof. J'évoque dans le livre un « âge idéal » du prof à mi-parcours, vers 45 ans. Encore un peu dans l'improvisation, son cours ne s'est pas complètement fossilisé ; il a encore de la fraîcheur, mais plus de maturité.
Dans certaines classes, même avec beaucoup d'énergie, le prof n'est plus respecté. Vous l'avez sans doute connu au début de votre carrière en « territoire difficile ».
C'est un problème plus général de baisse de considération que l'on voue au professeur. L'aspect économique n'est pas négligeable. Dans l'esprit des élèves, le prof s'est prolétarisé, il n'est pas forcément respecté par les parents ni par l'administration. Le prof souffre d'avoir une image un peu dégradée. Cela ne dépend pas que de lui si son autorité naturelle s'est érodée. Et, dans les établissements difficiles, oui, on a longtemps sous-estimé la violence qui s'y développait, la misère économique et culturelle.
Avez-vous été surpris par le mouvement #Pasdevague après qu'une enseignante a été braquée par un élève à Créteil, en octobre 2018 ?
C'était le sujet de mon livre en 2010, ce n'était pas évident d'en parler à l'époque. J'étais content que ça éclate, mais j'ai été estomaqué par la réaction des syndicats qui ont étouffé le mouvement dans l'œuf. Les syndicats ne sont pas toujours du côté des profs... Il y avait des profs qui, tout à coup, osaient briser l'omerta et des syndicats qui, derrière, récupéraient le mouvement en disant qu'il ne fallait pas exagérer, que globalement les élèves étaient sympas... Il y a aussi des phénomènes institutionnels qui incitent le prof à se taire, à ne pas trop ruer dans les brancards.
Comment expliquer cette culture du silence ?
Les profs veulent préserver leur réputation et ils subissent un rapport hiérarchique très strict : un prof n'a pas à critiquer son administration. En fait, le prof se comporte un peu comme un élève, il se tait. Autre raison : les profs n'accablent pas leurs élèves ; pour eux, leur métier c'est de les aider. Il y a 10 ans, une de mes collègues a été braquée à la sortie du lycée et ne s'est jamais plainte. Le prof se considère comme un adjuvant de l'élève. S'il le tape, il ne va pas agresser l'élève en retour. Il est plutôt du côté de l'élève contre le monde adulte. Il y a une pudeur du prof qui ne veut pas enfoncer l'élève en difficulté.
L'article 1 de la loi sur l'école de la confiance rappelle aux professeurs leur devoir d'exemplarité. Certains y voient une volonté de les museler. Et vous ?
Je m'étonne que la loi Blanquer commence par ce chapitre sur l'exemplarité. Au moment où les profs ont envie de s'exprimer, on leur rappelle qu'ils doivent plutôt se taire ! C'est un peu surprenant. Alors qu'au contraire il faudrait peut-être leur donner plus la parole.
[...]
TV5 Monde, 17 mars 2019
Valeurs Actuelles, 7 mars 2019
Le professeur doit-il apprendre à se taire ?
Par Aymeric Patricot
Enseignant en classe préparatoire, Aymeric Patricot est l’auteur de plusieurs romans et essais, dont "Les bons Profs" (Plein Jour, mars 2019). Alors que le projet de loi de Jean-Michel Blanquer sur “l'école de la confiance” a été adopté fin février, il estime que, "le professeur apprend à devenir le plus discipliné des élèves, lui dont le rôle est pourtant, si l’on se réfère aux ambitions humanistes du métier, d’enseigner les rudiments de la liberté."
En dépit de la sympathie que m’inspire Jean-Michel Blanquer, je redoute parfois de saisir la logique profonde de ses réformes. Et la loi tout juste adoptée par le Parlement n’y fait pas exception. Comment comprendre, notamment, cette notion d’ « exemplarité des personnels de la communauté éducative » contenue dans le premier article, notion qui fait déjà beaucoup parler d’elle et dont on annonce qu’elle pourra être invoquée dans le cadre de mesures disciplinaires ? Faut-il y voir, comme beaucoup, une volonté d’intimider les professeurs à l’heure où la réforme du lycée suscite des protestations ? Il s’agirait de rendre effectif ce fameux devoir de réserve aux contours jusqu’à maintenant si flous et qui interdirait désormais de dénigrer l’institution scolaire « par des propos diffamatoires ».
A moins qu’il ne s’agisse d’un gage donné aux élèves et aux parents d’élèves pour mieux leur faire accepter la deuxième partie de l’article, ce respect que l’institution scolaire attend d’eux, et dont on souligne souvent le redoutable affaiblissement. Dans un même mouvement, Blanquer chercherait ainsi à « responsabiliser », comme il le dit lui-même, les professeurs et les parents, de manière à retrouver le chemin d’un exercice plus serein du métier.
Il reste cependant permis de s’étonner que cette nouvelle exigence pesant sur le professeur survienne quelques semaines après le vaste mouvement « PasdeVague », où les professeurs se plaignaient déjà de l’omerta qu’ils subissaient de la part de leur administration. Combien de violences passées sous silence depuis des années, depuis des décennies ? Combien d’humiliations minimisées, relativisées, finalement tues, sous prétexte de ne pas envenimer les choses mais pour mieux contenir, en réalité, la révélation d’une dégradation spectaculaire des conditions d’exercice ? Par le miracle de l’anonymat sur internet, la parole se déliait enfin. Peut-être attendait-on, par conséquent, un signe de compréhension de la part du gouvernement plutôt que cette défiance vis-à-vis de la liberté d’expression.
Quoi qu’il en soit, cette curieuse façon de commencer par exiger quelque chose du professeur au moment même où l’on déclare vouloir instaurer la confiance me paraît assez révélatrice du statut paradoxal de la parole dans le métier, statut dont je me plais à décrire les raffinements dans « Les bons Profs ».
En effet, le professeur est l’objet d’une injonction paradoxale. D’un côté, on lui demande de maîtriser l’art de la parole, d’en déployer avec force les effets devant son public ; on lui demande même d’éveiller chez l’élève une passion comparable. De l’autre, on exige de lui qu’il contribue au bon fonctionnement d’une institution par nature très hiérarchisée puisque tentaculaire et, qui plus est, hantée par le principe d’autorité. Par conséquent, au cours de sa carrière, le professeur devra surtout apprendre à se taire, du moins à canaliser sa parole. Non seulement il comprendra l’importance des silences dans son propre cours, non seulement il se retiendra de révéler certaines difficultés sous peine de ternir sa propre réputation, mais il devra surtout apprendre à jouer le jeu de cette hiérarchie que lui-même instaure dans la classe. D’une certaine manière, le professeur apprend à devenir le plus discipliné des élèves, lui dont le rôle est pourtant, si l’on se réfère aux ambitions humanistes du métier, d’enseigner les rudiments de la liberté. Au fond, l’article 1 de la nouvelle loi ne fait-il pas qu’entériner l’un des aspects fondamentaux de ce paradoxe ?