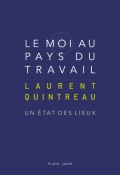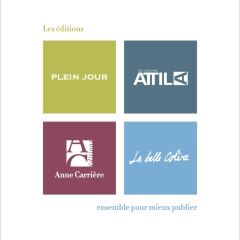Médiapart, 23 février 2016
Laurent Quintreau ravive le «moi» au pays du travail
par Rachida El Azzouzi
Laurent Quintreau s'est nourri de son expérience de syndicaliste pour raconter « le moi au pays du travail » à l'ère du chômage de masse et du délitement des relations professionnelles. Un récit vif et enlevé.
Cadre et syndiqué, évoluant dans le monde de la publicité (Publicis) où il coordonne le syndicat Betor-Pub CFDT, Laurent Quintreau a fait de l’entreprise sa source d’inspiration. Quand il ne travaille pas ou ne défend pas un salarié, il écrit des romans qui parlent des « moi » au travail, cette diversité humaine et émotionnelle d’égos qui se débattent dans le « monde du travail », rouages essentiels à la machinerie économique et sociale, passant de l'extase à la panique, au stress, à l'ennui, au désespoir. Il se fait la voix d'hommes et de femmes pris entre l'infini du désir et le principe de réalité, écrasés par le collectif, tétanisés par la peur du licenciement, victimes du libéralisme débridé et de ses concepts déshumanisants, entre « optimisation », « process » et « flux ».
En 2006, Laurent Quintreau avait marqué les esprits avec Marge brute (Éditions Denoël), un « roman de bureau », traduit depuis en douze langues. (...) Dix ans plus tard, il interroge toujours ce point commun entre la vendeuse, le clerc de notaire, le garçon de café, le plombier, le cadre : « Le moi au pays du travail », cette fois, pour en livrer un état des lieux, aux éditions Plein Jour. « Pas pour construire une réalité chiffrée et statistique sur le bonheur ou l’horreur salariale, mais pour raconter cette multitude de moi aux prises avec un réel que domine un enchevêtrement touffu d’injonctions technologiques et financières implacables, souvent absurdes, parfois cocasses. »
Esprit, janvier 2016
Le Moi au pays du travail
par Richard Robert
Les lecteurs d'Esprit se souviennent sans doute de quèlques pages saisissantes de Laurent Quintreau publiées dans le dossier « Peut-on raconter le chômage ? », en novembre 2014. On les retrouve, retravaillées et insérées au sein d'un ensemble plus ample, dans ce magnifique petit livre consacré à ce qu'on pourrait décrire comme des états limites de la condition salariée : les moments de bascule où le statut craque, le corps se brise, la volonté cède, où la subordination inscrite dans la relation de travail se révèle domination.
La presse, spécialisée ou non, s'est depuis longtemps penchée sur ces petits drames sociaux que sont l'annonce d'un licenciement, la découverte d'une maladie professionnelle, ou plus récemment des situations critiques comme le harcèlement ou le syndrome d'épuisement professionnel (burn-out). Mais le regard du journaliste peine à saisir ce qui se joue dans ces drames, quand il n'est pas voilé par les affects ou les représentations propres aux salles de rédaction. On s'y retrouve rarement. L'expérience vécue est vite recouverte par les propos des « experts » (souvent des psychologues), et le récit proprement dit n'est jamais qu'une reconstitution au second degré, souvent empathique, mais rarement exacte.
La littérature, quand d'aventure elle s'intéresse au social ou au monde du travail, peine à convaincre, elle aussi. François Bon (Sortie d'usine, Minuit, 1982) ou Thierry Metz (Journal d'un manœuvre, Gallimard, 1990) avaient il y a quelques décennies donné des oeuvres fortes, où le travail écorchait l'écriture. Il est aujourd'hui recouvert par des fictions qui l'escamotent ou le travestissent. (...) Aux nombreuses fictions qui fleurissent chaque année sur ce thème, quelque chose manque : une connaissance intime de l'expérience relatée, articulée à une réelle intelligence de la situation.
C'est précisément cette articulation qui donne au livre de Laurent Quintreau sa force et sa justesse. Sauf une ou deux exceptions, les récits qui scandent son livre sont tirés de son expérience personnelle de conseiller du salarié. Ce sont des « choses vues », certes retravaillées, mais qui ont été vécues avant d'être écrites. Tout comme le conseiller tient son rôle et veille à ne pas se mettre à la place du salarié, l'auteur assume une position de témoin qui impose une très rigoureuse éthique de l'écriture : Laurent Quintreau observe, note, mais s'interdit rigoureusement d'aller au-delà de ce qui est dit, de ce qui est montré. Pas de focalisation interne : on ne sait pas, on ne saura pas ce que pensent, ce que vivent les héros de ces histoires, hormis ce qu'ils en disent ou ce que leur corps signale.
Cette façon d'écrire au plus près, sans jamais prétendre se mettre à la place de son personnage, s'appuie sur une extrême attention à l'autre. Quand le conseiller du salarié « ne devrait jamais se départir d'un état émotif faible, non marqué, non empathique, sur lequel le salarié puisse s'appuyer », l'auteur de son côté s'engage plus vivement dans l'expérience et ouvre la porte à l'émotion - la sienne parfois, celle du lecteur toujours, car ces récits sont des coups de poing dans l'estomac.
Ainsi s'établit une circulation entre les affects des salariés (devinés, souvent confus, parfois isolés sous forme de verbatim), ceux du conseiller (tenus sous clé), puis du narrateur (laissés un peu plus libres) et au final ceux du lecteur, qui bénéficie de la prudence d'un auteur ayant retenu la leçon de Hemingwav et de Camus. À nous, lecteurs, de nous débrouiller avec une charge émotive qui nous est communiquée sans effets de manche. L'éthique du conseiller, celle de l'écrivain, qui tiennent en laisse leurs affects, font de cette lecture une expérience humaine extrêmement forte.
Ce travail d'écriture à basse intensité permet la circulation de l'émotion, maîs surtout donne accès à une réalité à peine dégagée de sa gangue de brutalité peu intelligible. Car la confusion règne : les hommes et les femmes qui sont pris dans ces drames tournent en rond, s'égarent, se perdent, littéralement, dans une situation qui les dépasse.
« Quand la peur guide chaque geste et tient lieu d'unique mode de pensée, il n'existe aucune justice possible, pour la simple et bonne raison que le sujet susceptible de faire valoir ses droits n'existe plus. »
Cette disparition du sujet rendrait vain tout essai d'en rendre compte à la première personne : le salarié, incapable ici de se faire plaignant, est confiné dans un en-deçà de la personnalité juridique, et de la personnalité tout court. Il s'efface. Un romancier serait bien mal inspiré de prétendre se mettre à sa place. Seul un témoin assumant son rôle de tiers peut, à défaut de faire surgir et de porter sa parole (le salarié s'est enfermé dans un « mutisme contrarié »), attester sa présence et son humanité.
L'éthique de l'écriture s'impose ainsi comme une façon de rendre justice à la personne en la prenant en considération. Plusieurs récits montrent la manière bouffonne ou cruelle de dénier la personnalité : séminaire de leadership dans l'Ariège à base de grotesques « jeux de rôle », rapports de séduction et de harcèlement dans le milieu de la mode... Cette entreprise de dépersonnalisation renvoie à un autre évidement, celui du travail vidé de sa substance pour être réduit à des chiffres, des durées et des coûts. Des coûts qu'on peut tuer, puisque ce ne sont plus des gens. Contre ce double mouvement de négation de la personne et de son travail, l'écnture érige un fragile rempart, quèlques paragraphes qui tentent de faire vivre une présence.
Précis et retenu dans ses récits, attentif à ne pas trop en dire, Laurent Qumtreau ne s'interdit pas, hors champ, un propos plus réflexif, pour mettre en perspective les scènes qui rythment son livre. L'écriture adopte alors un régime différent, nourri de références et d'une connaissance plus experte, celle du dirigeant syndical CFDT ayant à cœur de ressourcer son engagement militant dans des lectures. Les neuf chapitres de l'ouvrage (écho discret aux neuf cercles de l'enfer de Marge brute, son premier roman) sont ainsi introduits par des réflexions qui éclairent les éclats du réel et lui donnent un sens. Mais les silences des principaux acteurs et ceux du narrateur en disent bien davantage encore.
Alternatives économiques, janvier 2016
Le Moi au pays du travail
par Sandrine Foulon
On peut décrire les évolutions du monde du travail avec des chiffres et des courbes, Laurent Quintreau a choisi des tranches de vie. L'auteur de l'excellent roman Marge brute (Denoël), syndicaliste et dirigeant de Bétor-Pub (CFDT), illustre avec finesse comment le « moi au travail » tente de se frayer un chemin dans la grande fourmilière professionnelle (...). Mais ici, point de méchants exploiteurs ni de victimes désignées. Du serveur de restaurant sanguin que la gérante ne peut plus supporter, en passant par une cost-killeuse de La Défense qui ne comprend pas pourquoi les gens passionnés ne pourraient pas travailler jour et nuit si ça leur chante, Laurent Quintreau dessine une réalité complexe. Drôles, ciselés, bien écrits, riches de références philosophiques, ces portraits révèlent des rapports sociaux qui « se modifient de maniere désagréable » et un univers où le collectif se reduit à peau de chagrin.
CFDT Magazine, novembre 2015
Petits portraits et grandes réflexions
On le connaît, Laurent Quintreau. Le secrétaire général du Bétor-Pub CFDT a aussi le talent d'écrire, et franchement bien. On vous a parlé de ses romans, trois à ce jour. Cette fois, le syndicaliste se frotte à l'essai avec Le Moi au pays du travail. Il y dresse une série de portraits de salariés, parfois au bord du drame, parfois frisant le comique, touchant à la philosophie et quelquefois poétique, le tout emballé par la plume d'un véritable écrivain. (...) Il appelle parfois à la rescousse des Roland Barthes, Sigmund Freud ou Marcel Duchamp, qui l'aident, et nous aussi, à pénétrer ce si cher monde du travail. À lire absolument.
Philosophie Magazine, novembre 2015
Le Moi au pays du travail. Un état des lieux
par Philippe Garnier
« Dans ce contexte, il n’y a ni bons ni méchants, mais des rapports qui se modifient de façon désagréable » : c’est ainsi, de façon très spinoziste, que Laurent Quintreau définit les conflits dans le monde du travail. Responsable syndical, chargé des secteurs de la « nouvelle économie » à la CFDT, il est amené à intervenir pour assister les adhérents dans leurs relations avec l’employeur. Témoin et acteur de ces confrontations, tantôt belliqueuses, tantôt pacifiques, il les met en scène dans Le Moi au pays du travail. Auteur de plusieurs romans dont l’inoubliable Marge brute, qui décrivait un conseil d’administration sur le mode de L’Enfer de Dante, Laurent Quintreau conjugue de façon inattendue l’expertise, l’humour et le talent littéraire.
En une cinquantaine de courts récits, il fait apparaître des personnages extrêmement variés (...). Introduites par de courts aperçus philosophiques — « Quand mes désirs rencontrent l’ordre du monde », « Le Grand Autre », « Le règne de la démesure » — ces saynètes présentent une réalité plus subtile et plus riche que la plupart des fictions. Couvrant un champ très vaste à partir d’un certain de nombre de dysfonctionnements ou de pathologies, ce livre nous fait mesurer la métamorphose culturelle qu’a subie aujourd’hui « le travail », agrégats d’activités extrêmement diverses où la vie intime apparaît toujours plus réquisitionnée. C’est une croyance collective en une rédemption, pourtant ingrate, que l’auteur a entrepris de décrire.
Comment rester dans le combat sans renoncer à l’analyse ? Tel est le défi relevé par Laurent Quintreau. Dans un contexte social et politique sans cesse plus tendu, où le bagage de la philosophie et des sciences humaines risque d’être mis à mal, ce petit livre apparaît comme un manifeste pour une pensée complexe en période de crise.
Nonfiction.fr, 15 octobre 2015
Empêchements, fascinations et mécanismes de défense du moi au travail
par Jean Bastien
L'auteur se livre dans cet ouvrage à une exploration de la manière dont le travail affecte la subjectivité, en procédant à partir d’une trentaine de récits d’hommes et de femmes (un tiers de femmes seulement, mais le Bétor recouvre des métiers à forte prédominance masculine) qu’il a pu recueillir, soit comme conseiller du salarié, soit en assurant, avec d’autres, la permanence juridique de son syndicat, voire en distribuant des tracs en bas des tours de La Défense, ou encore au travers d’entretiens sollicités pour élargir le champ de son étude en termes de secteurs économiques et de métiers.
Une telle démarche a plus souvent été entreprise s’agissant d’une situation particulière, comme celle de perte d’emploi par exemple, ou sous la forme d’enquêtes quantitatives, comme celles sur le bonheur au travail, mais dont on peut penser qu’elles laissent dans l’ombre certaines dimensions que capte plus facilement le récit. (...)
Ici, pas de théorie à l’arrivée, mais une série de regroupements en trois parties de trois chapitres chacune, qui montrent ainsi successivement, pour la première, "L’asymétrie du cadre", des
désirs contrariés (se reposer, pouvoir s’occuper de son enfant, être augmenté, poursuivre ou reprendre des études), des manières de se laisser envahir par son travail (adhérer
sans distance à une image valorisante du métier, confondre les sphères privée et professionnelle ou tout simplement confondre sa vie avec son travail) ou encore différentes façons de se
retrouver sans travail et sans rien (du fait de la maladie, d’un chef qui vous a pris en grippe, d’un accident ou encore d’un licenciement économique).
Pour la seconde, "Prisonniers des process", de nouvelles formes d’aliénation aux outils de gestion (logiciels informatiques, méthodes de réduction des coûts, systèmes
de reporting ou encore systèmes d’autorisation et de mot de passe), des formes de démesure où tombe l’économie lorsqu’elle ne connaît plus de limites, lorsque que celle-ci se propose
de développer ou reconfigurer à son profit la personnalité de ses employés, lorsqu’elle promeut et organise l’ineffectivité du droit du travail (car il n’est pas besoin de
« simplification » pour cela, agiter la crainte de représailles ou dissuader de se former tout collectif permettent d’atteindre le même effet) ou encore lorsqu’elle prône une surveillance
omniprésente, obsessionnelle de chaque salarié, et enfin différentes manières de surmonter pour les sujets un accident du travail ou une maladie professionnelle : reconversion ou non,
révision radicale de son investissement au travail ou non.
La troisième et dernière partie, "Les utopies nécessaires", explore différentes manières de rompre avec ces situations (ou les mécanismes de défense que peut faire émerger le moi comme les définit
l’auteur). Tout d’abord, en s’engageant pour changer le travail, quitte à ce que ce soit en rêve uniquement, pour les nostalgiques de la révolution prolétarienne, ou, plus concrètement, en
adhérant à une coopérative de production ou encore en se syndiquant et œuvrant sur le terrain pour améliorer les conditions de travail et faire reconnaître les droits des salariés. Ou bien en
changeant radicalement de vie, même si ce n’est qu’en rêve, là encore, comme ce couple qui souhaiterait reprendre un jour une ferme, ou en vrai, en se mettant à son compte ou en acceptant de vivre de
petits boulots en marge du système économique ou encore en devenant prof de yoga (comme ce salarié rencontré par l’auteur). Ou enfin, une catégorie plus surprenante à première vue, en se
satisfaisant de ce que l’on a, que cela traduise un goût particulier pour le bonheur, une disposition poétique, une renonciation à la carrière ou une valorisation des relations humaines au sein
d’un collectif dévalorisé. (...)
On sort de ce livre avec la conviction que ce que le travail fait au sujet mérite de retenir toute notre attention et qu’il faudrait ainsi se préoccuper davantage de cette question lorsqu’on traite de l’évolution nécessaire des organisations de travail ou des formes du dialogue social, ce qui, par les temps qui courent, suffit à en faire un livre dont il faut recommander la lecture.