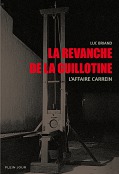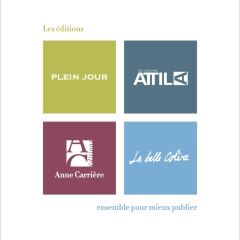France Inter, 2 mars 2018
Dans le prétoire
par Corinne Audouin
"Jérôme Carrein ou la revanche de la guillotine", à écouter ici
Le Courrier Picard, 18 février 2018
Autopsie de l'avant-dernier meurtre légal
par Tony Poulain
Luc Briand rend compte du contexte dans lequel Jérôme Carrein fut l’avant-dernier guillotiné de France.
La postérité n’a pas voulu de Jérôme Carrein, l’avant dernier guillotiné de France, en 1977 à Douai. Pas question d’excuser l’inexcusable ! Jérôme Carrein a bien commis un crime horrible, le 27 octobre 1975, entre Arleux et Palluel, dans ce pays d’étangs près de Douai. L’ouvrier au chômage, sujet à un alcoolisme massif, a attendu la petite Cathy, 8 ans, à la sortie de l’école. Sous prétexte d’aller pêcher des vifs pour le brochet, il l’a conduite au bord de l’eau. Là, il a tenté de la violer, puis, alors qu’elle voulait s’enfuir, l’a étranglée et l’a noyée dans la vase.
Dégringolade
Luc Briand, 40 ans, conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais originaire des Hauts-de-France, n’excuse pas : il explique. Il détaille la dégringolade de Carrein, élevé au jaja depuis ses premiers travaux des champs, à 14 ans, la tuberculose, la violence, les emplois que l’on ne garde pas, la femme qui se fait cogner, qui trompe puis expulse, les nuits dans les granges, l’invariable tournée des cafés, dont celui de Fernande, la mère de Cathy. Dans son épatant petit livre, il rend surtout compte du contexte dans lequel Jérôme Carrein fut l’avant-dernier guillotiné de France, le 23 juin 1977, à Douai. Carrein est d’abord condamné à mort, le 12 juillet 1976, devant les Assises du Pas-de-Calais (département du lieu du crime, Palluel) à Saint-Omer. Après avoir plongé dans les archives, Luc Briand dit tout de cette journée funeste, entre la pression populaire (même le maire communiste d’Arleux avait signé la pétition réclamant la mort), l’intransigeance de l’avocat général, la maladresse de l’accusé. À l’époque, on n’interjetait pas appel d’une décision du peuple souverain. Coup de chance, pour un vice de procédure, l’avocat de la défense obtient une cassation. Las, le second procès est délocalisé à... Douai, capitale judiciaire du Nord, à cinq kilomètres d’Arleux. Surtout, l’audience s’ouvre le 31 janvier 1977, onze jours après que Robert Badinter, a sauvé la tête de Patrick Henry – ravisseur et assassin d’enfant – à Troyes. La France, non seulement a peur, mais elle est divisée. [...] Une frange de la magistrature entend que le verdict de l’Aube ne fasse pas jurisprudence. Pauvre type parmi les pauvres types, certes détenu modèle (et abstinent) mais toujours aussi peu expressif, Carrein fera bien l’affaire, quand bien même d’autres ont fait pire et ont sauvé leur tête. C'était il y a quarante ans, seulement. Briand rappelle à juste titre que le droit de tuer n’a pas si facilement disparu des us et coutumes républicains. Il fut aboli sous Mitterrand le 9 octobre 1981 et inscrit dans la Constitution par Chirac en 2007.
France Inter, 15 février 2018
Affaires sensibles
par Fabrice Drouelle
"Affaire Carrein : les derniers jours de la guillotine", à écouter ici
L'Express, 14 février 2018
La revanche de la guillotine
par Jérôme Dupuis
Qui connaît le nom de Jérôme Carrein ? Personne ou presque. Il est pourtant le dernier Français à avoir été guillotiné. C'était le 23 juin 1977. Mais c'est comme si son destin avait été totalement occulté par celui de Patrick Henry, jugé quinze jours plus tôt, et qui échappera, lui, à l'échafaud. Luc Briand, [...], a décidé de retracer le destin de ce guillotiné inconnu. Issu d'une famille pauvre du Nord, alcoolique précoce et tuberculeux, Jérôme Carrein part plutôt mal dans la vie. Un jour d'octobre 1975, à Palluel, une petite ville du Pas-de-Calais, ce "vagabond" étrangle et noie atrocement une fillette de 8 ans, Cathy Petit. Il sera jugé par deux cours d'assises. Peine de mort chaque fois. La force du récit implacable de Luc Briand est de montrer la disparité de traitement entre le cas Carrein et le cas Patrick Henry. Ce dernier, accusé lui aussi d'un meurtre d'enfant, est issu de la petite bourgeoisie et sera défendu par le ténor du barreau Robert Badinter. Il s'en sortira avec la perpetuité. Carrein, lui, sera jugé dans un silence médiatique assourdissant. Le récit des dernières heures de ce condamné à mort, nourri par les confidences du fils du bourreau, est glaçant. On y apprend par exemple que les gardiens de la prison avaient disposé des couvertures devant sa cellule pour qu'il ne puisse pas entendre les pas de ceux qui viendraient le chercher, à l'aube, pour son exécution. Un livre beau et triste comme une nouvelle de Maupassant.
Europe 1, 2 février 2018
Hondelatte raconte
par Christophe Hondelatte
"Jérôme Carrein, l'avant-dernier guillotiné", à écouter ici
Le Canard Enchaîné, 31 janvier 2018
Coupé en deux
par Dominique Simonnot
Il avait enlevé et assassiné un enfant. Au procès de Patrick Henry, en janvier 1977, la foule hurle : "À mort !" En vain. "C'est la fin de la peine de mort", prédit alors un célèbre chroniqueur judiciaire. Erreur. La lame s'abattra encore deux fois.
Procureur de son état, Luc Briand a enquêté sur l'affaire Jérôme Carrein, tueur d'une fillette, qui, un an après Henry, sera condamné à être "coupé en deux", et le fut. Pourquoi ? Briand a rencontré tout le monde : voisins, familles, magistrats, avocats. Jérôme Carrein est un pauvre type, dépressif, alcoolique, "minable", qui implore le pardon. Certes, mais rien n'aurait pu l'épargner. Pas même un Robert Badinter, car la cour et les jurés vont, sur lui, se venger de Patrick Henry. La grâce présidentielle ? Inutile d'y songer, les élections approchent, pas question de les perdre pour le "minable" Carrein. Giscard baisse le pouce. En excellent conteur, Luc Briand le démontre : "la mise à mort est une passion française". Hélas...
RTL, 24 janvier 2018
L'Heure du crime
par Jacques Pradel
"L'Histoire du dernier guillotiné de nationalité française : Jérôme Carrein", à écouter ici
LeParisien.fr, 21 janvier 2018
L’affaire Carrein ou « la revanche de la guillotine »
Propos recueillis par Pascale Égré
Le sort de l’avant-dernier guillotiné de France s’est joué peu après celui de Patrick Henry, raconte Luc Briand dans un récit passionnant.
« A l’aube de ce jeudi 23 juin 1977, la guillotine est dressée dans la cour de la maison d’arrêt de Douai-Cuincy, à deux mètres à peine de la porte du bâtiment : il faut que le chemin soit le plus court possible pour un prisonnier marchant, les pieds entravés, vers l’engin qui va le couper en deux. »
Ainsi commence le livre que Luc Briand, par ailleurs magistrat, consacre à l’histoire de Jérôme Carrein, 36 ans. Cet ouvrier devenu vagabond, deux fois condamné à mort pour l’enlèvement et le meurtre d’une fillette de 8 ans le 27 octobre 1975 à Palluel (Pas-de-Calais), fut l’avant-dernier guillotiné de France. Lorsque son second procès s’ouvre début 1977, Patrick Henry, lui aussi assassin d’enfant, défendu notamment par un certain Robert Badinter, vient d’échapper à la peine capitale aux assises de l’Aube. Le verdict de mort prononcé à Douai marque « la revanche de Troyes » et « des partisans du châtiment suprême », soutient l’auteur. La grâce de Carrein sera refusée par le président Valéry Giscard d’Estaing.
Fondé sur un dossier criminel épais « d’une quinzaine de centimètres » et sur des entretiens avec des acteurs de cette affaire (dont le juge d’instruction, sa greffière et le fils du bourreau), ce récit passionnant plonge le lecteur dans « la vie chaotique » et misérable d’un criminel au destin oublié. Il l’emmène des rues d’Arleux, où vivait la fillette, au marais de Palluel, où Carrein noya l’enfant après avoir voulu la violer. Il l’emporte au coeur du procès, dans la cellule du condamné, et jusqu’au pied de la guillotine. Dans une autre époque de la justice et d’un pays divisé entre partisans et adversaires de l’abolition. Entretien.
Comment vous êtes-vous intéressé à l’affaire Carrein ?
Luc Briand. Je suis né à cent kilomètres de Douai le 11 juin 1977, douze jours avant l’exécution de Jérôme Carrein. Je me suis toujours interrogé : comment une société déployant tous ses moyens pour aider quelqu’un à naître pouvait aussi déployer tous ses moyens pour trancher une tête ? Et je ne comprenais pas : pourquoi lui ? Quand d’autres criminels aux affaires bien pires durant ces années-là avaient échappé à la guillotine.
Qui était Jérôme Carrein ?
Il est un enfant d’ouvrier, né en 1941, dont le destin ne se distingue pas de cette génération du « baby-boom ». Il arrête tôt ses études, travaille à la ferme puis dans le bâtiment. Il se marie jeune, devient le père de cinq enfants. Il mène une vie normale jusqu’à ce que, en raison de l’alcool, et sans doute d’une dépression, cette personnalité à la dérive tombe dans la spirale du crime. Un crime marqué par l’absurdité : il enlève une enfant devant tout un village, repasse devant le café de sa mère…
Un dossier criminel épais de 15 cm : étiez-vous surpris ?
Oui, stupéfait ! Quand je suis arrivé au comptoir des archives de Lille, je m’attendais à plusieurs cartons, j’ai vu arriver une chemise ! Aujourd’hui, le moindre dossier pénal de vol atteint quasi la même épaisseur. Ce qui est frappant également, et m’a fait réfléchir sur la procédure actuelle, c’est que je me suis demandé : « Qu’aurais-je pu faire de plus ? » Réponse : « Rien ». Je n’aurais pas fait mieux que le juge d’instruction de l’époque. Comme il me l’a dit : techniquement, l’affaire est simple, les faits reconnus. C’est humainement que le dossier est difficile, car comme il l’a pensé en voyant arriver Carrein, c’est « un aller simple vers la guillotine ».
L’affaire Carrein marque « la revanche de la guillotine » : c’est-à-dire ?
Toutes les pièces du dossier Carrein, tous les articles de presse de l’époque, font le lien avec l’affaire Patrick Henry (ndlr : condamné à la perpétuité pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, défendu par Robert Bocquillon et Robert Badinter, il est mort en décembre 2017). Le comportement des acteurs de son second procès, après la cassation, est guidé par le procès qui s’est déroulé douze jours auparavant. Les réquisitions de l’avocat général, la plaidoirie de la défense, qui s’inspire de celle de Badinter : tous s’y réfèrent.
Carrein, jugé à un autre moment, aurait-il sauvé sa tête ?
Cela reste difficile à dire parce qu’il a commis le pire des crimes. Lors de son procès, il se défend mal, il n’a pas les mots. Il agace ses jurés, qui ont aussi des vies difficiles, par une tendance à l’apitoiement sur lui-même… Je pense - et c’est une des leçons de cette affaire- qu’il aurait peut-être sauvé sa peau s’il avait été défendu différemment. Je suis opposé à la peine de mort de façon très nette. Et mon métier de juge m’a appris m’a aidé à penser les deux côtés d’une personnalité. Je reste convaincu que, s’il avait fallu faire un choix, et malgré l’horreur de son crime, Carrein ne méritait pas ce verdict de mort.
Lemonde.fr, 19 janvier 2018
par Franck Johannès
C’est un petit livre tout à fait passionnant : son auteur, Luc Briand, conseiller à la cour d’appel d’Aix, est le premier à s’être intéressé à un condamné à mort parfaitement méconnu, Jérôme Carrein, décapité en 1977 pour le meurtre d’une fillette, deux ans plus tôt dans le Pas-de-Calais. C’est l’avant-dernier guillotiné de France – et le dernier de nationalité française. (...)
Son exécution s’explique largement par le contexte du moment. Son crime, et la peine de mort, sont sans doute la conséquence « des pulsions d’un individu fruste, alcoolique, indique Luc Briand, mais c’est aussi, en définitive, celle de l’institution judiciaire qui devait absolument, quelques jours après un procès médiatique à l’issue duquel Patrick Henry, assassin cynique d’un enfant de sept ans, avait sauvé sa tête devant la cour d’assises de Troyes, démontrer que cette décision ne signifiait pas que l’on ne condamnerait plus à mort dans notre pays ».
André Giresse, président de la cour d’assises de Paris de 1975 à 1985, souligne dans Seule la vérité blesse. L’honneur de déplaire (Plon, 1987) la frénésie de condamnations à mort qui touche alors les cours d’assises pendant l’année 1981. Huit peines capitales sont prononcées d’octobre 1980 à juin 1981, et une autre tombe à Colmar le 28 septembre 1981, alors que le projet de loi abolissant la peine de mort est alors en discussion au Parlement.
« Pour les accusateurs de Carrein, il importait de montrer que le procès de Troyes n’avait été qu’un viol des consciences, explique Luc Briand, par lequel de belles âmes avaient réussi à sauver un assassin qui méritait la mort plus que quiconque. C’est cette anomalie qu’il convenait de réparer au plus vite, afin de ne pas fragiliser plus encore le principe du châtiment suprême. En somme, pour que la peine de mort continuât à vivre, il fallait que Jérôme Carrein meure. »
L’auteur a retrouvé le juge d’instruction chargé de l’affaire, les gendarmes chargés de l’enquête, et même le fils du bourreau qui a assisté à l’exécution. Il raconte l’entrevue glaciale de l’avocat de Carrein avec Valéry Giscard d’Estaing, le chef de l’Etat, opposé à la peine de mort sur le plan personnel mais pas sur le plan professionnel. Qui a d’ailleurs interdit au magistrat de consulter les archives sur le recours en grâce qu’il avait refusé.
Luc Briand décrit en passant comment la peine de mort a été abolie en Grande-Bretagne – longtemps après la Suède (en 1921), le Danemark (en 1933), l’Italie (en 1947) ou l’Allemagne (en 1949). A Londres, Timothy Evans, 25 ans, est pendu le 9 mars 1950 à la prison de Pentonville, dans la banlieue de la capitale, après l’assassinat de sa femme Beryl et de sa fille Geraldine, âgée de 1 an. Il avait dit à la police que sa femme avait été tuée par un voisin, qui avait proposé ses services pour la faire avorter clandestinement d’un deuxième enfant et lui avait fait boire un liquide abortif. Quant à sa fille, ledit voisin l’aurait convaincu de lui confier en attendant que l’affaire se tasse.
Evans n’avait convaincu personne, et il avait suffi de quarante minutes à la cour criminelle de Londres pour le condamner à mort. Or lorsque le voisin – un certain John Christie – déménage trois ans plus tard, on découvre dans sa cuisine les corps de trois femmes, puis en fouillant l’immeuble, les cadavres de trois autres. Il a avoué en garde à vue le meurtre de la femme d’Evans, avant d’être pendu à son tour le 15 juillet 1953. L’affaire a secoué le Royaume-Uni, la peine de mort a été suspendue en 1965, et abolie par le Human Rights Act du 9 novembre 1998.
France 3 Hauts de France, 19 janvier 2018
20 minutes, 19 janvier 2018
propos recueillis par Gilles Durand
En octobre 1975, Jérôme Carrein tue Cathy Petit, 10 ans, à Palluel, un village du Pas-de-Calais, près de Douai. Avec La Revanche de la guillotine, Luc Briand, magistrat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, revient sur cette affaire oubliée qu’il met en parallèle avec une autre, beaucoup plus médiatisée : le crime de Patrick Henry qui a focalisé, à la même époque, le débat sur la peine de mort. Il raconte sa première expérience d’écriture à 20 Minutes.
Quel est le point de départ de ce livre ?
Je me suis toujours demandé pourquoi un Etat, qui déploie autant de moyens pour aider les enfants à naître, peut montrer le même acharnement pour exécuter des condamnés à mort. Je tente aussi d’expliquer pourquoi notre pays a conservé la peine de mort aussi longtemps, alors que nos voisins l’avaient aboli.
Pourquoi choisir l'affaire Carrein, qu'on a oubliée ?
Le contexte de cette affaire est passionnant. Le crime de Jérôme Carrein a lieu en 1975, quelques mois avant que Patrick Henry n’assassine Philippe Bertrand, un enfant de 7 ans. Lors de son procès, en 1977, Patrick Henry échappera à la guillotine. Quinze jours plus tard, Jérôme Carrein sera condamné à mort. Ce sont ces destins parallèles qui m’intéressaient pour évoquer la problématique de la peine de mort. D’autant que je suis né en juin 1977, douze jours avant la date de l’exécution de Carrein, qui est la dernière personne de nationalité française à avoir été guillotinée. C’était à Douai. (...)
A vous lire, Carrein aurait été "victime" de la clémence vis-à-vis de Patrick Henry ?
Robert Badinter estime que si Patrick Henry avait été condamné à mort et exécuté, Jérôme Carrein aurait peut-être échappé à la guillotine par une sorte de lassitude du président, à la pensée de ces têtes coupées, l’une après l’autre, en moins d’un an.
Quel est votre sentiment ?
Entre l’affaire Carrein et l’affaire Henry, légalement, on est sur la même échelle : un crime sur un enfant. Mais moralement, elles sont différentes : on trouve chez Patrick Henry, un assassinat de sang-froid guidé par l’appât du gain et chez Carrein, une pulsion sous l’effet de l’alcool.
Dans le dernier chapitre, vous décrivez minutieusement l'exécution. C'est un plaidoyer contre la peine de mort ?
Justement non. Je ne voulais pas le construire comme ça. Je voulais raconter comment se passe une exécution à travers les yeux de plusieurs protagonistes pour que chacun puisse se forger sa propre opinion.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre qui comporte beaucoup de travaux de recherche ?
J’ai commencé en 2012, en travaillant chaque année, quelques jours ou quelques semaines. J’ai consulté le dossier de Carrein aux archives départementales, à Lille. Je suis allé en Alsace pour rencontrer le juge chargé de l’affaire, mais aussi à Paris pour recueillir le témoignage du fils du bourreau. Il avait assisté son père lors de l’exécution. Je me suis rendu aussi à Arleux, près de Douai, où habitait la famille de la fillette assassinée. J’ai interrogé une quinzaine de personnes, en tout.
Vous regrettez de ne pas avoir pu interroger le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing ?
Oui, bien sûr. J’aurais aimé qu’il m’explique pourquoi il a choisi de ne pas accorder la grâce présidentielle. Mais je respecte son choix. Gracier quelqu’un tient tellement du ressort de l’intime et de la conscience personnelle. (...)
Pensez-vous que la majorité des Français soient hostiles à la peine de mort, aujourd'hui ?
Je pense qu’il n’y aurait plus un juré pour appliquer la peine de mort. Il y a une distorsion entre les avis qui sont donnés sur les réseaux sociaux et le travail que je vois dans les jurys. La concentration et l’implication des jurés sont impressionnantes dans les procès d’assises. Il faut se prononcer sur un cas concret en ayant toutes les données en main. C’est différent d’un avis général qu’on donne sur Internet.
Quelle expérience tirez-vous de l'étude du dossier Carrein ?
Ce travail m’a aidé à mettre en perspective les dossiers à quarante ans d’intervalle. On s’aperçoit que la défense était moins protégée à l’époque, les avocats moins présents. Il y avait moins de recours. On sent le changement d’époque.
La Voix du Nord, 18 janvier 2018
« La revanche de la guillotine » revient sur l’affaire Carrein
propos recueillis par Bertrand Bussière
Pourquoi Jérôme Carrein et pas Patrick Henry ? Luc Briand répond à la question dans La Revanche de la guillotine qui paraît ce vendredi : le sort de Carrein n’a pas passionné les foules. Le dernier condamné à mort dans la région a eu la tête tranchée dans la plus totale indifférence.
« On ne peut être que contre la peine de mort lorsqu’on a vécu une expérience comme la mienne (…) J’ai été honteux de le voir aller au supplice légalement. » Début septembre 1981, alors que l’abolition n’a pas encore été votée par les députés, Me Pierre Lefranc, l’avocat de Jérôme Carrein, dit à La Voix du Nord son dégoût. Quarante plus tard, Luc Briand, conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, revient sur cette affaire dans un livre, son premier : La Revanche de la guillotine. Le magistrat fait le parallèle entre le procès de Patrick Henry qui « tiendra la France en haleine » et le procès de Jérôme Carrein dont le dossier d’instruction fait « quinze centimètres d’épaisseur ».
Pourquoi ce livre ?
Je suis né à Amiens le 11 juin 1977, soit douze jours avant l’exécution de Carrein. Comment peut-on donner la vie ici, l’enlever là-bas ? Rien n’avait été écrit sur cette affaire jusqu’ici.
Que vous inspirait Jérôme Carrein ?
Je n’avais pas de regard préconçu sur cet homme. Qu’ai-je découvert ? Un ouvrier qui fait l’affaire auprès de ses différents employeurs, qui se resocialise en prison… Mais aussi un être violent avec ses proches, prompt à s’apitoyer sur son sort, n’arrivant pas à échapper à sa dépendance à l’alcool… Ce qui m’a surpris, c’est que je n’imaginais pas que dans les années soixante-dix la communauté était capable de détourner les yeux sur un homme à la rue (après sa séparation avec son épouse, au moment du meurtre, Jérôme Carrein vivait dans une grange à Arleux). Cet homme-là était au plus bas de l’échelle sociale.
Une affaire oubliée…
Non. Les gens s’en souviennent. Ça reste dans un coin de la mémoire des policiers, des gendarmes… Heureusement, personne n’a été stigmatisé.
Le fils du bourreau a accepté de vous parler…
Ce qui m’a frappé, c’est la normalité qui se dégage de ses actes. Il sort la guillotine et va couper la tête de quelqu’un. Et il retourne au travail, comme si de rien n’était.
Vous avez rencontré Robert Badinter.
À l’époque, l’avocat Robert Badinter (il défendra et évitera la mort à Patrick Henry et par la suite à cinq autres condamnés) n’a pas pris publiquement la parole. Ça ne se fait pas de porter la parole quand un confrère est dans une affaire. S’il avait été sollicité, il l’aurait prise. Son sentiment est que la peine de mort était une loterie.
La société actuelle est-elle abolitionniste ?
On ne trouverait plus de jury d’assises pour donner la peine de mort. Il n’y aurait plus de majorité. Dans le monde, la peine de mort est en régression constante (106 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, 7 l’ont aboli pour les crimes de droit commun et 29 respectent un moratoire sur les exécutions). (...)
Daily Nord, 17 janvier 2018
“À l’époque, l’avant-dernier condamné à mort, Jérôme Carrein, n’intéresse personne”
propos recueillis par Nicolas Montard
Luc Briand, magistrat à Aix-en-Provence et natif d’Amiens, signe La Revanche de la guillotine. L’affaire Carrein. L’ouvrage revient sur l’exécution de Jérôme Carrein pour un crime commis à Arleux il y a quarante ans. À l’époque, l’auteur des faits avait été l’avant-dernier condamné à mort en France en raison d’un contexte particulier. Interview de l’auteur.
DailyNord : Comment un magistrat d’Aix-en-Provence se retrouve-t-il à écrire son premier livre sur l’affaire Carrein qui se déroule à Arleux ?
Luc Briand : Peut-être parce que je suis né à Amiens le 11 juin 1977. Soit quelques jours avant que l’on guillotine Jérôme Carrein. J’ai toujours été circonspect face à une société qui aide à naître et qui, dans le même temps, pouvait se permettre de reprendre la vie. De plus, à ma grande surprise, en dehors d’articles de presse dans des journaux ou des hors-séries, rien n’a jamais été écrit sur cette affaire. C’est quand même le dernier guillotiné de nationalité française sur notre territoire, et l’avant-dernier de l’histoire (Hamida Djandoubi a été le dernier guillotiné en France, le 10 septembre 1977, NDLR).
DailyNord : Jérôme Carrein a été guillotiné, alors que dans l’échelle de l’horreur, d’autres criminels y ont échappé à la même époque pour des faits semblables, voire plus atroces, soulignez-vous dans votre livre…
Luc Briand : Oui. Ou ils étaient condamnés et ensuite graciés. Longtemps, la mère de Jérôme Carrein ressassera ce qu’elle estimait comme une injustice aux gens qu’elle rencontrera. Le contexte a joué dans l’affaire Carrein.
DailyNord : Justement, quels sont les éléments qui conduisent à sa condamnation à mort ?
Luc Briand : Nous sommes dans un procès dicté par une certaine émotion. Quelques jours plus tôt, il y a eu le procès de Patrick Henry (qui a enlevé et tué Philippe Bertrand, un enfant de 7 ans, NDLR). Il n’a pas été condamné à mort, ce qui entraîne beaucoup de commentaires et réveille les partisans de la peine de mort. (...)
Le Monde, 17 janvier 2018
L'affaire Carrein ou la "guillotine de la misère"
par Pascale Robert-Diard
Jérôme Carrein, ce nom ne vous dit rien ? Il vous hantera longtemps après avoir refermé les pages de La Revanche de la guillotine. On ne lâche pas un instant l’histoire de ce semi-vagabond du Nord, meurtrier d’une gamine de huit ans, qui a été condamné à mort le 1er février 1977, douze jours tout juste après le procès de Troyes, où Robert Badinter et Robert Bocquillon avaient sauvé la tête d’un autre meurtrier d’enfant, Patrick Henry. Car il y a bien plus que l’histoire d’un homme dans ce récit, il y a celle du pays, de ses peurs et de ses contradictions en ces années 1970 où la France se déchire entre partisans de la peine de mort et abolitionnistes. D’un dossier criminel « d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur » fermé par « une mince ficelle de corde », l’auteur, Luc Briand, qui est aussi juge, a fait un grand livre.
Le 27 octobre 1975, à Arleux près de Douai, Jérôme Carrein, 34 ans, a pris la main de Cathy, à la sortie de l’école. « Dis à ta mère qu’on va chercher des vifs au fossé d’Aubigny », a-t-il dit au frère de la petite. Cathy a suivi sans crainte, elle connaissait bien Carrein, père divorcé de cinq enfants qui venait chaque jour manger et boire, surtout boire, au bistrot que tenait sa mère. Ils ont cheminé ensemble jusqu’aux marais, la petite avait l’air tranquille diront plus tard les témoins. Jérôme Carrein est rentré seul au bistrot un peu plus tard, il a commandé une bière au comptoir. La mère de Cathy lui a demandé : « Ben la ch’tiote ? Elle est où ? – La ch’tiote ? Elle est pas revenue ? – Non ! – Moi, je l’ai laissée au petit pont. »
Le corps de l’enfant a été retrouvé le lendemain matin, dans un étang. Carrein a tout avoué. Il avait tenté de la violer, Cathy s’était débattue, il avait eu peur qu’elle le dénonce, il l’avait tuée en maintenant sa tête dans la boue. L’enquête est vite bouclée et le premier procès de Carrein s’ouvre le 12 juillet 1976, devant la cour d’assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. (...) Après une journée de débats et une petite heure de délibéré, Jérôme Carrein est condamné à avoir la tête tranchée.
Les verdicts ne sont alors pas susceptibles d’appel. Mais une erreur du président de Saint-Omer dans la formulation des questions posées à la cour et aux jurés entraîne la cassation de la condamnation. Revoilà Jérôme Carrein dans le box des assises, le 31 janvier 1977, à Douai. Le verdict de Troyes est alors dans toutes les têtes. En accordant à Patrick Henry des circonstances atténuantes qui le font échapper à la guillotine pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, âgé de sept ans, la cour et les jurés de l’Aube « ont, de fait, aboli la peine de mort en France » veut croire son avocat Robert Bocquillon.
L’avocat général Louis Le Flem appartient à cette part la plus répressive de l’institution qui voit dans le verdict de Troyes un véritable « séisme judiciaire » et surtout, un insupportable aveu de faiblesse de la part de la cour et des jurés. Le procès de Carrein doit donc être pour lui « la revanche de Troyes » note Luc Briand.
Dès l’ouverture des débats, Louis Le Flem met en garde les jurés contre les « bons apôtres » abolitionnistes. Face à l’avocat général, le modeste avocat de Carrein, Me Pierre Lefranc, peu familier des audiences criminelles, ne fait pas le poids. Racontée par Luc Briand, sa plaidoirie en défense est un crève-cœur. L’avocat tente de reprendre les arguments de Robert Badinter contre la peine de mort. Mais là où le verbe de son illustre confrère avait pétrifié les jurés, « les mots de Lefranc se perdent dans le brouhaha. Ce n’est pas que les juges et le public manifestent de l’hostilité, c’est bien pire : ils regardent ailleurs et ne l’écoutent pas alors qu’un silence religieux avait accompagné les réquisitions de l’avocat général. » Une heure à peine après être partis délibérer, la cour et les jurés reviennent dans la salle d’audience. A la question des circonstances atténuantes, ils ont répondu « non ». « Tout le monde a compris, sauf Carrein, qui tourne la tête à gauche et à droite en demandant : “Quoi ? Quoi ?”. Son avocat doit se pencher vers lui pour lui expliquer le verdict. » C’est la mort. Le public applaudit.
Il ne reste à Carrein qu’une dernière chance, la grâce présidentielle. Mais un an plus tôt, Valéry Giscard d’Estaing a refusé de l’accorder à un condamné autrement célèbre, Christian Ranucci, qui criait son innocence dans le meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla. Me Lefranc est reçu à l’Elysée le 12 mai 1977. Le président l’écoute, pose quelques rares questions, et le reconduit poliment à la porte de son bureau. Commence alors l’attente. De sa cellule à Douai, Carrein écrit à sa mère : « Si je dois mourir, je voudrais que ce soit demain, car je vis comme les cochons. Je suis derrière une grille, on me donne à manger par une trappe, on va m’engraisser et après me tuer. » Fin juin 1977, Valéry Giscard d’Estaing signe la décision qui, selon la formule rituelle, laisse « la justice suivre son cours » contre le vagabond du Nord. L’exécuteur en chef des arrêts criminels Marcel Chevalier n’a plus qu’à prendre la route de Douai, en train, avec ses deux assistants, pendant que les bois de justice cheminent sur un camion. Ce sera leur avant-dernière sortie avant leur remise définitive. A la mère de Carrein, qui demande comment se sont déroulés les derniers instants de son fils, un surveillant pénitentiaire répond : « On l’a attrapé, le couteau a glissé et c’était tout. On l’a bien lavé, bien nettoyé et on lui a mis la tête entre ses mains et ses jambes, tout habillé. »
Le Point, 14 janvier 2018
par Jérôme Béglé
(...) Patrick Henry a eu beaucoup de chance ! En janvier 1976, il enlève et tue à Troyes Philippe Bertrand, un enfant de sept ans. Grâce à la vibrante plaidoirie de son avocat Robert Badinter, il échappe à la peine de mort. Patrick Henry avait un quasi double maléfique... mais, lui, malchanceux. Le 27 octobre 1975, Jérôme Carrein enlève et tue dans le Pas-de-Calais Cathy Petit, une enfant de huit ans. Il est guillotiné en juin 1977 au terme de deux procès (...). Patrick Henry écopera de la prison à perpétuité deux semaines après la condamnation à mort de Carrein. C'est cette incroyable similitude chronologique et criminelle aboutissant à deux sentences si différentes qui fait le sel de La Revanche de la guillotine, un livre froid et direct comme un coup de poing. L'auteur, un magistrat de 40 ans, a refait l'instruction et le procès, rencontrant les rares témoins de l'époque. Carrein cumule toutes les circonstances aggravantes : marginal, SDF, alcoolique, faible d'esprit, atteint de la tuberculose, enfant perturbé, violent avec sa femme dont il est séparé, incapable de conserver un emploi... Il est la victime idéale d'un châtiment exemplaire d'autant que les experts convergent à l'accabler. Dans l'indifférence générale, il sera condamné à mort. Lors du procès en appel, le délibéré ne prendra que 55 minutes... C'est ainsi que Jérôme Carrein sera l'avant-dernier guillotiné de France, quelques mois avant le Tunisien Hamida Djandoubi. À ce jour, il est le dernier citoyen français à avoir fait l'objet d'une exécution judiciaire. Tout cela est admirablement raconté et disséqué par l'auteur qui n'a pas besoin de beaucoup d'effets de manches pour captiver son lecteur. Une enquête dérangeante et captivante.
Livres Hebdo, 5 janvier 2018
par Laurent Lemire
Dans une enquête tirée au cordeau, Luc Briand revient sur le crime de Jérôme Carrein, qui fut guillotiné en 1977. Glaçant.
"Jamais je n’aurais pu faire une chose pareille de sang frais." Il dit frais, pas froid. Tout est dans ce lapsus, dans cette misère faite d’alcool et de fureur qui conduit un homme à tuer le 27 octobre 1975 Cathy Petit, 10 ans, qu’il voulait violer. On retrouve la fillette noyée, le visage dans la vase que le prédateur avait maintenu pendant plusieurs minutes. (...)
Luc Briand maintient la tension d’un bout à l’autre sur cette affaire oubliée. Trivialement, elle se résume à un fait divers sordide. Socialement, elle révèle beaucoup sur une France des Trente Glorieuses, pas toujours si éclatantes que cela. Le 20 janvier 1977, à Troyes, Patrick Henry vient d’échapper à la peine de mort pour l’enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. A Douai, après un délibéré de moins d’une heure, la tête de Carrein n’échappe pas à la peine capitale. "Carrein a payé pour Henry et Douai a vengé le tueur de Troyes", écrit Sorj Chalandon qui couvre le procès pour Libération. Seize jours après la condamnation à mort de Carrein, Christian Ranucci est guillotiné pour le meurtre d’une fillette de 8 ans.
Luc Briand ne refait pas l’enquête, il ne cherche aucune circonstance atténuante. Ce magistrat, dont c’est le premier livre et qui manifeste de réelles qualités d’écriture, veut seulement comprendre les raisons d’un verdict. Il a pour cela épluché le dossier de la procédure, rencontré les acteurs de l’affaire comme le juge d’instruction Michel Defer ou Michel Chevalier, le fils du bourreau qui a assisté à l’exécution. Il a aussi interrogé Robert Badinter, défenseur de Patrick Henry.
Alors oui, la misère, on l’a dit, est un indicateur. Mais ce conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence montre aussi cette France des années 1970 qui a peur et qui se laisse guider par elle. Carrein n’est pas un enjeu comme Patrick Henry le fut pour Robert Badinter. On ne peut faire d’un alcoolique une figure de l’abolition, et encore moins lorsqu’il est un assassin d’enfant. Luc Briand raconte la marche inexorable d’un homme vers la mort, un homme dont le dossier faisait quinze centimètres d’épaisseur. Autant dire une feuille de papier à cigarette à l’aune de son espérance de vie.
Livres Hebdo, 10 novembre 2017
On en parlera
L'avant-dernier guillotiné français
Dans La Revanche de la guillotine. L'affaire Carrein, à paraître le 19 janvier chez Plein Jour, le magistrat Luc Briand retrace l'affaire de Jérôme Carrein, condamné à mort en octobre 1975 pour avoir assassiné une fillette de 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Jérôme Carrein est l'avant-dernier homme à avoir été guillotiné sur le territoire français. La peine de mort a été abolie en France en septembre 1981.