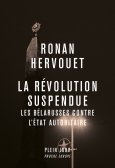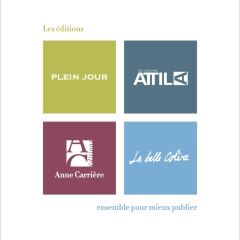En attendant Nadeau, 4 septembre 2023
Contestation et répressions bélarusse
Par Vincent Bloch
Spécialiste du Bélarus, le sociologue Ronan Hervouet revient dans La révolution suspendue sur l’émergence puis l’écrasement du mouvement de contestation qui a suivi la réélection frauduleuse d’Alexandre Loukachenko à la présidence du pays le 9 août 2020. Écrit dans la foulée des événements – sans notes de bas de page ni bibliographie –, le livre rassemble en onze chapitres de longs entretiens réalisés depuis l’exil en Pologne, en Lituanie ou en République tchèque auprès d’acteurs ordinaires du mouvement de contestation. L’approche ethnographique privilégiée par l’auteur met en lumière le caractère spontané et horizontal du mouvement social réclamant le départ de Loukachenko, puis la façon dont les rouages de la coercition d’État ont contraint les opposants au silence, à la docilité et à la fuite à l’étranger.
Si besoin était, Ronan Hervouet tord le cou au mythe du soulèvement des peuples et règle son compte au fétichisme électronique né dans le sillon du « Printemps arabe ». Il rappelle qu’au sein de régimes comme l’autocratie bélarusse, l’appareil d’État dispose encore de relais puissants, qui bénéficient de prébendes ou dont les droits sociaux et activités professionnelles sont à la merci de l’arbitraire juridique. Il montre aussi qu’une partie importante de la population soutient le régime d’ordre et que les services de sécurité restent soudés autour de la figure d’Alexandre Loukachenko autant par conviction que parce que ce dernier risquerait de les entraîner dans sa chute.
En décrivant les ressorts de la domination et les sociétés qui relèvent de ce type de régime politique, Ronan Hervouet repose de façon perspicace les questions qui, dans le cadre de l’historiographie de l’Union Soviétique et des pays d’Europe de l’Est, ont fait le cœur des désaccords entre soviétologues et révisionnistes. La polémique qui a récemment surgi dans le sillage de la parution du livre de Katja Hoyer, Beyond the Wall (paru aux éditions Allen Lane en 2023), montre bien que le débat autour du rôle respectif dans la perpétuation de ces régimes des mécanismes coercitifs, des convergences stratégiques et des modes d’adhésion n’est pas révolu. Le titre de l’ouvrage de Ronan Hervouet, La révolution suspendue, suggère quant à lui l’idée que le régime de Loukachenko a basculé dans une nouvelle temporalité : le rôle majeur de la répression dans les mois qui ont suivi l’élection présidentielle du 9 août 2020 révèle l’effritement des repères idéologiques et du mode d’insertion social qui assuraient la stabilité de cette ancienne république soviétique.
Ronan Hervouet est l’auteur de deux livres dans lesquels il s’est attaché précisément à décrire la perpétuation du régime bélarusse au quotidien, au-delà de paradigmes tels que la planification ou encore l’idéologie et la terreur. Datcha Blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie (Aux lieux d’être, 2007) montrait, à partir de l’exemple du jardinage, comment les citoyens pouvaient s’accommoder du contrôle politique et de la précarité matérielle, cultivant une sorte de quant-à-soi et préservant des espaces de liberté et de réalisation personnelle tout en développant une sociabilité compatible avec les modes d’organisation et les valeurs promues par le régime. Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020) explorait plus encore cet enchevêtrement entre règles officielles et comportements officieux et la communion autour de référents communs. C’est donc fort de sa solide connaissance de la société bélarusse et de son histoire que Ronan Hervouet, en suivant la piste de rencontres successives (un « échantillonnage en boule de neige »), s’est proposé d’éclairer un ensemble de récits qui relatent le rejet par la majorité de la population des formes de consentement qui avaient assuré une continuité historique entre l’ère soviétique et la Biélorussie indépendante.
L’auteur évoque d’abord un changement de contexte : la pandémie du printemps 2020 met à nu l’incurie de l’État, alors que, d’une part, les Bélarusses qui vont et viennent entre leur pays et l’espace Schengen tolèrent de moins en moins l’arriération et les contraintes du système Loukachenko et que, d’autre part, le développement depuis 2010 du secteur des technologies de l’information a engendré l’émergence d’un groupe social plus aisé et moins dépendant de l’État. Les candidatures à l’élection présidentielle de Sergueï Tikhanovski, de Valeri Tsepkalo et surtout de Viktor Babariko suscitent la crainte au plus haut niveau de l’appareil d’État. D’une manière ou d’une autre, tous ont été empêchés de réunir les 100 000 signatures nécessaires à leur candidature, et ne reste finalement pour affronter Loukachenko que l’épouse de Sergueï Tikhanovski, Svetlana Tikhanovskaïa, mère au foyer se voulant « apolitique ».
Ronan Hervouet décrit également le mouvement social qui prend pourtant son essor autour d’elle : la société civile s’enhardit progressivement et donne une réponse politique aux menaces de Loukachenko. Mais, au-delà des différents répertoires d’actions collectives (manifestations, boycotts, relai organisateur de la chaîne Telegram Nexta, forums spontanés – surtout dans les mois qui ont suivi l’élection remportée officiellement par le président sortant avec 80 % des voix), c’est l’économie des symboles, dont l’analyse constitue un aspect particulièrement éclairant de l’ouvrage, qui semble donner le ton de la confrontation. Loukachenko évoque çà et là dans ses discours la manière dont les dirigeants d’autres anciennes républiques soviétiques ont réprimé sans sourciller les mouvements d’opposition, déclarant par exemple : « Vous avez oublié comment Karimov a mis fin au putsch d’Andijan ? », en référence aux événements du 13 mai 2005 en Ouzbékistan, ou encore : « Il n’y aura pas de Maïdan dans notre pays », en faisant allusion au départ du président ukrainien Ianoukovytch à l’issue des manifestations de février 2014 à Kiev. Loukachenko ne manque pas non plus de jouer sur la corde traditionnelle du complot ourdi depuis l’étranger, qu’il s’agisse de la Pologne, de la Russie, ou de la Grande-Bretagne, puis de reprendre la thématique de la défense face au fascisme, dont il accuse l’opposition de perpétuer la geste et le dessein. De façon symétrique, les manifestants entonnent le chant catalan anti-franquiste de 1968 L’estaca (« Le pieux »), ou encore la chanson Peremen (« Changements »), composée en 1986 par le rocker soviétique Viktor Tsoï. Sitôt la victoire de Loukachenko proclamée, ils convergent vers « la stèle », le monument érigé par l’État soviétique en reconnaissance du statut de « Ville-Héros » décerné à Minsk et à onze autres villes d’URSS ayant combattu l’envahisseur nazi. Un opposant aujourd’hui en exil, dont Ronan Hervouet a recueilli le récit, parle encore de « dégel » lorsqu’il revient sur le dialogue entre manifestants et autorités locales dans la ville de Grodno entre le 14 et le 19 août.
Cet usage des symboles s’insinue jusque dans l’usage de la langue bélarusse : Loukachenko avait de fait ré-instauré la prééminence du russe en 1995, même s’il s’exprime aussi en trasianka, un mélange de russe et de bélarusse utilisé dans les campagnes, alors que la tarachkevista, le bélarusse littéraire, est associée aux opposants des villes. Le mouvement de contestation se rallie notamment autour de l’ancien drapeau blanc-rouge-blanc du Bélarus, que Loukachenko rejette du côté des fascistes, et que les opposants tentent tant bien que mal de dissocier de ce stigmate, pris à leur tour dans le cadre symbolique étroit de la culture politique bélarusse.
Les récits recueillis par Ronan Hervouet permettent de saisir au plus près le déroulement des événements. Dans un mélange de ras-le-bol et d’entraînement collectif, de griserie et de rite d’initiation, sur fond « d’indignation » face aux images de la violence policière diffusées sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de Bélarusses déclenchent ce que l’auteur qualifie de « révolution pacifique ». Les milliers d’arrestations et la répression menée par les forces anti-émeutes (les OMON) ne peuvent empêcher les rassemblements massifs. L’opposition gagne certains échelons inférieurs – fonctionnaires locaux, juges, membres des forces de sécurité – et une partie du secteur ouvrier se mobilise pour la première fois contre le régime.
La dynamique du pouvoir et les lois du Bélarus ne ressemblent cependant en rien à celles qui ont permis à d’autres mouvements sociaux de trouver des relais au sein des institutions démocratiques. La suite du livre illustre ce que l’on serait tenté d’appeler « le savoir des autocrates » en ce début de XXIe siècle : la terreur s’accentue à partir de la fin du mois d’août, les opposants sont réduits à « lutter » à petite échelle, les espaces de contestation se transforment en souricières éparpillées. Pour les principaux acteurs, l’exil finit par s’imposer, tandis que l’appareil d’État rappelle à l’ordre les récalcitrants grâce à sa capacité de les priver de leurs droits et avantages sociaux. Un MIG-29 de l’armée bélarusse est allé jusqu’à intercepter et forcer à atterrir à Minsk un avion commercial assurant la liaison Athènes-Vilnius afin d’arrêter Roman Protassevitch, le rédacteur en chef de la chaîne Telegram Nexta depuis la Pologne, qui se trouvait à bord.
L’auteur définit l’action des opposants opprimés comme des formes de résistance, ce qui ne manquera pas de relancer le vieux débat sur la portée de cette notion. D’une part, le mode d’interrogatoire des forces répressives bélarusses prolonge la matrice interprétative des services de sécurité soviétiques : tout comportement non performatif est systématiquement considéré comme réfractaire ou séditieux et nombreux sont les opposants interrogés par l’auteur qui relatent le zèle avec lequel les officiers chargés d’instruire leur dossier ont tenté de les étiqueter à partir de détails. Face au rouleau compresseur déployé par les forces répressives et l’appareil judiciaire, le maintien de la permanence de soi et la persistance de formes de défiance dans les espaces privés n’ont, quoi qu’il en soit, guère d’impact sur les rouages fondamentaux du régime. Certes, les régimes autocratiques, à l’image de celui que dirige Alexandre Loukachenko, cherchent activement à perpétuer leur légitimité symbolique et à continuer de bénéficier du consentement de la population, mais ils n’hésitent pas à ôter leur gant de velours et à assurer leur maintien par la force si leur survie en dépend. Si la « révolution » est « suspendue », rien n’empêche de penser que les mêmes acteurs aujourd’hui alliés de Moscou n’hésiteraient pas à l’anéantir si elle venait à ressurgir.
Le Courrier d'Europe centrale, 1 juin 2023
Ronan Hervouet : « Le soulèvement de 2020 au Bélarus ne peut être anéanti dans les mémoires »
Par Clara Marchand et Murielle Vitureau
Le sociologue Ronan Hervouet donne la parole aux Bélarusses ayant pris part à la révolution avortée de 2020. Une manière de conserver la mémoire de cet événement qui a cristallisé les espoirs démocratiques, en attendant un nouveau sursaut. Entretien.
Ronan Hervouet est sociologue et professeur de sociologie à l’université de Bordeaux, en séjour de recherche au Centre français de recherche en sciences sociales de Prague. Travaillant sur le
Bélarus depuis plus de vingt ans, il vient de publier l’ouvrage La révolution suspendue. Les Bélarusses contre l'État autoritaire, aux éditions Plein Jour, un recueil de témoignages de Bélarusses en
exil et une fine analyse du soulèvement de 2020 et de ses conséquences...
[...]
Le Vif/L'Express, 1 juin 2023
Sale temps pour l'opposition
Par Gérald Papy
La répression mise en place par le régime Loukachenko depuis la contestation de sa réélection, en 2020, s’est encore durcie avec la guerre en Ukraine.
Roman Protassevitch fut une figure médiatique de l’opposition au président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, après le mouvement de contestation populaire qui a suivi sa réélection lors de l’élection présidentielle du 9 août 2020 marquée par la fraude. Cofondateur de la chaîne Telegram Nexta, il fut arrêté par les autorités de Minsk après le détournement, le 23 mai 2021, d’un avion Ryanair assurant la liaison entre Athènes et Vilnius. Après avoir été condamné à huit ans de prison le 3 mai 2023 pour organi- sation d’émeutes de masse, préparation de troubles à l’ordre public et création ou direction d’un groupe extrémiste, Roman Protassevitch a bénéficié, le 27 mai, d’une grâce présidentielle. Et pour cause, il s’est rallié au président Loukachenko, défendant publiquement sa politique.
Les temps sont durs pour l’opposition au Bélarus, soit emprisonnée, soit contrainte à l’exil. Elle subit une répression systématique que la guerre en Ukraine a encore renforcée par un durcissement de la législation pénale et du droit administratif. Professeur à l’université de Bordeaux, le sociologue Ronan Hervouet scrute la société bélarusse depuis la fin des années 1990. Il publie La Révolution suspendue, un grand et poignant récit sur la résistance des opposants à la répression depuis la révolte de 2020. Il décrypte la situation de cette opposition.
L’étouffement de la contestation au Bélarus en 2020 et 2021 est-elle le résultat d’une répression massive ? Un de vos interlocuteurs évoque « le gigantisme de la machine répressive ».
On peut parler d’une répression à grande échelle, qui s’exerce jusqu’à aujourd’hui. Au 26 mai 2023, l’ONG de défense des droits humains Viasna recensait 1 507 prisonniers politiques, un chiffre
en aug- mentation. La répression a connu un caractère systématique. L’ élection présidentielle a lieu le 9 août 2020. Dans les rues de Minsk et de villes de province, des manifestants
dénoncent les fraudes et demandent pacifiquement la reconnaissance des résultats réels. Le régime met tout en place pour empêcher les gens de manifester. Alors que des usines se mettent en
grève et que des ouvriers débraient, il exerce rapidement un contrôle resserré sur ces héritières des grands conglomérats de l’époque soviétique qui peuvent employer plusieurs milliers de
personnes. Ensuite, différents groupes sont mis au pas, le monde universitaire, les étudiants, les ONG, les jour- nalistes... Une fois le mouvement étouffé par cette vague de répression, le
pouvoir cible de manière systématique ses acteurs et, à l’aide des documents disponibles – images des caméras, écoutes téléphoniques, etc. –, soit les condamne à des
peines de prison, soit procède par des menaces. Des étudiants sont expulsés de leur université, des ouvriers sont licenciés par leur entreprise, sachant que 80 % de l’économie est nationalisée. L’ONG Viasna évoque une « vengeance d’Etat ».
Des actes de torture sont aussi mentionnés...
Oui. De nombreux cas de torture ont été recensés par les ONG ou par le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits humains au Bélarus. Aujourd’hui encore, les conditions de
détention sont très difficiles. Viktor Babariko, le candidat à l’élection présidentielle de 2020, empêché de se présenter et emprisonné en juin de cette année-là, a été admis à
l’hôpital à la fin du mois d’avril. Maria Kolesnikova, qui a joué un rôle important dans l’équipe de campagne de Babariko, a effectué un séjour à l’hôpital.
[...]
Le « retournement » de l’opposant Roman Protassevitch au profit du régime d’Alexandre Loukachenko illustre-t-il la puissance de la machine répressive bélarusse ?
C’est ce que veut montrer le régime : qu’il a la capacité de « retourner » un opposant farouche, actif depuis longtemps, et qui, avec sa chaîne Telegram, avait joué un rôle de facilitateur de
l’organisation des mani- festations. Le régime a employé des moyens ahurissants – détourner un avion civil – pour l’arrêter. Quelques jours plus tard, il était filmé en train de faire des aveux
publics, une pratique courante pour les opposants au Bélarus depuis 2020. Avouer des crimes que l’on n’a pas commis est une vieille tradition dans la région. Mais faire la promotion du régime
après avoir été gracié, c’est autre chose. Cela montre que le régime est capable de briser psychologiquement ceux qui pensent que l’on ne peut pas le faire. C’est très impor- tant. D’autre
part, cela accroît le sentiment d’incertitude parmi les opposants, parce qu’on peut penser que Roman Protasse- vitch, pour être gracié, a dû livrer un certain nombre d’informations
compromettantes ou dangereuses pour eux. Cela envoie aussi comme message à la communauté inter- nationale que, malgré les sanctions qui ont été prises depuis le détournement, Alexandre
Loukachenko fait strictement ce qu’il veut.
RFI, 23 mai 2023
Par Frédérique Lebel
Les chantiers européens pour réparer la biodiversité
Réécouter l'émission par ici.
La révolution suspendue, c’est le titre du dernier ouvrage du sociologue Ronan Hervouet. Une plongée dans la révolution biélorusse d’août 2020, lorsque les citoyens avaient cru pouvoir renverser la dictature d’Alexandre Loukachenko, suite aux élections truquées. Aujourd’hui, les opposants sont en prison ou en exil. C’est en Lituanie, en Pologne ou en République Tchèque que Ronan Hervouet les a rencontrés. Marielle Vitureau lui a demandé pourquoi après plusieurs livres sur le quotidien des Biélorusses sous la dictature, il avait voulu parler de ce soulèvement.
Mediapart, 1 mai 2023
La Révolution suspendue, Les Bélarusses contre l'Etat autoritaire
Par Patrick Rödel
Ronan Hervouet est sociologue, spécialiste de la Biélorussie où il a vécu plusieurs années. Dans un premier ouvrage paru en 2009, "Datcha blues, existences ordinaires et dictature en Biélorussie", il montrait comment la tradition des datchas permettait à une partie de la population de supporter la pesanteur du pouvoir de Loukachenko, dernier vestige de l'ère stalinienne ; la datcha est un lieu de liberté et de convivialité bien différente de ce qu'offrent les cités grises - expérience de résistance ou soupape de sécurité octroyée par le pouvoir, la question était ouverte. En 2020, "Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie", il explorait ce qui reste une des marques de l'ancien régime communiste, le kolkhose - l'étonnant de cette enquête était de découvrir qu'à tous les niveaux chacun s'arrange pour tricher et récupérer à son usage personnel ce qui est censé être propriété collective ; là encore, le pouvoir ferme les yeux pour l'essentiel et conserve ainsi une paix sociale - on n'est pas loin de la servitude volontaire de La Boétie.
Dans chacun de ces deux livres, Hervouet aborde ses interlocuteurs avec le même souci de les mettre en confiance, sans porter de jugements, avec une empathie remarquable. C'est la même méthode qu'il utilise dans ce livre d'entretiens avec des Bélarusses qui ont fui leur pays après que les espoirs d'un changement de régime ont été écrasés par la répression sans merci de Loukachenko. Chacun, jeune ou plus âgé, femme ou homme, témoigne de ce que fut cette période qui débuta avec les élections de 2020 - pour la première fois des candidats qui n'étaient pas des marionnettes du pouvoir osaient défier Loukachenko pour qui une réélection triomphale allait de soi. Devant la montée d'une opposition qui parvenait à réunir un nombre grandissant de soutiens, Loukachenko eut recours à l'habituelle répression - arrestation des candidats, dispersion des manifestants par les forces spéciales des OMON. Mais la révolte avait pris une telle ampleur qu'une vague de protestation sans pareil déferla sur le pays - avec comme figures de proue trois femmes Sveltana Thikhanovskaïa, Veronika Tespkalo et Maria Kolesnikova. Rien n'arrête plus les manifestants quand le résultat des élections donne Loukachenko comme grand vainqueur ! La rue leur appartient, la joie d'être ensemble efface toutes les craintes malgré la violence de la répression, la "cruauté des forces de sécurité, non seulement envers des militants, comme dans le passé, mais aussi contre des citoyens ordinaires (suscite) une profonde indignation". La marche du 16 août est l'acmée de ce soulèvement. Tous les témoignages recueillis par Ronan Hervouet vont dans le même sens :"l'évocation de cette journée est vaporeuse. On me parle d'un soleil étincelant, de sourires radieux, d'une euphorie débordante, d'une créativité phénoménale."Tout semble désormais possible. Même les ouvriers qui forment la base du pouvoir commencent à faire défection. Ce qui est proprement inimaginable en temps ordinaire.
L'euphorie est de courte durée. Les rassemblements sont interdits et violemment dispersés. Tout cela est tristement documenté et continue d'être la marque des régimes dictatoriaux - la Russie de Poutine en donne la preuve. Et il ne reste à ceux qui ont pu échapper à la prison , surmonter les interrogatoires, les passages à tabac, les chantages de mille sortes qu'à s'enfuir s'ils le peuvent encore. L'opposition est décapitée. Les interlocuteurs de Hervouet parlent des difficultés rencontrées pour franchir les frontières, de leurs peurs, de leur épuisement, du quotidien qui est le leur dans leur nouveau pays d'accueil, de leur désespoir, de leurs angoisses quand ils ont laissé derrière eux de la famille. Nous parlons des réfugiés, des migrants comme d'un tout en oubliant le drame de chaque parcours ; le livre d'Hervouet donne à chacun, à chacune une voix que l(on n'est pas près d'oublier. Le pluriel anonymisant cède la place à un visage unique et c'est une leçon d'humanité qui est ici donnée. Ce sont des corps brisés, des espoirs éradiqués, des craintes toujours présentes qui viennent nous tirer de notre apathie.
Une double leçon pour ceux qui crient à la dictature dans des pays où cela ne les condamne pas à mort. Et pour ceux qui se croient à l'abri d'une évolution vraiment autoritaire qui pourrait avoir lieu - ce qui appelle à une vigilance extrême. Le livre d'Hervouet est à lire absolument.
PS : le lecteur attentif aura remarqué que dans les premiers bouquins de Ronan Hervouet il est question de Biélorussie alors que dans celui-ci il est question de Bélarus. Biélorussie est le terme soviétique, Bélarus le terme bélarusse. On voit bien l'enjeu politique de ce choix pour les Bélarusses.
Le Monde, 26 avril 2023
En Biélorussie, le terrible destin d’une « Révolution suspendue »
Par Faustine Vincent
Libération, 25 avril 2023
Par Nelly Didelot
Dans son nouveau livre, « la Révolution suspendue », le sociologue Ronan Hervouet décortique la révolte qui a eu lieu au Bélarus en 2020 et les importantes conséquences qu'elle a eues sur la société, à travers des témoignages d'exilés. Le sociologue Ronan Hervouet s'est longtemps « interrogé sur les raisons pour lesquelles rien ne semblait changer » au Bélarus. Nostalgique du XXe siècle, de l'URSS et du collectivisme, le régime autoritaire d' Alexandre Loukachenko a figé pendant plus de deux décennies le pays dans un immo- bilisme propice à son maintien au pouvoir . Jusqu'à ce qu'à l'été 2020, sa sixième réélection frauduleuse fasse basculer le Bélarus dans la révolte. Des centaines de personnes ont défilé pendant des semaines, notamment durant les marches du dimanche, semblant toucher du doigt le moment de bascule du régime, avant que la machine répressive n'entre en action et ne mette fin au mouvement. Jusqu'à punir ceux qui conservent de simples photographies des man- ifestations. Ce sont ces événements que Ronan Hervouet décortique patiemment dans la Révolution suspendue. Les Bélarusses contre l'Etat autoritaire (Plein Jour). Face à un pays fermé aux journalistes comme aux chercheurs, il s'est appuyé sur les témoignages de dizaines d'exilés qui ont fui la répression et qui sont désormais la seule voix libre de la société bélarusse.
Comment le Bélarus est-il passé de la passivité à la contestation ?
Comme beaucoup d'observateurs, je n'ai pas vu venir le soulèvement de l'été 2020 . Mais, a posteriori, je pense qu'on peut pointer au moins trois facteurs décisifs. Le premier est le Covid. Le régime de Loukachenko s'est moqué du virus, aucune politique publique n'a été mise en place. Face au déni des autorités, les Bélarusses se sont auto-organisés. Les réseaux de communication et d'entraide qu'ils ont créés au début de la pandémie ont été très utiles ensuite pendant la contestation. La campagne présidentielle en elle-même a aussi joué, comme la personnalité de la candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa . Elle n'est pas issue du sérail politique et s'est présentée à la place de son mari emprisonné. Surtout, la répression policière des premières manifestations post-électorales a participé à la dynamique insurrection- nelle. Les images des violences ont rapi- dement circulé, et elles ont amené des personnes qui se tenaient en marge du militantisme à participer à la contestation, tant elles étaient choquées par la brutalité employée contre des manifestants pacifistes.
[...]
Sud Ouest, 23 avril 2023
Les espoirs douchés de la révolution démocratique
Par Jean Harambat
Professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux, Ronan Hervouet revient sur la répression qui a balayé toutes les attentes du peuple en Biélorussie après les événements de 2020. L’avis de la rédaction de “Sud Ouest”.
Le territoire du Bélarus (ou Biélorussie) a constitué - et constitue toujours - un élément essentiel, dès le 24 février 2022, dans le dispositif russe pour attaquer et soumettre l'Ukraine. En mars dernier, les présidents Loukachenko et Poutine ont franchi un pas supplémentaire en s'accordant sur la possibilité de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Ce petit pays, que l'on peut sans hésiter qualifier de dictature...
Le territoire du Bélarus (ou Biélorussie) a constitué - et constitue toujours - un élément essentiel, dès le 24 février 2022, dans le dispositif russe pour attaquer et soumettre l'Ukraine. En mars dernier, les présidents Loukachenko et Poutine ont franchi un pas supplémentaire en s'accordant sur la possibilité de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Ce petit pays, que l'on peut sans hésiter qualifier de dictature tant l'au- toritarisme et l'arbitraire s'y sont accen- tués ces dernières années, joue un rôle capital pour le destin de l'Ukraine et de l'Europe.
Or, l'enquête du sociologue Ronan Hervouet offre une vue d'ensemble inédite de ce qui s'est joué lors de l'élection de 2020, suivies de manifestations violemment réprimées par le régime de l'ancien tractoriste Alexandre Loukachenko. En août 2020, le président sortant, au pouvoir depuis 1994 et candidat à un sixième mandat, a été réélu avec plus de 80 % des suffrages. Les fraudes élec- torales évidentes, les menaces visant les opposants, ainsi que les mensonges et les bravades du chef d'État concernant l'épidémie du Covid-19 ont été le carburant des manifestations.
[...]
Le Figaro.fr, 20 avril 2023
« La révolution démocratique de 2020 va nourrir l’imaginaire biélorusse. »
Dans La Révolution suspendue, les Belarusses contre l’État autoritaire (Plein jour), le sociologue, professeur à l’université de Bordeaux, revient sur les racines et étapes du mouvement démocratique aussi inattendu que massif qui a embrasé la Biélorussie en 2020 avant d’être férocement réprimé. Ce spécialiste est persuadé que le peuple biélorusse pourrait un jour s’inviter à nouveau dans la géopolitique compliquée de la région.
LE FIGARO. - Vous sortez un livre sur la révolution démocratique biélorusse, mouvement antiautoritaire inattendu qui vous prend de court en 2020.
Ronan HERVOUET. - Il me semble que ce qui s’est passé en 2020, cette révolution démocratique antiautoritaire au Belarus brutalement suspendue, a une importance centrale pour comprendre la région. J’ai voulu mettre en récit, en allant au contact avec les Biélorusses en exil, les ressorts de la révolution, la brutalité de la répression et la douleur des 200.000 à 300.000 exilés arrivés en Europe. On parle si peu du Belarus! Dans le déclenchement de ce mouve- ment, ont joué des éléments conjoncturels comme le Covid, tous mes inter- locuteurs ayant raconté qu’ils s’étaient sentis abandonnés par la légèreté du pouvoir qui conseillait de boire de la vodka face au virus. Des solidarités citoyennes se sont mises en place, ap- puyées par des technologies nouvelles utilisées par tous les employés du secteur des technologies de l’informa- tion, un groupe social qui s’était énor- mément développé depuis des années.
Le deuxième élément déclencheur a été le déroulement singulier de la campagne électorale, qui après la mise à l’écart de deux candidats d’opposition dont l’un, Viktor Babariko, a été mis en prison et l’autre, Tsepkalo, s’est réfugié à Moscou, a laissé seule en piste Svetlana Tikhanovskaïa, une femme de la société civile, qui s’était lancée dans la bataille parce que son propre mari, Sergueï Tikhanovski , avait été mis en prison. Sa campagne exceptionnelle, et l’appui qu’elle a reçu de Maria Kolesnikova, ancienne chef de campagne du candidat Babariko, et de la femme du candidat Tsepkalo, ont suscité un enthousiasme réel. Plus en profondeur, tout ce mou- vement s’est construit sur une société qui avait commencé, malgré la chape de plomb autoritaire, à voyager vers la Pologne et le reste de l’Union européenne. Ces gens m’ont raconté être entrés en dissonance avec leur pays.
Ce mouvement démocratique biélorusse rappelle Solidarnosc et la révolution de Maïdan en Ukraine. Mais peut-on parler de réveil nation- al, comme en Pologne et en Ukraine?
Les Biélorusses ne se réfèrent pas spontanément à Maïdan ni à Solidarnosc. Sur Solidarnosc, j’ai observé des échos dans le mouvement biélorusse, mais pas for- cément formulés en tant que tels. Les manifestants ont repris le chant Les Murs, chanté jadis par Solidarnosc. Mais ces éléments réappropriés ne s’ac- compagnaient pas d’une charpente idéologique étayée. C’est au fil des mois qu’une approche plus construite s’est mise en place. Concernant Maïdan, les manifestants ne voulaient pas s’en réclamer, pensant, avec une naïveté qu’ils reconnaissent aujourd’hui, qu’il suffirait de dire stop aux violences et de demander le départ du dictateur pour tourner la page. Quant à la dimension nationale, elle apparaît au fur et à mesure des semaines. Dès le début de la campagne, les couleurs mobilisées par Tikhanovskaïa sont le rouge et le blanc, couleurs du drapeau de la République populaire biélorusse de 1918, repris par divers mouvements nationaux dans les années 1980 puis le parti nationaliste BNF dans les années 1990-2000. Pendant la campagne de Tikhanovskaïa, toutefois, ces couleurs signifient que l’on ne veut plus du régime actuel, mais il n’y a pas de discours nationaliste an- tirusse, pas de revendication sur la langue biélorusse. Les gens que j’ai interrogés, achetaient spontanément ce drapeau car il signifiait pour eux une revendication de dignité et de démoc- ratie. C’est ensuite, au fur et à mesure, que ces citoyens découvrent l’histoire du drapeau et de la nation biélorusse. Leur « nous » citoyen se transforme pro- gressivement en « nous » national, mais j’insiste, cette vision n’est pas forcément nationaliste.
[...]
Ouest-France, 19 avril 2023
Biélorussie : « La Révolution suspendue » de Ronan Hervouet
Par Laurent Marchand
Dans un ouvrage fourmillant de témoignages directs, Ronan Hervouet revient sur la révolution des Bélarusses (ou Biélorusses) en août 2020. Une révolution suspendue par la répression d’un État de plus en plus autoritaire. Nous en avons parlé avec l’auteur, professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux. Son livre « La révolution suspendue » est publié aux éditions Plein Jour, dans la collection Proche Europe.
Un virus peut-il abattre une dictature ? Au tournant de l’été 2020, de nombreux Bélarusses l’ont sans doute cru possible. Après un printemps où le régime tenu d’une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994 a été complètement dépassé par les événements pandémiques, un flottement est apparu dans ce petit pays qui semble, à bien des égards, comme un dernier vestige du monde soviétique qui fut.
La mémoire de Tchernobyl
Pas d’assistance, dénégation d’État de la gravité de la pandémie, aucune mesure de soutien. De nombreux habitants ont revécu un cauchemar, celui de Tchernobyl en 1986, qui toucha particulièrement
le territoire biélorusse. Cette mémoire a été réactivée par la pandémie
, explique Ronan Hervouet. Surtout, les habitants ont dû se débrouiller seuls. L’absence
d’information, les conseils sommaires donnés par les autorités disant qu’il suffisait de se rendre aux bains pour ne pas avoir le virus. Le discours officiel était, d’une certaine manière, humiliant
dans sa façon de désigner les malades comme responsables de leur maladie, avec aucune responsabilité de la part de l’État. Et la réaction a été de dire que, face à ce refus de l’État de mettre en
place des politiques sanitaires, il fallait s’auto-organiser
.
Dès lors, les carences de l’État de Loukachenko éclatent au grand jour, dans un tel moment existentiel. Nous avons compris que nous n’avions pas vraiment besoin de cet État
, dit
un témoin interrogé par l’auteur. Et lorsque vient le jour des élections, le 9 août 2020, et dans les semaines de campagne qui les précèdent, un climat de révolution gagne les esprits. Dans la
capitale, Minsk. Mais pas seulement, nous explique Ronan Hervouet.
[...]
Les femmes en première ligne
80 % de la population biélorusse utilise Internet, et la mise en réseau de la contestation a naturellement joué un rôle central durant tout l’été 2020. Un autre témoignage recueilli dans le
livre illustre l’immense espoir soulevé par ces mois de mobilisation et de contestation. Un témoin raconte. J’ai été choqué quand Tikhanovskaïa (la leader de l’opposition contrainte à l’exil
depuis les élections) est venue à Baranovitchi, ma ville natale. Environ 8 000 personnes ont assisté au meeting. Cela n’était jamais arrivé dans notre ville
.
Le 30 août, entre 100 000 et 200 000 manifestants se rassemblent à Minsk pour la ‘Marche pour la Paix et l’Indépendance’. Le jour des 66 ans de Loukachenko. Ronan
Hervouet, qui a vécu à Minsk au début des années 2000 et des années 2010, n’en revient toujours pas. J’avais vu des tentatives de mobilisation qui avaient été étouffées et réprimées très
rapidement et brutalement. Là, pour défier le pouvoir comme ils l’ont fait en août 2020, il a fallu un courage immense, notamment les premiers soirs, les 9, 10 et 11 août. Il n’y avait pas
de réseau internet disponible, et la répression se faisait de façon extrêmement brutale. Et puis le 12 août, internet a été rétabli. Le changement par rapport à 2010, c’est que plus de
9 personnes sur 10 ont désormais un smartphone. Donc ils ont accès aux réseaux sociaux, à Telegram, aux chaînes internationales. Toutes les images de violence tournées contre les citoyens
pacifiques ont déclenché une adhésion populaire, de secteurs de la population qui jusqu’ici ne se mobilisaient pas. Le mercredi 12 août, les femmes se sont habillées de blanc et dans le centre
de Minsk, elles ont constitué une chaîne humaine, pour exiger l’arrêt des violences et le respect de leur liberté
.
Répression progressive
Dans La révolution suspendue, l’auteur donne justement la parole à des dizaines de Biélorusses qui participèrent à ces manifestations. Il les a rencontrés hors de Biélorussie. En exil. En Lituanie, en Pologne, en République tchèque. Fournissant ainsi un document sociologiquement précieux sur la façon dont un peuple décide de s’opposer à un régime autoritaire.
À l’ampleur inégalée
de la contestation, va répondre une répression
d’une intensité, elle aussi, inédite, estime Ronan Hervouet. Arrestation des leaders
politiques, emprisonnement des manifestants, traque des exilés. Entre 200 000 et 300 000 Biélorusses auraient quitté le pays. L’auteur raconte le rouleau compresseur enclenché par
Loukachenko pour réprimer la révolte, et nous livre ses doutes, deux ans et demi après les événements, sur la possibilité d’un rebond.
[...]
Vengeance d'État
Anaïs Marin, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l’Homme en Biélorussie, parle de vengeance d’État
. Ronan Hervouet précise. Avec la reconnaissance
faciale, on a retrouvé les personnes qui avaient manifesté. On les a obligés à livrer l’accès à leurs téléphones, à leurs réseaux. Donc soit on est parti et on a réussi à fuir, soit on s’est retrouvé
en prison, soit il fallait tout effacer pour survivre et éviter la répression
.
Selon l’opposition en exil emmenée par Tikhanovskaïa, il y aurait un plan qui impliquerait un ensemble de personnes prêtes à se soulever lorsque la conjoncture sera favorable. Mais c’est
très difficile d’avoir plus d’éléments. Il y a eu néanmoins plusieurs actes de sabotage, notamment une bataille du rail pour ralentir l’avancée des troupes russes au Bélarus. Et fin février, les
forces de sécurité se sont retournées contre les régimes, se sont félicitées de l’action d’un drone qui a endommagé un avion de reconnaissance russe. Loukachenko a dit qu’il traquerait tout le monde.
On peut aisément penser que les anciennes pratiques de la guerre froide sont non seulement dans les esprits, mais ont pu ressortir dans cette partie de l’Europe
.
TV5 Monde, 18 avril 2023
Par Sophie Roussi
Réécouter l'émission par ici.
Ronan Hervouet est sociologue, professeur des Universités. Il publie La révolution suspendue. Les Bélarusses contre l'Etat autoritaire chez Plein jour. Ce livre recueille les temoignages de ceux qui ont cru au renversement de l'autocrate Loukaschenko en 2020 avant la répression et l'exil. Il explique pourquoi il a voulu faire ce livre de témoignages.
Radio Canada, 2 avril 2023
Par Frank Desoer
Réécouter l'émission par ici
État devenu indépendant après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le Belarus est gouverné autoritairement depuis 1994 par Alexandre Loukachenko. Reconduit au pouvoir à répétition après plusieurs élections considérées par de nombreuses organisations internationales comme entachées, le président bélarusse pourchasse tous ses opposants et a resserré ses liens avec le régime poutinien dans la foulée de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Petit retour sur le régime bélarusse en compagnie de Ronan Hervouet.