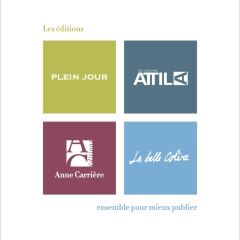Mediapart, 16 octobre 2022
La Famille : dossier d'une histoire
Par Maryse Emel
Le rôle des medias
L’histoire que nous raconte Jean-Pierre Chantin, docteur en histoire religieuse contemporaine, dans son livre, La Famille, une dissidence catholique au coeur de Paris, XVIIe-XXIe siècle, commence comme un polar. Un nom impossible à prononcer sur un compte Facebook, qui s’avère être les noms accolés de huit familles composant « La Famille » : : « Fertthibousandozhavet Pulinsanglierdechelettemaitre », la curiosité d’un journaliste du Parisien, Nicolas Jacquard, le comportement étrange d’enfants qui restent entre eux et ne se mêlent pas aux autres dans une école, tous les ingrédients sont là – dont les contradictions – pour que s’ensuive un déchaînement médiatique après publication le 21 juin 2020 de l’enquête de Nicolas Jacquard dénonçant la Famille comme se rapprochant par certains de ses comportements et discours d’une secte.
Connaissance et opinion
Jean-Pierre Chantin entreprend de clarifier la question au regard de ses recherches. « On peut déplorer des attitudes, s’en inquiéter, comme le fait la Milivudes. Vous pouvez très bien juger que la Famille est une secte si ça vous chante, au regard de ce que vous en avez appris[…] de mon côté je me place en tant que chercheur et ne juge pas des opinions si leur mise en pratique ne contrevient pas à la loi. De manière un peu provocante, je l’avoue, je réponds même qu’une secte ça n’existe pas((p.162)) ». Le terme de « secte » n’est pas une notion scientifique : « cette désignation est purement subjective et n’a aucune existence légale ».
Résultats de l’enquête
Si le numérique et les réseaux sociaux contribuent à une plus grande diffusion des connaissances et informations, il n’en demeure pas moins qu’il faut les vérifier. C’est le point de départ du travail de l’historien. Cet examen critique des sources commence par enquêter sur leurs auteurs. Nicolas Jacquard se présente sur son compte Linkelin comme « Grand reporter. Service informations générales. Police, justice, enquêtes((p .21)) ». Si comme l’indique l’étymologie« istor » en grec, que l’on traduit par histoire ou enquête, l’histoire est une enquête, toute enquête n’est pas toujours historienne, comme va l’établir Jean-Pierre Chantin. Chercher le sensationnel, c’est-à-dire entretenir les réactions affectives du public n’est pas dans les projets de l’historien. Cumuler les domaines de réflexion comme le montre « la biographie» du journaliste, c’est en rester à des généralités vagues dans le but de satisfaire la curiosité du public. L’historien tel que ce travail nous donne à le penser, procède avec précision, en comparant méthodiquement les documents afin de vérifier en quoi consiste la Famille.Si ce travail, au départ chronologique et narratif, raconte l’histoire de la Famille, et ses éventuels liens avec une secte, cette recherche finit par rejoindre une autre question qui l’englobe, à la façon des poupées russes, analogie dont se sert l’auteur pour présenter les différentes strates de la Famille. « La Famille se comporte comme tout groupe très investi dans la foi au coeur de son identité ((p.155)) ».
Un mot inopérant
À force d’être utilisé, le mot de secte finit par perdre toute substance ou à se figer dans un certain nombre de qualifications surannées. Rencontré à titre d’expert par le journaliste pour avoir travaillé son doctorat sur les jansénistes – ou port-royalistes - dont est issue la Famille, Jean-Pierre Chantin va s’attacher à suivre la filiation, d’abord en en donnant une vue globale pour ensuite approcher plus précisément chaque famille composant cet ensemble : de la filiation le texte passe à une généalogie, où chaque famille suit son propre devenir.
Des querelles théologiques à l’agitation populaire
Au point de départ de l’histoire de la Famille, il y a une querelle théologique qui naît au sein du catholicisme en 1640 avec la parution de l’Augustinus de l’évêque d’Ypres, Jansen, dit Jansenius, et qui porte sur la nature de la Grâce. Comme Augustin d’Hippone, il défend l’idée que l’homme, marqué par le péché originel ne peut rien sans la grâce divine. A l’inverse, les Jésuites, adversaires de l’évêque, défendent l’existence du libre-arbitre de l’individu et l’action nécessaire de l’Église dans la question du salut.
C’est ainsi que l’abbé de Saint Cyran, l’un des correspondants d’Augustin, prônait une conversion intérieure. Reproche était fait à l’Église romaine de distribuer trop facilement les sacrements et la communion. Saint Cyran fait appliquer dans l’Abbaye cistercienne de Port Royal à Paris et enVallée de Chevreuse, des préceptes de vie conformes à cette conception. Ce groupe est appelé « janséniste » ou « port-royaliste » par les Jésuites qui demandent dès 1653 à tous les prêtres de signer un formulaire par lequel ils déclarent accepter la position de Rome sur des questions du dogme. Les occupants de Port-Royal seront expulsés entre 1711 et 1713
Derrière le théologique se profile une question politique. Il s’agit de fixer l’obéissance du clergé et de fidèles à la papauté, ce qui ne sera fait qu’en 1870. Mais surtout ce détour montre que la Famille au départ est une réponse à une absence de dialogue avec l’appareil politique des Jésuites.
Le rejet de l’Eglise
Dans un tel contexte politique qui réclame une obéissance aveugle à l’Église, le « miracle de la Sainte Epine » opère un autre déplacement : celui du théologique vers le populaire. Ce qui au départ est une querelle d’interprétation des textes, se transforme en spectacle de l’intervention divine. On passe d’une compréhension polémique des textes ouvrant la discussion à la confrontation des arguments, à une mise en scène irrationnelle et surnaturelle de la souffrance. Se pratiquent alors des séances convulsionnaires où le corps est mortifié et supplicié, et où les adeptes qui appartiennent à la Famille, lisent la parole de Dieu. Les « convulsionnistes » se réunissent et « le corps souffrant devient très vite l’image de la véritable Église dont la foi est agressée((p.46)) ». S’ensuivent des arrestations et le désaveu par les port-royalistes de ces manifestations. Les membres de la Famille vont alors se séparer de l’Église sous la tutelle de l’oratorien Michel Pinel hostile à Rome et dont L’Oeuvre annonce la fin des Temps.
Croire
Pendant que les pinélistes attendent l’apocalypse, le bonjourisme – nom qui provient de François Bonjour et son frère – soutient la République jacobine de Robespierre. Mais c’est surtout Jean Thibout qui va rassembler autour de lui ces familles qui aujourd’hui composent la Famille, plaçant la structure familiale au coeur de l’organisation, sans pour autant qu’il y ait unanimité en son sein.
Jean-Pierre Chantin se refuse à prendre parti. Ce n’est pas le rôle de l’historien de prononcer des sentences morales. Il cherche seulement à comprendre « les ressorts qui guident les humains((p.163)) ». A ce titre les croyances religieuses répondent en partie à la crainte de la mort et donnent du sens à l’imprévisibilité du hasard. Si les hommes pouvaient tout contrôler disait en son temps Spinoza, ils ne seraient pas la proie de ces croyances qui bien souvent versent dans la crédulité. Mais la condition humaine est ainsi faite que l’on ne maîtrise pas le temps et ses propres craintes.
Choisir les valeurs qui guident nos vies, c’est disposer de la liberté de conscience, principe fondamental de la laïcité. Un groupe religieux, une association cultuelle ne sont répréhensibles que s’ils portent atteinte à l’ordre public. Telle est la loi. L’histoire ne fait pas la loi. Elle ne peut que contribuer à la formation de la vigilance par l’exercice méthodique du jugement. Ce que d’aucuns nomment l’esprit critique