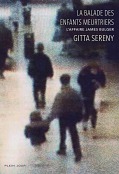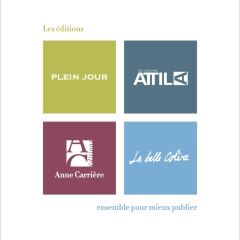Philosophie Magazine, 13 juin 2017
La Balade des enfants meurtriers
par Catherine Portevin
En février 1993, à Liverpool, un atroce fait divers défraye la chronique : le petit James Bugler, âgé de 2 ans, est enlevé dans un centre commercial. Son corps est retrouvé deux jours plus tard, battu à mort, torturé, mutilé. Les deux auteurs du crime sont vite identifiés : deux garçons de 10 ans, Robert et Jonathan, aux visages et aux voix encore pleins d’enfance. Lorsque la journaliste Gitta Sereny s’intéresse à cette histoire, elle a publié vingt-cinq ans plus tôt Le Cas Mary Bell, qui, à l’âge de 11 ans, avait tué avec la même cruauté deux très jeunes enfants. L’affaire ne cesse de l’obséder, de même que l’obsède le mystère du mal extrême - Gitta Sereny est aussi connue pour avoir interviewé Franz Stangl, le bourreau de Treblinka, dont elle a tiré un témoignage tendu intitulé Au fond des ténèbres. L’enfant meurtrier représente pour elle une autre version de ces ténèbres humaines qu’elle cherche à comprendre, au-delà de la sidération horrifiée que provoque le « monstre » ou le « démon ».
Gitta Sereny suit donc toutes les audiences du procès en novembre 1993, puis passe plusieurs mois à enquêter auprès des policiers, travailleurs sociaux, instituteurs, et parents de Robert et Jonathan. « Les jours que j’ai passés là-bas resteront parmi les plus tristes que j’aie connus », avoue-t-elle. Comme dans le cas de Mary Bell, son récit est aussi un réquisitoire contre la justice des mineurs telle qu’elle est alors pratiquée en Grande-Bretagne, qui juge les enfants meurtriers comme des adultes, les condamnant de la même manière à de longues peines en de bornant à établir les faits et les preuves de la culpabilité, sans jamais se poser la seule question qui importe : pourquoi ? Or, assène Gitta Sereny avec foi, « dans le cas de crimes commis par des enfants, la punition peut-elle être le seul but des procédures légales ? Est-il moralement acceptable que [au terme du procès] on ne comprenne pas mieux ce qui les a rendus si féroces ? » (...)
La force de Gitta Sereny, une fois de plus, est d’articuler l’empathie humaine et la rigueur. Toujours soucieuse des faits, dans leur crudité la plus nue, il n’y a chez elle ni victimisation simpliste ni jugement surplombant. Son enquête répond avec justesse à ceux qui masquent leur refus de comprendre en vilipendant la désormais fameuse « culture de l’excuse ». Il s’agit, non pas de défendre Robert ou Jonathan, comme naguère Mary Bell, mais « de les sauver ».
Quelques mois après cette plongée dans l’affaire James Bugler, Gitta Sereny voudra aller plus loin dans celle de Mary Bell en retrouvant la jeune fille, devenue femme et mère de famille (Une si jolie petite fille, paru en français en 2014 aux éditions Plein Jour). On ne saura pas ce que lui aurait inspiré le destin de Robert et Jonathan après leurs huit années de détention. En 2010 (deux ans avant la mort de Gitta Sereny), Jonathan, qui paraissait alors le plus « innocent » des deux garçons, fut condamné pour trafic d’images pédopornographiques.
Le Monde des livres, 23 mars 2017
par Macha Séry
Ce fait divers est resté dans les mémoires pour la jeunesse de ses protagonistes et par l'activité des caméras de surveillance qui ont capté, en ce 13 février 1993, la sortie hors d'un centre commercial, près de Liverpool, de trois garçons : James Bulger, 2 ans, encadré par Jon Venables et Robert Thomson, 10 ans chacun. Ceux-ci vont l'entraîner près d'une voie ferrée, le déshabiller et le mettre à mort. Pourquoi un acte aussi atroce ? Gitta Sereny (1921-2012), l'une des plus grandes journalistes d'investigation, a assisté à toutes les audiences du procès. Elle s'est entretenue avec les familles des meurtriers, leurs instituteurs, les travailleurs sociaux et les policiers chargés de l'enquête pour essayer de comprendre. (...) (Cet opus) permet d'appréhender avec nuance la complexité des motivations inconscientes qui ont présidé au crime, notamment sa dimension sexuelle.
Le Canard enchaîné, 22 mars 2017
James, 2 ans
par Dominique Simonnot
Comment oublier cette image floue, fixée par la vidéosurveillance, en 1993 ? On y voit deux enfants encadrant un troisième, minuscule, à la sortie d'un centre commercial de Liverpool, en Angleterre. Le prélude au meurtre de James, 2 ans, dont le corps fut retrouvé deux jours après cette capture d'écran. Torturé, tué par Jonathan et Robert, tous deux âgés de 10 ans. Le "crime de Liverpool" avait épouvanté le monde.
Disparue en 2012, à 91 ans, Gitta Sereny fut une immense journaliste, écrivaine, historienne, dont l'œuvre, éclectique, va de l'exploration de l'"âme" nazie à celle des "enfants volés du Reich" et à celle des petits criminels.
On lui doit aussi Une si jolie petite fille, un livre mythique sur l'histoire de Mary Bell, meutrière, à 11 ans, de deux petits de 3 et 4 ans. Suivant son procès, Gitta Sereny fut horrifiée par le système britannique qui, pour des crimes, peut juger en adulte une gamine de 10 ans. Sans même une expertise psychiatrique, sans même la moindre enquête, ni sociale ni familiale, qui aurait pourtant montré l'univers immonde dans lequel baignait la fillette depuis sa naissance.
Ces investigations, Gitta Sereny les a menées, plus tard, bien après la condamnation du petit "monstre", haï par le pays tout entier. Impossible, donc, qu'elle ne se soit pas passionnée pour le "crime de Liverpool". Mêmes déficiences dans l'enquête, même aveuglement volontaire de la justice.
Sereny, elle, fait parler les parents, les professeurs, les policiers, les éducateurs, tous infiniment bouleversés par le meurtre et ses horribles détails. Elle fouille aussi les familles, l'entourage (...). Ce qu'elle révèle mène à un essentiel questionnement, hélas totalement absent du procès : les juges, désinvoltes, n'auraient-ils pas jugé des enfants fous ?
Vive le Brexit !
Le Journal du dimanche, 12 mars 2017
Caroline Eliacheff : "On imagine mal un enfant meurtrier"
propos recueillis par Marie-Laure Delorme
La psychanalyste et pédopsychiatre Caroline Eliacheff revient sur l’œuvre de la journaliste Gitta Sereny, qui a travaillé dans ses livres sur les enfants tueurs.
Il faut redécouvrir l'œuvre de l'historienne et journaliste britannique Gitta Sereny. Née en 1921 à Vienne, elle a toute sa vie voulu comprendre d'où vient le mal et s'il est possible d'y échapper. Elle est un modèle d'enquêtrice par sa rigueur et sa ténacité. La pédopsychiatre Caroline Eliacheff, auteure de La Famille dans tous ses états (2004), connaît bien son œuvre, comme tous ceux qui tentent d'aider les enfants en souffrance. (...)
Les livres de Gitta Sereny sur les enfants meurtriers sont construits comme des enquêtes policières. Etes-vous une lectrice de romans policiers ?
Les romans policiers ont un rapport évident avec la démarche analytique : on cherche la clé de l'énigme. Je suis une "fan" d'Elizabeth George et son chef-d'œuvre Anatomie d'un crime a
beaucoup de points communs avec Une si jolie petite fille, de Gitta Sereny. L'un est un roman et l'autre
une enquête, mais dans les deux cas il s'agit de décortiquer ce qui amène un ou une enfant à commettre un crime.
Gitta Sereny est aussi célèbre pour ses livres sur les dignitaires nazis, Franz Stangl et Albert Speer.
Elle se rapproche en cela de la psychanalyste Alice Miller, qui elle aussi s'est intéressée aux nazis pour montrer combien une éducation basée sur l'humiliation et l'obéissance par la terreur pouvait
être pervertissante. Le Ruban blanc, de Michael Haneke, décrit parfaitement cette pédagogie noire.
Dans son œuvre, Gitta Sereny se confronte aux racines du mal : Tout homme ordinaire peut-il commettre le pire dans une situation extraordinaire ?
Nous avons à l'intérieur de nous des pulsions avouables et des pulsions inavouables ou plutôt qui ne doivent pas se réaliser. Les pulsions inavouables sont-elles capables de se révéler dans des
situations extrêmes ? C'est probable, mais le meilleur peut aussi survenir. (...)
Vous aviez lu Une si jolie petite fille, l'histoire de Mary Bell (11 ans) ayant assassiné deux petits garçons de 4 et 3 ans, en 1968, dans le nord de l'Angleterre
?
Je l'ai lu dès sa sortie. C'est un livre exceptionnel sur le plan journalistique et humain. Gitta Sereny a assisté au procès où Mary Bell a été reconnue coupable du meurtre de deux enfants puis elle
a enquêté et, surtout, elle a revu Mary Bell après sa longue incarcération. Au départ, Gitta Sereny annonce clairement son projet militant : se servir du cas de Mary Bell pour dénoncer le système
pénal anglais concernant les mineurs. Ceux-ci sont jugés comme des majeurs sans tribunaux spécifiques, vont en prison et ne bénéficient d'aucune prise en charge psychologique. Seuls les actes sont
pris en compte au mépris du contexte familial, social et de la minorité. Gitta Sereny a été beaucoup plus loin que son projet initial et j'admire sincèrement la relation qu'elle a nouée avec Mary
Bell : respectueuse, pleine de tact, mais ne lui laissant rien passer en revenant inlassablement sur ses silences et ses contradictions.
Dans La Balade des enfants meurtriers, son livre sur deux garçons de 10 ans ayant torturé et tué un enfant de 2 ans en 1993, près de Liverpool, en Angleterre, on
retrouve son interrogation sur les racines du mal.
Gitta Sereny a une certitude qu'elle partage avec Alice Miller : les enfants sont naturellement bons, ce sont les parents et la société qui les pervertissent. Il est indéniable que les parents et la
société puissent pervertir les enfants. Dans le cas de Mary Bell, nous sommes devant un cas extrême de perversion sexuelle et de maltraitance. Mary Bell a confirmé les théories de Gitta Sereny, et
même au-delà de ses espérances, car la journaliste n'avait pas imaginé un seul instant ce que la petite fille avait subi et qui n'avait pas intéressé les juges. Mais les enfants d'Outreau, exploités
sexuellement par leurs parents, ne sont pas devenus des enfants meurtriers. Les deux assassins anglais de 10 ans du petit James Bulger ont évolué dans un milieu défavorisé, avec des parents
dysfonctionnels repérés par les services sociaux, mais cela n'explique en rien leurs pulsions destructrices extrêmes. Les facteurs favorisants n'expliquent pas tout.
Existe-t-il des règles généralisables en matière d'enfants meurtriers ?
Dans des familles incroyablement dysfonctionnelles, il n'est pas rare de rencontrer des enfants qui peuvent en souffrir mais qui surmontent sainement les épreuves, même si elles laissent des traces.
A contrario, on voit dans des familles en apparence banales des enfants qui manifestent des tendances destructrices. La règle est de ne pas se laisser aveugler par les apparences. Car aucune famille
n'est banale et des enfants particulièrement sensibles ressentent de manière exagérée des choses que leurs parents leur font passer, même inconsciemment. Ils peuvent ainsi se retrouver pervertis
alors que sur d'autres cela va glisser comme sur les plumes d'un canard. Quelqu'un d'extérieur, aussi expérimenté soit-il, peut ne rien remarquer car les névroses et les traumatismes ne sont pas
visibles. Toute famille dysfonctionnelle ne va pas avoir un enfant dysfonctionnel. Toute famille saine ne va pas avoir un enfant sain. Quand on lit Une si jolie petite fille, on se dit que
tout était en place pour qu'on en arrive là, mais on aurait pu ne pas en arriver là. Le passage à l'acte conserve toujours une part de mystère d'autant qu'on imagine difficilement qu'un enfant
puisse être un meurtrier dans la réalité.
Gitta Sereny est une intellectuelle. Comprendre apaise-t-il ?
Les films d'Alfred Hitchcock, dont Pas de printemps pour Marnie, sont révélateurs de la période où l'on pensait que les symptômes avaient une cause et que, si par une cure analytique
on retrouvait ce traumatisme refoulé, on "guérissait". Malheureusement, c'est plus compliqué, et il ne suffit pas de comprendre pour renoncer à ses symptômes, tandis que ceux-ci peuvent disparaître
sans qu'on en ait compris l'origine. Mais la pulsion épistémophilique, la curiosité, est insatiable. Tous les chercheurs veulent comprendre, faire du sens, et nous sommes tous des chercheurs depuis
notre naissance. Alors, est-ce que trouver apaise? Oui et non, car il y a toujours autre chose à comprendre. Dans le cas des enfants meurtriers dont Gitta Sereny retrace l'histoire, ce qui est
important, ce n'est pas tant qu'elle comprenne mais qu'eux comprennent. Le passage à l'acte vient à la place d'autre chose, la parole, par exemple. Gitta Sereny le dit : les petits meurtriers sont
des enfants en souffrance qui expriment une souffrance qui n'a pas été entendue par les adultes. Ils vont beaucoup trop loin par rapport aux règles de la société pour faire entendre leur souffrance
et ils le savent. Les enfants distinguent tôt les notions de bien et de mal, en tout cas inconsciemment. Par sa démarche, Gitta Sereny a sans doute aidé Mary Bell à comprendre ses actes, mais il
semble que c'est la naissance de sa fille qui l'a fait accéder au sentiment de culpabilité.
Partagez-vous le combat de Gitta Sereny contre le système judiciaire britannique ?
Son combat est juste. Tout mineur devrait avoir le droit d'être jugé par un tribunal pour mineurs. Or la tendance, y compris en France, est de traiter pénalement les mineurs comme des majeurs.
Gitta Sereny tient un discours de compassion sur les bourreaux sans nier la souffrance des victimes. Est-ce audible ?
Je ne trouve pas que Gitta Sereny soit particulièrement compassionnelle et c'est tant mieux, car elle perdrait toute objectivité. Il n'y a pas plus horrible pour un parent que d'avoir un enfant
assassiné. Mais les victimes, ce sont les enfants qui sont morts. Les enfants meurtriers sont vivants et on ne guérira pas la souffrance des parents en niant qu'il faut s'occuper des vivants.
Livres Hebdo, 10 mars 2017
par Laurent Lemire
Gitta Sereny revient sur le meurtre du petit James Bulger. Les coupables étaient deux enfants.
Les livres de Gitta Sereny (1921-2012) sont toujours des plongées saisissantes dans le tréfonds de l’âme humaine. On ne sait comment ce petit bout de femme téméraire en est venu à s’intéresser à Franz Stangl, le commandant du camp de Treblinka, à Mary Bell, cette fillette de 11 ans qui a assassiné en 1968 à Newcastle deux garçons de 3 et 4 ans, et à ces deux gosses de 10 ans qui ont massacré, il n’y a pas d’autres mots, un bambin de 2 ans, une nuit de février 1993, près de Liverpool. L’affaire James Bulger - c’est le nom du pauvre gosse - fit grand bruit en Angleterre. D’autant plus qu’on avait appris, grâce aux caméras de surveillance, que le gamin qui avait échappé à la vigilance de ses parents dans ce centre commercial avait croisé des passants alors qu’il était malmené par les deux autres…
Dans ses articles publiés dans The Independent, la journaliste revient un an plus tard sur les faits et sur les lieux. Elle raconte comment Jon Venables et Robert Thompson ont méticuleusement martyrisé et tué le petit James Bulger avant de déposer son corps sur une voie ferrée où il fut coupé en deux par un train, pour faire croire à un accident. Elle raconte la tragédie, mais ne l’explique pas. Fatalement, elle compare cet épouvantable crime avec le double meurtre commis par Mary Bell à qui elle avait consacré un livre retentissant, Une si jolie petite fille (Points, 2016).
Pour tenter de comprendre, elle interroge les parents des assassins, les travailleurs sociaux, les instituteurs, les policiers. "Les jours que j’ai passés là-bas resteront parmi les plus tristes que j’ai connus." On vous passe les détails sordides du meurtre. Ce qui fascine, c’est sa force d’investigation, cette volonté d’aller au bout, de se saisir du moindre détail. Personne n’avait rien vu venir. Et pourtant, ce reportage révèle les dysfonctionnements des structures éducatives, sociales et le délabrement familial dans un contexte à la Ken Loach avec chômage, alcool et misère. (...)
"L’affaire Bulger, par son horreur extrême, a démontré avec force ce qui ne va pas." La puissance des livres de Sereny, c’est qu’ils nous renvoient à nous-mêmes, à la manière dont nos sociétés fonctionnent et punissent. Sa façon d’enquêter pose des questions sur les médias, l’opinion publique, la justice. En pratiquant un journalisme qui s’élève à la hauteur de la littérature, sans voyeurisme mais sans cacher non plus la férocité de cette mort, elle porte un regard d’une lucidité terrible sur ces ténèbres d’inhumanité, d’autant plus angoissantes qu’elles surgissent d’actes d’enfants.
L'Express, 8 mars 2017
La Balade des enfants meurtriers
par Jérôme Dupuis
En 1993, dans un centre commercial de Liverpool, le petit James Bulger, 2 ans, est enlevé par deux garçonnets de 10 ans. (...) À l'époque, le visage juvénile des meurtriers a horrifié le monde entier. "Les coupables ne peuvent pas être ces bambins !" s'écriera un policeman. Si. C'est là que la journaliste britannique Gitta Sereny entre en scène. L'auteur d'Une si jolie petite fille, ce livre bouleversant consacré à Mary Bell, meurtrière à 11 ans, a suivi l'enquête et le procès. On plonge donc avec elle dans le milieu ouvrier de Liverpool - familles nombreuses, alcool, petits boulots... Une nouvelle fois, on mesure combien la violence donnée n'est bien souvent que la reproduction héréditaire d'une violence subie. Fidèle à sa méthode, Gitta Sereny a voulu comprendre plutôt que juger. Un modèle du genre.