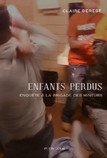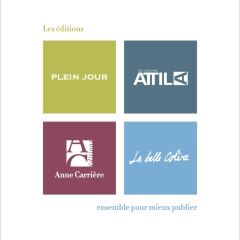Die Welt, 26 février 2015
Schon Kinder bezahlen für Sex
par Verena Hölzl
In Frankreichs Schulen gehört Prostitution zum Alltag. Jungs "verkaufen" ihre Freundinnen.
(...) Von solchen Fällen kann auch Claire Berest erzählen. Die ehemalige Lehrerin hat für ein Buchprojekt über die Befindlichkeiten französischer Jugendlicher ein Dutzend Polizisten aus der Jugendschutzabteilung der Pariser Polizei interviewt. Verrohung von Sexualität sei demnach keine Frage des Milieus. "Die Geschichten aus Vorortschulen und prestigeträchtigen Pariser Gymnasien unterscheiden sich nicht", stellt die 32-Jährige fest. Das bestätigt auch Vianney Dyèvre, der seit September in Paris die Jugendschutzabteilung der Polizei leitet. Allerdings warnt er vor Alarmismus. Der Begriff Prostitution geht ihm in die falsche Richtung. Für ihn handelt es sich um Vergewaltigungen, mehr und mehr auch in der Gruppe verübt, bei denen Täter und Opfer fast noch Kinder seien. Auf das Schulmilieu will er sich dabei nicht festlegen. (...)
Les Inrockuptibles, 26 mars 2014
Quand la littérature s'inspire du reportage
par Emily Barnett
Un hypermarché vu par Annie Ernaux, la brigade des mineurs scrutée par Claire Berest : les écrivains entrechoquent écriture et faits sociaux.
(...) De la violence symbolique à la brutalité concrète enregistrée au centre de la brigade des mineurs, il n'y a qu'un pas, à franchir avec le livre de Claire Berest. Cette ex-enseignante de 31 ans s'appuie sur les stigmates laissés par son passage à l'Éducation nationale et un malaise ambiant pour tenter de comprendre ce qui est perçu comme une banalisation de la violence chez les adolescents.
Loin de tout "étalage cru", Enfants perdus interroge les comportements d'adolescents égarés ou criminels, entre chantage sexuel sur Facebook, enfants roms acculés au délit et crime passionnel lycéen... Une enquête minutieuse et extrême que l'on referme dans un vertige.
France Inter, 25 février 2014
Le Figaro littéraire, 13 février 2014
La cité des enfants perdus
par Françoise Dargent
On les appelle les digital natives, les "numériques natifs", une génération née à l'heure d'Internet dont le comportement s'intrique intimement avec les nouvelles technologies. Claire Berest les connaît, ces adolescents. Elle avait 25 ans lorsqu'elle a démissionné de son poste de professeur de français à Bobigny, il y a sept ans. "Je me suis dissoute dans ces salles de classe où je n'ai pu ne serait-ce qu'entamer un dialogue. Je n'ai rien compris d'eux, je n'ai rien reconnu." De ce constat d'échec est né ce récit, plongée au cœur de ce que l'adolescence a de plus noir. Enfants perdus est une enquête à la brigade des mineurs pour savoir ce qui cloche chez ces adolescents indéchiffrables. (...)
La Montagne, 8 février 2014
"Alertez les adultes !"
par Daniel Martin
(...) Claire Berest (...) a suivi le travail de la brigade des mineurs pendant des mois. Elle a été déstabilisée par ce qu'elle a découvert. Et qu'elle révèle. Des faits bruts, brutaux, qu'elle accompagne de paroles de profs, de psys, de magistrats, etc. Pour tenter de comprendre. (...)
Elle relate un certain nombre de ces faits - "je n'ai pas gardé les plus trash" - dans ce livre qu'elle tient entre reportage et littérature pour garder la mesure, permettre la réflexion. "Qu'est-ce que cela dit de la société ?", se demande-t-elle sans condamner ni les enfants ni les parents. L'important pour elle est de témoigner pour que l'on sache et prenne conscience de ce nouvel état. "A force de nier le réel, il va nous exploser au visage", dit un policier. (...)
Elle, 31 janvier 2014
Le collège de toutes les violences
dossier réalisé par Isabelle Duriez, Elvire Emptaz et Charline Blanchard
Le livre va terrifier les parents. Enfants perdus. Enquête à la brigade des mineurs raconte que, dès 12 ans, des enfants imposent des pratiques sexuelles extrêmes à leurs camarades. Effet de loupe ou réalité ?
Trois pages d'enquête incluant un entretien avec Claire Berest.
Arte, 27 janvier 2014
La Provence, 26 janvier 2014
Claire Berest, en immersion chez les mineurs
propos recueillis par Denis Trossero
"Il faut mettre des mots sur les inquiétudes qui traversent la société. Il ne faut jamais s'arrêter d'en parler." Claire Berest s'est attaquée à un sujet difficile, souvent douloureux : les mineurs. À l'heure où certains délinquants tuent et violent, à l'heure où les autorités cherchent des parades adaptées, un livre passe au crible l'univers de ces jeunes souvent sans repère ni boussole. Victimes ou délinquants. Parfois victimes, parfois délinquants. Leur course folle passe parfois par la brigade des mineurs de Paris, cette "arrière-cuisine de la société". Qui sont-ils ? Quels profils livrent-ils ? Dans son dernier livre, paru cette semaine, Enfants perdus, l'auteur s'est immergée avec les "flics" dans leur univers codé. Elle en décrypte les signes, livre crûment les mots de ces policiers qu'elle qualifie de "héros modernes" et trace des pistes pour l'avenir.
Pourquoi ce livre ? Pourquoi avoir fait le choix d'une immersion ?
Claire Berest : J'ai écrit ce livre parce que c'était un sujet d'interrogation pour moi depuis que j'ai quitté l'enseignement. Pourquoi je ne suis jamais arrivée à communiquer avec ces jeunes.
Pourquoi nous, les professeurs, nous étions des étrangers. J'ai essayé de pointer un certain nombre de problèmes dans le bateau de l'Éducation nationale en train de couler. Ce sujet des ados était un
sujet de préoccupation constante pour moi. Au départ, je préparais un autre roman, dont l'un des personnages était un enquêteur. J'ai rencontré un ancien de la brigade des mineurs, qui y avait passé
huit ans et demi, puis d'autres. J'ai très vite oublié les fiches de mon roman pour me dire : de cette expérience, il faut que je tire un livre.
(...)
LCI, 23 janvier 2014
TF1, 20 janvier 2014
Le Journal du dimanche, 20 janvier 2014
Comment se porte la jeunesse française ?
L'auteur de La Lutte des classes a suivi le travail de la brigade des mineurs de Paris pour comprendre le mal-être des adolescents d'aujourd'hui. Rencontre.
Elle aurait aimé leur dire : regardez le mal que vous vous faites. Car elle les a déjà rencontrés. La romancière Claire Berest a été, après un an de stage, professeure de français titulaire en zone d'éducation prioritaire (ZEP) à Bobigny. Une vocation viscérale, née d'un amour de la jeunesse. L'enseignante avait 25 ans ; les élèves étaient âgés de 15 ans. Choc. Elle s'est retrouvée face à des jeunes violents, sans moyen de canaliser leur agressivité. Elle devait encadrer et non enseigner. Elle a démissionné de l'Éducation nationale, au bout de cinq semaines, avec le sentiment de n'avoir rien pu leur apporter. "Il n'existait plus de passerelles entre nous. J'ai eu conscience d'un gouffre. Nous étions des étrangers les uns pour les autres, sans repères ni références communes." Claire Berest a raconté tout cela dans La Lutte des classes (2012). Aujourd'hui, elle n'a rien oublié. La jeune femme de 32 ans se surprend à sortir de ses gonds lorsqu'on aborde l'avenir des adolescents français. Claire Berest est alors partie, une nouvelle fois, à la rencontre des jeunes. Elle a suivi, pendant des mois, le travail des policiers de la brigade des mineurs de Paris ; elle a écouté enseignants, politiques, magistrats, pédopsychiatres ; elle s'est replongée dans son adolescence. Qu'est-ce qui ne va pas?
Claire Berest habite dans le 18e, à Paris, près de la gare du Nord. Elle observe et elle est observée. Elle rentre parfois tard le soir. Elle ne se sent pas en danger ; elle ne se sent pas en sécurité. Elle dit : rien de vraiment grave ou rien de grave, vraiment. Des remarques plus ou moins crues de la part de jeunes gens. Mais la violence est dans l'air et retombe tôt ou tard en pluie grêlée. Les accidents se multiplient. La haine fédère. Claire Berest continue donc à vivre au contact d'une jeunesse qui lui est devenue incompréhensible. L'idée de connaître la réalité de la brigade des mineurs est née d'un hasard. L'auteur de L'Orchestre vide (2012) décide de rencontrer un policier pour son prochain roman, dont un des personnages est un enquêteur. Le policier a appartenu à la brigade des mineurs durant huit ans. Elle l'écoute. Son choix est fait. Elle va suivre leur travail. (...) Claire Berest s'inscrit dans la démarche de Polisse, de la réalisatrice Maïwenn Le Besco, mais en axant son travail sur les crimes commis par des enfants sur des enfants.
Les policiers ont un accès sans filtre à l'intimité des adolescents puisqu'ils ont accès aux portables. Claire Berest va les côtoyer et les interviewer. Les questions sont ouvertes lors de ses entretiens avec les policiers. "Une enquête intéressante est une enquête qui déborde le cadre fixé au préalable. Mes questions non orientées ont débouché sur la problématique de la sexualité des adolescents dans tous les milieux sociaux. Je ne m'attendais pas à devoir repenser la notion de corps."
Elle découvre un univers où des enfants de 12 ans pratiquent la fellation et la sodomie et où des filles doivent faire attention à ne pas passer pour des "putes" ou des "niaises". L'instinct grégaire règne, car il s'agit de plaire. L'obsession : ne pas être mis au ban, ne pas se retrouver isolé. Les filles sont, plus que les garçons, victimes d'un ordre amoral. L'accès à Internet a tout changé pour la nouvelle génération. (...)
Claire Berest rend hommage au chef de la Brigade de protection des mineurs, le commissaire divisionnaire Thierry Boulouque, et à tous ses enquêteurs. Le même désamour frappe policiers et professeurs. Ils ne s'apprécient pas entre eux. Mais ils sont révélateurs d'un problème des jeunes avec l'institution, l'autorité, l'ordre. Claire Berest a cependant découvert des policiers qui se portent plutôt bien. "Ils mettent en place des garde-fous ; ils arrivent à effacer le disque dur des horreurs de la journée en quittant leur bureau ; ils font mentir la légende des flics dépressifs et alcooliques." (...)
Elle et eux. Faire raconter et savoir écouter pour réussir à comprendre. Romancière et policiers se rejoignent dans la recherche d'une vérité à débattre. Des kilomètres de procès-verbaux, d'un côté ; des centaines d'heures d'entretiens, de l'autre. (...) Claire Berest s'est retrouvée à la tête d'une vaste matière sombre, diverse, horrifiante en recueillant les propos des différents protagonistes. Elle prend garde à ne pas tomber dans le voyeurisme. Elle a eu un seul but : réussir à se mettre d'accord sur ce qui se passe dans la jeunesse française.
Le grand écart. Claire Berest se tient à équidistance d'une vision apocalyptique de la jeunesse (type Alain Finkielkraut) et d'une vision angélique de la jeunesse (type François Bégaudeau). Son dialogue de sourds avec un pédopsychiatre est emblématique des désaccords autour des adolescents. Dire qu'ils vont bien ne les empêche pas d'aller mal, mais voir qu'ils vont mal oblige à tenter d'agir pour leur bien. Un policier : "À force de nier le réel, il va nous exploser au visage." Claire Berest a mené une enquête passionnante. Une question se dessine : comment a-t-on fait naître cette cruauté parmi les jeunes? Ils habitent un monde virtuel de plus en plus coupé du monde réel. (...)
Claire Berest a voulu comprendre une génération devenue étrangère à ses yeux. "Je m'inquiète pour mes cadets." Elle l'aime et la déteste, à la fois, cette jeunesse à la dérive. Elle la connaît : le manque de courage, d'originalité, d'effort. La déresponsabilité permanente. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais non, en fait, c'est faux. Elle l'aime, malgré tout, cette jeunesse en souffrance. "Je me retrouve avec des amis à converser sur notre propre adolescence. Je me souviens alors de l'absence de recul par rapport aux événements. C'est jamais. C'est toujours. Que va devenir cette génération dont les turpitudes vont être fixées ad vitam aeternam sur Internet ? Il faut mouiller sa chemise, quand on parle des jeunes. Se souvenir de l'adolescent qu'on était et savoir que c'est le monde du voilement. Il est nécessaire de retrouver la permanence de l'adolescence, face à ce qui nous échappe chez eux." Enfants perdus témoigne de cet amour citoyen pour la jeunesse. Le constat est sans concession pour que la solution soit trouvée sans tarder. C'est un livre de lutte et d'espoir. La brigade des mineurs est ouverte 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Elle est domiciliée au 12, quai de Gesvres à Paris. Les lumières y sont toujours allumées.
Le Journal du dimanche, 29 décembre 2013
Quatre femmes racontent les corps et les cœurs
par Marie-Laure Delorme
Elles sont les vedettes de la rentrée 2014. Lola Lafon, Maylis de Kerangal, Nina Bouraoui et Claire Berest reviennent en force avec des livres coups de poing.
(...) À qui appartient notre corps ? (...) Chaque siècle, chaque pays, chaque histoire apporte sa réponse. Claire Berest cite, en exergue de son passionnant essai sur une jeunesse sans repères, une phrase extraite de Merci la vie du réalisateur Bertrand Blier : Je voudrais bien qu'on se mette d'accord sur l'époque dans laquelle on vit. Elles sont quatre et, qu'elles fassent ou non appel à la fiction, elles tournent le dos aux légendes et aux mythes pour regarder la réalité en face. Elles préfèrent la vie rivée à la vie rêvée. Il est urgent de se mettre d'accord sur l'époque dans laquelle on vit.