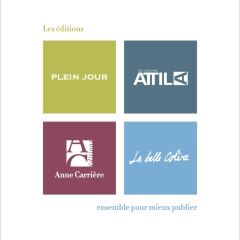Initiales magazine, décembre 2016
Dans l'ombre du Reich
par Guillaume Bourain (librairie Les Saisons, La Rochelle)
Conseiller à tous un livre de 500 pages sur le nazisme n'est pas chose courante pour un libraire.
Dans l'ombre du Reich s'impose pourtant comme une lecture majeure, trépidante et indispensable. C'est avant tout l'œuvre d'une vie, celle de Gitta Sereny, journaliste émérite qui a vécu l'ascension du Reich. Elle dut s'exiler adolescente, a mené diverses actions de résistance et s'engagea après-guerre pour aider les populations rescapées des camps, notamment les enfants. Enfin, elle consacra sa vie journalistique à couvrir des procès, à interroger des criminels nazis et des Allemands de tous horizons, afin de comprendre comment l'impensable avait pu se commettre et comment tenter d'y faire face ensuite.
Loin d'être un livre plombant, où l'horreur serait figée, solennelle, Dans l'ombre du Reich nous fait sans cesse basculer dans des réflexions vives et intenses d'une portée universelle. (...)
On lit tour à tour un journal de bord, un roman d'aventure, un thriller digne du Silence des agneaux dans ses face à face avec d'anciens criminels nazis, un polar juridique et bien sûr un essai aussi profond que passionnant sur la nature humaine.
Preuve est faite que les horreurs résultent de mécanismes de société pervertis dont nous pouvons encore être pétris (...). Dans l'ombre du Reich nous donne une force neuve, vitale et concrète pour faire face au passé (qui est aussi celui de la France) mais aussi veiller au présent. Un ouvrage passionnant, impossible à lâcher une fois commencé, parfois éprouvant certes, mais dont la lecture est aussi indispensable que gratifiante.
Association des professeurs d'histoire et de géographie, 5 juillet 2016
par Franck Schwab (1)
Gitta Sereny n’avait que treize ans lorsque, au hasard d’une panne de train, elle se retrouva plongée en plein congrès de Nuremberg, et elle en atteignait presque quatre-vingts lorsqu’elle interrogea la dernière secrétaire d’Adolf Hitler sur son maître pour le reportage qui conclut son livre. Entre ces deux moments, la journaliste passa son existence entière à observer le nazisme sous toutes ses formes et sous tous ses effets.
Elle le fit d’abord comme témoin direct : à Vienne, sa ville natale, où elle protesta, en 1938, contre les violences qu’elle vit infliger aux Juifs avant de quitter le pays et de rejoindre deux ans plus tard la Résistance française, mais aussi dans l’Allemagne de l’immédiat après-guerre où elle participa, comme assistante sociale, à la douloureuse recherche des enfants que les nazis avaient volés dans toute l’Europe afin de les rendre à leurs parents. Pendant tout le demi-siècle suivant, elle mesura les marques que le nazisme avait laissées chez ses anciens acteurs et dans une société allemande où, selon ses propres mots, « la dénazification [avait] été une farce ». Ce furent alors les grandes enquêtes et les grands portraits qui établirent sa notoriété.
D’abord celui de Franz Stangl, le commandant de Treblinka - mais aussi, précédemment, du centre d’euthanasie d’Hartheim - qu’elle alla rencontrer dans sa prison allemande (...)
Ce fut ensuite le portrait d’Albert Speer, individu à l’humanité tout aussi dégradée par le nazisme que Stangl, mais bien plus complexe et intelligent ; ou encore celui de John Demjanjuk, le fruste gardien de Sobibor dont Gitta Sereny retraça l’histoire des différents procès. Pour ces criminels si différents, mais si compromis, chacun à son niveau, dans l’entreprise de mort nazie, l’auteur pose les questions fondamentales de la responsabilité individuelle ; du mensonge et de la culpabilité. Ces mêmes questions hantent également, dans les autres enquêtes recueillies ici, les enfants et les parents des hiérarques du régime. Elles hantent aussi les générations successives de jeunes, et au-delà, toute la société allemande qui - nous pouvons en être certains - se les posera encore pendant longtemps.
(1) Reprise de l'article paru dans Le Patriote résistant (revue mensuelle de la Fédération nationale déportés et internés résistants et patriotes, créée en 1946), juin 2016.
Blog librairie Mollat, 7 avril 2016
Parfois on s'interroge sur la façon dont des événements tragiques ont pu être possibles...
par Mylène Ribereau
Dans ces moments-là, il est toujours intéressant de regarder ce que l’Histoire nous lègue comme matière à penser. Il faut parfois en passer par des lectures marquantes, perturbantes dans le sens où elles bousculent nos représentations sociales et historiques, souvent trop manichéennes. Mais c’est surtout au sujet de ce qu’elles révèlent des hommes que nous nous trouvons interrogés. (...)
Ces questions sont particulièrement présentes lorsque l’on aborde la Seconde guerre mondiale et le génocide des Juifs. La récente publication aux éditions Plein jour du titre posthume de Gitta Sereny, Dans l’ombre du Reich fait écho à l’excellent travail de Johann Chapoutot, La loi du sang, penser et agir en nazi paru chez Gallimard en 2014. Ces deux livres, d’une intelligence rare, abordent avec justesse cette période complexe.
Leur force est notamment due à leur puissance d’écriture. Chacun dans leur style, Gitta Sereny et Johann Chapoutot mettent parfaitement en lumière la mécanique nazie qui a su, par la complicité des élites, s’immiscer dans les institutions du droit, de la santé et de la sécurité et reposer ainsi sur les fondements de la société allemande d’alors. Cette mise en place de la politique nazie les conduit à s’interroger sur ces acteurs connus mais aussi et surtout sur les lambda qui y ont participé.
Comment alors admettre (et non cautionner) l’ampleur et la complexité de l’humanité en de pareilles circonstances ?
Comment envisager que les plus insoutenables actes commis sous le IIIe Reich furent réalisés par des êtres humains intelligents, sensés et non des fous écervelés assoiffés de haine et de vengeance ?
Fortes de nombreuses archives, leurs analyses nous invitent à comprendre comment le pire fut rendu possible et les conséquences que cela eut à la fois dans l’immédiateté de la guerre mais également sur les générations à venir en Allemagne.
Face à ces difficiles mais non moins nécessaires questions, ces deux auteurs sont à connaître, à lire et à relire tant ils nous éclairent sur la réalité des événements du passé et nous donnent des clés pour mieux comprendre les enjeux du présent.
Blog Social en question/Mediapart, 30 mars 2016
Gitta Sereny et les enfants volés du Reich
par Yves Faucoup
Dans un ouvrage récemment traduit en français, la journaliste Gitta Sereny raconte son expérience dans l'Allemagne d'après-guerre qui a consisté à enquêter sur les enfants enlevés à l'Est par les nazis et adoptés par des couples allemands. Plongée dans une histoire tragique et approche d'une écrivaine de grand talent.
Les éditions Plein Jour viennent de publier en français Dans l'ombre du Reich, un livre de Gitta Sereny, sorti en 2000, jamais traduit jusqu'alors. Cet ouvrage de plus de 500 pages regroupe plusieurs articles de la journaliste dont l'un présenté ici, qui aborde un sujet peu traité, celui des enfants volés par les nazis dans les pays de l'Est et donnés à des familles allemandes.
Certes, on connaît les Lebensborn ["fontaines de vie"] où des femmes allemandes venaient mettre au monde, dans les maternités SS, des enfants pour le IIIème Reich, pour que le régime d'Hitler dispose de bras dans les usines et de chair à canon sur les champs de bataille. Mais ce que décrit Gitta Sereny c'est l'enlèvement délibéré, dans des familles russes ou polonaises, d'enfants dont l'apparence "aryenne" pouvait convenir au dogme racialiste et convaincre les familles adoptantes que leur progéniture provenait bien de familles allemandes vivant, opprimées, dans ces contrées ennemies. L'objectif était double : appauvrir la démographie des pays conquis et renouveler la population germanique. Ces enfants passaient aussi par les Lebensborn, qui accueillirent 250 000 enfants de l'Est afin de les germaniser et, après tri et soins, les redistribuer à des familles allemandes.
Gitta Sereny, d'origine hongroise, ayant vécu son enfance à Vienne, puis suivi des études à Londres, assista au congrès nazi de Nuremberg en 1934 suite à un incroyable hasard (son train était tombé en panne dans cette ville). Elle n'a alors que 13 ans et est fascinée par le décorum : elle l'avoue tout en disant sa honte d'avoir pu éprouver un tel sentiment. Quatre ans plus tard, de retour à Vienne, elle est là quand le Führer, après l'Anschluss, prononce un discours tonitruant dans la capitale autrichienne.
Après avoir vécu à Paris où elle exerce pendant l'Occupation une fonction d'infirmière bénévole dans une organisation humanitaire, L'Auxiliaire sociale, et participe à des actes de Résistance, elle quitte Paris en 1942 pour New York. Elle revient en Europe dans les bagages de l'armée américaine, au titre de l'UNRRA, l'Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, chargée de la protection de l'enfance.
Sa première mission consiste à soigner des enfants du camp de concentration de Dachau, récemment libéré. Il s'agissait d'enfants de toutes nationalités, même des Allemands, mais très peu de Juifs, déjà mis à mort. Les Allemands étaient pour la plupart des enfants d'officiers accusés de trahison, incarcérés ou exécutés.
Gitta Sereny appartient à une équipe de spécialistes dans l'accompagnement d'enfant souffrant de troubles affectifs graves, mais cette équipe ne se contente pas de faire dans la protection sociale : elle est amenée à dénoncer des criminels de guerre, des anciens gardiens SS, qui se cachent dans les camps de personnes déplacées. (...)
Gitta Sereny raconte qu'une Agence centrale de recherche recevait, en provenance de Pologne, d'Ukraine ou des Pays baltes, des milliers de clichés d'enfants, avec indication de date et des conditions de leur disparition. Des "agents enquêteurs de l'aide à l'enfance" furent chargés d'effectuer les recherches. Quiconque, suspecté, ne collaborait pas aux enquêtes pouvait être sévèrement puni (l'avis officiel précisait : "à l'exclusion de la peine de mort").
Les Soviétiques, de leur côté, voulaient récupérer les enfants russes qui séjournaient dans les maisons d'enfants ou qui avaient été adoptés par des familles allemandes. C'est ainsi que Gitta raconte l'histoire de deux enfants de six ans qu'elle nomme "Johann" et "Marie" : un couple de paysans, ayant perdu leur fils dans les combats sanglants de Stalingrad, avait recueilli ces deux enfants trois ans et demi plus tôt. La famille, grand-père compris, se ligue pour expliquer que ces enfants ne peuvent être "de l'Est", sous-entendu de ces dégénérés polonais : "il suffit de les regarder" ! Mais les vrais parents, des jeunes fermiers de Lodz, non seulement reconnurent leurs enfants mais donnèrent une précision imparable (un petit grain de beauté, qui, s'il avait été à peine plus gros, aurait, d'emblée, empêché à l'enfant d'être adoptée, car indigne d'être "germanisée"). Gitta Sereny dut enlever ces deux enfants à ce couple pour les rendre à leurs parents. Des drames de cette sorte (car ces enfants arrachés à leurs "parents", le plus souvent, avaient perdu leur langue maternelle et ne se souvenaient plus du passé) eurent lieu par milliers.
Dans cet ouvrage, Gitta Sereny aborde bien d'autres sujets : comme l'état d'esprit des jeunes Allemands à la fin des années 60 par rapport à ce passé de leurs parents ayant collaboré avec le pouvoir nazi, en ayant été complices ou en l'ayant toléré. Ces textes fourmillent d'informations, de réflexions, de questionnements, de réponses à de nombreuses interrogations, le tout par l'entremise d'une écriture captivante, fluide et par une maîtrise parfaite de la construction d'ensemble. Elle ne s'attarde pas sur certains aspects de sa vie exceptionnels. Par ailleurs, elle passe de New York à l'Allemagne occupée d'un trait de plume. Elle était l'épouse d'un grand photographe, Don Honeyman, qui travaillait à Vogue et au Daily Telegraph, mais surtout connu pour avoir fait le célèbre poster avec la photo de Che Guevara sur fond rouge.
Philosophie Magazine, 29 mars 2016
par Victorine de Oliveira
Des criminels nazis Albert Speer et Franz Stangl à l’enfant meurtrière Mary Bell, la journaliste Gitta Sereny (1921-2012) n’a cessé au fil de ses multiples enquêtes et ouvrages d’interroger les mécanismes de ce que nous regardons comme le mal absolu. Dans l’ombre du Reich témoigne à la première personne d’heures sombres et du travail de reconstruction, de mémoire, mais aussi des tentatives d’oubli qui ont suivi la défaite des nazis en Allemagne. Les interactions permanentes entre expériences, émotions et souvenirs personnels, et les analyses historiques, sociales et journalistiques de l’auteur font toute l’originalité de son travail. (...) A la Libération, elle retourne en Europe pour s’engager comme agent chargé de la protection de l’enfance au sein de l’Administration des Nations unies. Là, elle découvre le drame des enfants enlevés à leur famille de l’Est pour être « aryanisés » et confiés en adoption à des couples allemands. Se confronter à la douleur de familles et d’enfants qui pour certains ne reconnaissent plus leurs véritables parents en Pologne marque Gitta Sereny à vie. Elle précise pourtant : « Je crains de n’avoir pas été une héroïne. »
Est-ce pour conjurer cette crainte, cette quasi-culpabilité, que Sereny s’attelle à l’exploration psychologique des bourreaux ? La fréquentation assidue des procès qui continuent aujourd’hui encore de rappeler à l’Allemagne son « passé récent » permet à la journaliste d’identifier et déconstruire la couche épaisse de mensonges, de mauvaise foi et de déni qui permit à certains d’accomplir le pire, à d’autres de les accompagner aveuglément. Sa méthode ? La conversation. D’abord les nombreux entretiens avec Stangl ou Speer, puis cette façon d’écrire comme on tâtonnerait tout doucement dans le noir en prenant le lecteur à témoin, avec toutefois la certitude de parvenir bientôt à la vérité. Car Sereny n’hésite pas à partager ses doutes, ses anxiétés, ou la satisfaction d’avoir confronté le bourreau à ses propres contradictions. Rien ne lui échappe : rougissement, inflexions dans le ton de la voix, changements d’accent, tics nerveux… Elle ausculte au plus près le corps du mal qui, loin d’être fascinant, apparaît misérablement humain.
Libération, 5 mars 2016
par Marc Semo
Toute sa vie fut hantée par le nazisme. Adolescente hongroise de bonne famille, elle est bloquée à Nuremberg par une panne du train qui l’emmenait à son pensionnat anglais. C’était en plein congrès à grand spectacle du parti nazi. « Je fus subjuguée par la vision de ces cohortes de militants défilant dans une symétrie parfaite, par les nombreux enfants, par les visages joyeux qui m’entouraient, et les rythmes, les sons, la solennité des silences, la couleur des drapeaux, la magie des éclairages », racontait au soir de sa vie Gitta Sereny, devenue entre-temps une des plus fameuses journalistes anglo-saxonnes. Elle a écrit aussi sur d’autres sujets et consacré un livre à une criminelle de 11 ans, Mary Bell, dont le forfait bouleversa le Royaume-Uni : Une si jolie petite fille. Le «traumatisme allemand» - sous-titre de son dernier ouvrage - apparaît néanmoins comme un fil rouge qui marque sa carrière, à travers des rencontres avec des criminels nazis : Franz Stangl, le responsable du camp d’extermination de Treblinka, ou Albert Speer, l’architecte préféré d’Hitler et metteur en scène des cérémonies nazies. Livre de mémoire autant que recueil d’articles, Dans l’ombre du Reich, qui commence à Nuremberg, s’achève en 2000 sur une rencontre avec Traudl Junge, jusqu’au bout l’une des secrétaires d’Hitler.
L’obsession de Gitta Sereny a toujours été de comprendre comment l’on peut devenir un monstre, ce basculement ou ce long glissement vers le pire. « Pour moi, la réponse à cette question fondamentale se situe moins dans un registre théorique et intellectuel que sur un plan intime et humain », explique la journaliste. Ses entretiens avec Franz Stangl, Au fond des ténèbres, ont fait l’objet d’un livre devenu un classique. Mais ce fut d’abord un long article publié par le Daily Telegraph Magazine, racontant la genèse de sa rencontre avec ce sinistre bourreau ordinaire, happé par les circonstances, et devenu le responsable direct de l’extermination au Zyklon B de 900 000 personnes. Condamné à la prison à vie en Allemagne en 1970 dans le plus important procès depuis Nuremberg, Stangl n’est pas un fanatique ni un organisateur de la Shoah comme Adolf Eichmann. Autrichien catholique, ce policier traque même les nazis - et obtient une décoration - avant l’Anschluss. Après l’annexion, il est obligé de montrer d’autant plus de zèle qu’il doit faire oublier ce passé. C’est ainsi qu’il commence sa carrière de criminel génocidaire. Quand il rencontre Sereny, il est déjà emprisonné depuis quatre ans. Son passé le tourmente et il raconte comment il refusait toujours de se rendre au baraquement où les déportés se déshabillaient avant la chambre à gaz : « J’étais incapable de me confronter à ces gens ; je ne pouvais leur mentir sur ce qui les attendait. » Mais il est en même temps pétri de bonne conscience. Quand elle lui demande s’il avait de la haine pour les juifs, il répond : « Cela n’a aucun rapport avec la haine ; ils étaient si faibles, ils acceptaient tout […] c’est ainsi qu’est né le mépris. » Il est mort d’une crise cardiaque quelques jours après la fin de leurs entretiens.
L’immense talent de Gitta Sereny est de savoir rendre leur part d’humanité aux bourreaux, ce qui est encore plus dérangeant. Beaucoup, dans des circonstances similaires, pourraient faire pareil. Elle est dans le gris de la vie, loin de tout manichéisme. Juste après l’effondrement du Reich, elle travaille en Allemagne dans l’une des premières organisations humanitaires des Nations unies pour récupérer les « enfants volés » - notamment en Pologne - blonds et quasi aryens, placés dans les Lebensborn et ensuite donnés à des familles allemandes. (...) Gitta Sereny le raconte tout en nuances, comme quand elle parle des jeunes Allemands des années 60, de leur ignorance du nazisme et du silence des parents. « Nous sommes obligés de les taxer de mensonge ou de construire notre vie sur un vide », lui explique l’un d’eux. Jusqu’au bout elle est restée lucide sur l’histoire allemande. « A la surprise du monde et de l’Allemagne elle-même, l’horreur qu’il [Hitler, ndlr] a provoquée en leur nom les a changés, les a transformés en un peuple différent », note-t-elle à la fin de sa vie, soulignant que, « toujours vulnérable aux accusations de xénophobie, l’Allemagne a été contrainte par l’histoire à devenir la société la plus ouverte d’Europe ». Mais peu avant sa mort en 2012, elle voyait aussi le retour, notamment dans les Länder de l’ex-Est, d’une extrême droite xénophobe.
Le Monde des livres, 4 février 2016
Gitta Sereny dans les tréfonds de l'âme nazie
par Jean-Louis Jeannelle
Difficile de savoir qui est le plus fascinant, de Gitta Sereny elle-même ou des personnalités sur lesquelles cette grande journaliste écrivit tout au long de sa carrière. Née à Vienne en 1921, la jeune femme dut fuir dès 1938 en Suisse puis à Paris, avant de gagner les États-Unis qu’elle sillonna pour alerter l’opinion américaine à raison de trois conférences par jour.
Mais pourquoi avoir, après la guerre, déployé tant énergie à explorer la culpabilité allemande ? Non seulement à lutter contre les négationnistes de tout poil, à enquêter sur de folles impostures (tels ces prétendus carnets d’Adolf Hitler qui tentaient en réalité de dédouaner le Führer du génocide des juifs) mais, plus étonnant encore, à dialoguer avec l’ancien commandant de Treblinka, Franz Stangl, dans Au fond des ténèbres (1975), ou à livrer, dans Albert Speer : son combat avec la vérité (1997), le portrait psychologique et moral du grand architecte nazi devenu ministre de l’armement et de la production de guerre sous le IIIe Reich ?
C’est qu’ayant pu fuir aux États-Unis, Gitta Sereny éprouva elle-même un sentiment de culpabilité. De retour en Europe, elle se consacra à la protection d’enfants égarés, orphelins ou ayant survécu aux camps de concentration. Sa tâche la confronta à une forme très perverse du vaste mensonge national-socialiste, celui des 250 000 « enfants volés ». Originaires pour l’essentiel d’Europe de l’Est, en particulier de Pologne, ils furent enlevés, soumis à toutes sortes d’examens « scientifiques » et, pour ceux tenus pour les plus racialement parfaits, envoyés en Allemagne – les autres finissaient dans l’équivalent d’un camp de concentration pour enfants. (...)
Ayant identifié deux d’entre eux au sein d’une famille de paysans, Gitta Sereny découvrit plus tard le profond traumatisme provoqué chez eux par ce second arrachement. Fallait-il les restituer à leurs parents biologiques (à présent sous le joug soviétique) ou les laisser à leur famille d’accueil (qui avait aimé en eux les représentants d’une « race parfaite ») ? Le mensonge avait été si profond qu’aucune solution « juste » n’était désormais possible.
S’il est un point commun aux enquêtes ou aux portraits de Sereny qui composent Dans l’ombre du Reich, c’est le combat que tous les hommes décrits ont mené avec la vérité. Certains en ayant recours aux coups les plus bas, tel John Demjanjuk. Arrêté par les Allemands, cet Ukrainien avait choisi de servir comme gardien dans des camps d’extermination, puis était parvenu à fuir en Amérique après la guerre. Identifié par des survivants comme ayant sévi sous le surnom d’« Ivan le Terrible » à Treblinka où il avait commis les pires horreurs, Demjanjuk fut jugé en Israël à la fin des années 1980.
Cette affaire judiciaire connut d’incessants rebondissements, mais ce qui captive, c’est l’éthique dont Gitta Sereny fit preuve. Elle prit conscience que, même s’il avait contribué à la mort de milliers de juifs, Demjanjuk n’était vraisemblablement pas « Ivan le Terrible », et orienta ses recherches dans cette nouvelle direction. Face à cet homme dont la vie n’avait été qu’un immense tissu de mensonges éhontés, un seul principe s’imposait à ses yeux : « la justice pour un seul, qui que ce fût » comme « unique moyen d’assurer la justice pour tous ».
Franz Stangl, lui, entendait – ou prétendait – affronter la vérité. Dans les conversations qu’il eut à la fin de sa vie avec Gitta Sereny, mentir ne lui aurait rien apporté ; il avait déjà été condamné et n’attendait plus que la mort. Responsable, en un an, de plus d’un million de morts, il s’efforçait de reconstituer les moments où sa conscience avait basculé.
Cet exercice d’autocritique horrifie toutefois par l’inextricable mélange de rationalisation et de mauvaise foi qui s’en dégage. Continuellement menacé par ses supérieurs, Franz Stangl se décrivit acculé à des actions qui l’épouvantaient, mais affirma que lui-même risquait sa vie ou celle de sa famille. Hans Münch, l’un des rares scientifiques à avoir refusé de sélectionner les prisonniers pour la chambre à gaz, n’avait pourtant encouru aucune sanction… Bien plus, Franz Stangl justifia son extraordinaire capacité d’organisation du camp en limitant sa responsabilité à la seule protection des biens volés aux juifs : le reste (le gazage) était celle de deux Russes placés sous le commandement d’un subalterne… C’est au prix de cette schizophrénie mentale et morale qu’il put déclarer : « Je devais agir de mon mieux. Je suis ainsi fait. »
Le bourreau peut-être le plus effrayant n’est pas l’exécutant : Albert Speer exerçait une véritable séduction sur tous ceux qui le connurent, à commencer par Hitler qui en fit l’un des hommes les plus puissants du régime. Mais la joute verbale qui l’opposa à Gitta Sereny montre que même un ancien nazi ayant sincèrement reconnu sa culpabilité ne pouvait se libérer tout à fait de l’infernal système de déresponsabilisation mis en place sous le IIIe Reich.
Interrogé sur ce qu’il savait des meurtres de masse commis par les Allemands, il eut recours au traditionnel renversement : « Plus on occupait une position élevée, moins on savait », comme si l’euphémisation généralisée qui régnait au sein de l’institution avait suffi à cacher la réalité. C’est au moyen d’un étonnant détour – au lecteur de le découvrir – que Speer finit par reconnaître auprès de Sereny son « acceptation tacite de la persécution et du meurtre de millions de juifs ». Ici, le mot « tacite » ne rend pas seulement compte de la manière dont les nazis avaient ignoré leurs fautes commises sous Hitler, mais également de leur incapacité à en livrer l’aveu à haute voix après la guerre.
L'Obs, 4 février 2016
Les racines du fiel
par Laurent Lemire
En 1967, dans la jeune République fédérale d'Allemagne, un épicier de 52 ans, marié, trois enfants, est jugé. Vingt-quatre ans plus tôt, il a participé à la liquidation d'un ghetto. L'ancien SS est accusé d'avoir capturé en 1943 une soixantaine d'enfants de moins de 10 ans, de "les avoir tués l'un après l'autre en leur assenant des coups de marteau répétés à la tête, après quoi les corps roulaient dans la fosse, sous les yeux de leurs parents, forcés de regarder". À la lecture de l'acte d'accusation, le commerçant répond : "C'était il y a si longtemps..." C'est un des moments forts de la vaste enquête menée par la journaliste et historienne Gitta Sereny, née en 1921, morte en 2012. (...)
Dans l'ombre du Reich est moins un livre d'histoire qu'un livre sur les traces de l'histoire. Avec Gitta Sereny, on entre dans le nazisme par une porte dérobée. Le mal y apparaît moins impressionnant même si l'horreur qu'il dégage est identique. Elle se souvient d'Albert Speer qu'elle a vu pour la première fois au procès de Nuremberg - elle avait 24 ans ! - et qu'elle retrouve des années plus tard chez lui, accaparé par son "Combat avec la vérité" (titre de l'ouvrage qu'elle lui consacre en 1997), dont il n'est pas sorti vainqueur. Elle raconte les procès de John Demjanjuk (...). Elle revient sur la crapuleuse affaire des faux carnets de Hitler. Elle fait parler les enfants du haut responsable nazi Martin Boorman, la secrétaire particulière de Hitler, Traudl Junge, la cinéaste Leni Riefenstahl, Franz Stangl, le commandant de Treblinka, ou Kurt Waldheim, rattrapé par son passé d'officier de la Wehrmacht lors de la présidentielle autrichienne de 1985. Dans ce qui fut son dernier ouvrage, Gitta Sereny est donc revenue sur les racines du fiel qui a dévasté la conscience du Vieux Continent. "Si aujourd'hui l'Allemagne est devenue, non pas le maître, mais le cœur de l'Europe (d'une manière bien différente de tout ce qu'avait pu prévoir Hitler), c'est parce que les Allemands de tous âges continuent, en permanence, de se confronter à cette blessure."
Causeur, février 2016
Le pourquoi d'un monde sans pourquoi
par Paulina Dalmayer
Comment la barbarie nazie a-t-elle pu surgir au cœur de l'Europe civilisée ? Quelles justifications bourreaux et complices se sont-ils trouvées pour y contribuer ? Pour tenter de le comprendre, il faut absolument lire la somme de Gitta Sereny, Dans l'ombre du Reich.
Les Allemands ne naissent pas héros et, à quelques exceptions notables près, ils ne le deviennent pas au cours de leur vie. Telle est une des explications
possibles à la question, aussi élémentaire qu'abyssale, à laquelle revient de manière obsessionnelle Gitta Sereny à chaque page de son volumineux ouvrage, Dans l'ombre du Reich. Comment cela a-t-il pu se produire ? Paru en janvier dernier aux éditions Plein Jour, le livre a pour sous-titre « Enquêtes sur le traumatisme allemand (1938-2001) », en écho à son titre original The German Trauma. Il ne s'agit pas d'un « bouquin » de plus dans le registre de « l'interminable écriture de l'extermination », selon l'expression consacrée d'Alain Finkielkraut. Il s'agit d'une somme dont la finesse de l'analyse psychologique et sociologique équivaut, sinon dépasse, la perspicacité d'Eichmann à Jérusalem. Longtemps le provincialisme français a condamné Gitta Sereny à un quasi-anonymat ou, au mieux, la classait parmi les auteurs réservés à une poignée d'initiés. Le succès récent d'Une si jolie petite fille a changé la donne, en restituant à la biographe et journaliste britannique une notoriété hautement méritée. Issue d'un milieu ultraprivilégié viennois d'avant-guerre, Sereny a, tout au long de sa carrière, habilement utilisé ses origines pour se faire ouvrir des portes fermées à d'autres. Composé d'enquêtes, d'entretiens et de confrontations, le livre de Gitta Sereny donne la parole à certaines personnalités de premier plan du régime hitlérien : la réalisatrice controversée Leni Riefenstahl, un medecin d'Auschwitz, Hans Munch, l'architecte en chef du parti nazi, Albert Speer, le commandant du camp d'extermination de Treblmka, Franz Stangl...
Obtenant d'eux des confidences des plus intimes, l'expression de sentiments refoulés ou même des aveux dans le cas d'Albert Speer, poussé à reconnaître qu'il était au courant du sort des Juifs sous le Troisième Reich, contrairement à ce qu'il avait soutenu pendant son procès à Nuremberg, Sereny n'a jamais caché ses propres convictions. Toute sa vie, elle a été hantée par l'essor, les horreurs et les retombées du nazisme. (...)
Franz Stangl, à qui Sereny a par ailleurs consacré un livre entier, Au fond des ténèbres, a ainsi fait une révélation extrêmement troublante sur la manière dont il trompait sa conscience pour assumer ses responsabilités à la tête de ce qu'il a lui-même décrit comme un « enfer de Dante » : « Le seul moyen que j'avais de survivre consistait à cloisonner mon esprit. » Policier de formation, l'homme qui a « supervisé » la mort de quelque 900 000 personnes appliquait tout naturellement à sa situation personnelle la définition du crime qu'on lui avait enseignée à l'école. Il n'avait pas à se sentir coupable parce qu'un délit punissable devait répondre à quatre critères : il fallait qu'il y ait un sujet, un objet, un acte et une intention. Or Franz Stangl, en bon catholique qu'il était, n'avait jamais eu l'intention de tuer. Sa mission spécifique consistait à ce que les biens de valeur ayant appartenu aux gens envoyés dans les chambres à gaz ne soient pas volés mais parviennent à Berlin. « Rétrospectivement, pensez-vous que cette horreur a revêtu un sens quelconque ? » lui a demandé Sereny lors de leurs entretiens à la prison de Dusseldorf en 1970, où Stangl purgeait une peine de prison à vie. Et ce fut à l'un des pires exécuteurs nazis de donner une réponse affirmative :
« Peut-être les Juifs étaient-ils destinés à subir cette énorme secousse pour pouvoir se réunir, créer un peuple, se forger une identité commune. » Si, par « destinée », Stangl entendait une volonté divine, devrait-on en conclure que selon lui Dieu était présent à Treblinka ? « Oui. Sinon comment cela aurait-il pu arriver ? » Les dessinateurs de Charlie Hebdo trouveraient dans la biographie de Stangl mille preuves de la culpabilité de Dieu, cet « assassin » qui court toujours. Placé au début de son ascension professionnelle à la tête du programme d'euthanasie des handicapés mentaux d'Allemagne et d'Autriche, Stangl a été incapable de faire face à ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait une conversation avec une religieuse et un prêtre, choqués du refus de ladite commission médicale d'accorder une « mort miséricor- dieuse » à un adolescent qui n'était « d'aucune utilité, ni pour lui-même ni pour personne ».
Soumis à des pressions constantes, exposé en tant qu'Autrichien au risque d'être purement et simplement supprimé au cas de désobéissance, Stangl a songé à se suicider, puis à déserter. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Il aurait dû, a-t-on envie de dire. Tant d'Allemands auraient dû choisir héroïquement la mort plutôt que la corruption morale et le crime. Seulement, lire attentivement Sereny permet de saisir que le sens du devoir et la foi en la vertu de la discipline sont plus fortement ancrés dans le tempérament germanique que la propension à la bravoure, surtout quand celle-ci exigerait d'assumer sa part de responsabilité individuelle dans chaque événement collectif. (...)
Ce que l'ouvrage de Gitta Sereny livre à la fois de plus intéressant et de plus difficile à accepter, c'est le point de vue « des coupables » sur l'horreur de l'époque nazie, qu'ils ont rigoureusement contribué à faire perdurer. Sans Albert Speer, la journaliste et nombre d'historiens soutiennent que Hitler aurait perdu la guerre un an plus tôt. Cependant, ce n'est ni le carriérisme ni la fureur meurtrière, mais sa fascination pour l'homme, qui expliquent la fidélité « inconditionnelle » de Speer au Führer. Ce qui en dit long sur « l'importance des émotions humaines dans les événements politiques ». À ce sujet, Sereny évoque ce moment où, adolescente, en route de son pensionnat anglais vers son domicile viennois, elle s'était retrouvée, pour cause de panne de train, parmi le public d'un congrès du parti nazi. L'enthousiasme de tous, les drapeaux, les jeux de lumière ont alors suffi à la subjuguer. De quelle manière cet enchantement juvénile aurait-il évolué sans l'intelligente intervention de son institutrice anglaise, qui l'avait alors incitée à lire Mein Kampf pour comprendre ce à quoi elle avait assisté ? Aujourd'hui, c'est Gitta Sereny qui nous éclaire sur certaines des conditions qui ont permis aux nazis de « tuer la civilisation de l'Europe par les armes d'un des peuples les plus civilisés d'Europe », comme l'a formulé François Furet. Nous sommes tragiquement forcés d'en retenir que dans bien des cas un mouvement d'humeur collectif, une émotion partagée, une exaltation passagère ont joué un rôle plus important que l'adhésion délibérée à une idéologie fanatique.
Le Figaro Histoire, février-mars 2016
Au cœur des ténèbres allemandes
par Jean-Louis Thiériot
Gitta Sereny trace le portrait d'une Allemagne pétrie de paradoxes, entre indépassable sentiment de culpabilité et orgueil insensé de sa réussite.
L'Allemagne ne cesse d'étonner le monde, que ce soit par sa rigueur ou par sa générosité inconsidérée. Tantôt l'Europe s'offusque de l'insensibilité germanique aux souffrances du peuple grec. Angela Merkel porte alors la livrée d'un Bismarck du livre de comptes, insensible aux malheurs de ses débiteurs. Tantôt l'Europe s'effraye des portes de la Republique fédérale ouvertes toutes grandes aux réfugiés syriens ou irakiens, au risque de déstabiliser le continent entier. Notre voisin a incontestablement le visage d'une puissance paradoxale qui sème la perplexité autour d'elle. Ce paradoxe est le fruit indivis de l'histoire du siècle dernier, du IIIe Reich et du « miracle allemand ».
Le dernier livre de Gitta Sereny, Dans l'ombre du Reich, enquêtes sur le traumatisme allemand (1938-2001), permet de démêler l'écheveau contradictoire des sentiments allemands. ll exprime d'abord la richesse d'un monde germanique qui fut longtemps enchanteur. La vie de l'auteur (...) commence comme un conte de fées. Née à Vienne en 1921, de l'union d'un grand bourgeois protestant hongrois avec une jeune femme de la haute société (...), elle incarne à la perfection la richesse culturelle et sociale des élites de la monarchie habsbourgeoise cosmopolite, ouverte, polyglotte, raffinée à l'extrême. Apres le décès de son père, sa mère épousera d'ailleurs le grand économiste libéral Ludwig von Mises, descendant d'une famille juive de Calicie anoblie par François-Joseph, ce qui en dit long sur la tolérance qui régnait alors autour du vieux souverain. En sacrifiant au culte de l'ouverture à l'autre, à tous les autres, l'Allemagne contemporaine rêve inconsciemment de renouer avec ce paradis perdu.
La force de l'ouvrage de Gitta Sereny est de glisser avec talent de la douloureuse nostalgie d'un Stefan Zweig à l'acuité journalistique du Joseph Kessel de L'Heure des châtiments. Car, en regard de cette évocation nostalgique, elle met aussi en scène les crimes allemands et les procès de la dénazification. En commençant par montrer comment l'irruption du national-socialisme a pu avoir d'abord ses séductions poétiques : « Je fus subjuguée par ces cohortes de militants défilant dans une symétrie parfaite, par les nombreux enfants, par les visages joyeux qui m'entouraient et les rythmes, les sons, la solennité des silences, les couleurs des drapeaux, la magie des éclairages. » Plus lucide que d'autres, elle discerne pourtant très vite les racines du mal. Étudiante au cours de théâtre du grand dramaturge Max Remhardt, elle découvre avec horreur qu'il n'est plus permis « d'avoir des amis juifs ». Elle développe alors un vif sentiment antiallemand, toujours assorti d'une certaine tendresse car, ajoute-t-elle, « Brahms aussi était allemand ». Sa vie entière restera dès lors hantée par cette interrogation : comment un peuple de tels génies a-t-il pu enfanter de tels monstres ? Son livre répond à sa façon, par touches impressionnistes, à cette quête lancinante qui est désormais celle de tout un peuple.
Désireuse d'aider les victimes du rouleau compresseur nazi, Citta Sereny s'installe en France en 1940, comme infirmière volontaire. Elle entre aussitôt en résistance, volant des documents diplomatiques cachés dans le château de Villandry ou faisant évader des aviateurs britanniques déguisés en infirmières. Au-delà de la dimension romanesque de ses aventures, son témoignage est éclairant car il révèle l'état d'esprit de l'époque. La solution finale était alors ignorée du plus grand nombre. La tragédie des Juifs n'était qu'une partie de la tragédie du continent et leur extermination programmée totalement inconnue. Ce n'est que plus tard, après la chute, que pourra être mesurée l'ampleur de l'ignominie. Résistante de la première heure, elle écrit :
« Entre mai 1940 et le début d'hiver 1941, nous ne savions rien des déportations des Juifs allemands. (...) Durant cette première période de l'Occupation, Juifs ou non-Juifs, gens de mon âge ou plus âgés, personne n'a jamais évoqué de menaces pesant sur la vie des Juifs, en France ou ailleurs. (...) Nous avons été assez tôt informés de mesures de rétorsion d'ordre économique visant les Juifs, maîs cela, dans notre esprit, n'allait guère plus loin. (...) Le monde ne se rendait pas compte que c'était le début d'un génocide planifié des Juifs d'Europe. Tous ont préféré accepter l'interprétation allemande évoquant des "actes de guerre". »
Le livre entier met ainsi le lecteur d'aujourd'hui en garde contre les reconstructions a posteriori et les anachronismes de la mémoire. Mais en restituant le contexte dans lequel le nazisme a pu recueillir, peu a peu, l'adhésion de l'un des peuples les plus civilisés d'Europe, il permet surtout de comprendre pourquoi l'Allemagne est à ce point aujourd'hui obsédée par le « devoir de transparence ». Il s'agit d'éviter que le mensonge puisse à nouveau rendre l'impensable possible. Le procès de John Demjanjuk, soupçonné d avoir été le boucher de Treblinka, « Ivan le Terrible », qu'il évoque longuement, révèle un autre pan de la culpabilité allemande, celui d'avoir semé un tel chaos dans l'Europe orientale que le continent tout entier est devenu une « Europe barbare ». Le destin de cet hommed d'origine ukrainienne est celui qui soulève le plus d'écho car il évoque un pays dont l'avenir déchire aujourd'hui l'Europe. Né en Ukraine en 1920, victime de la grande famine organisée par Staline, il est fait prisonnier par les Allemands lors de l'invasion de l'URSS. Il rallie alors la division SS Calicie pour combattre le communisme honni. La suite est l'objet des différents procès qui lui ont été intentés. Fut-il l'un des bouchers de Treblinka, coresponsable de la mort de plus de 100 000 Juifs ? Victime d'une homonymie, fut-il un simple combattant, engagé dans la division SS Calicie puis dans la division Vlassov, qui réunissait les Russes ralliés à l'Allemagne comme il le soutiendra après-guerre ? Fut-il un gardien de Sobibor où il aurait été complice du gazage de plus de 27 000 Juifs ? Aujourd'hui, la justice a tranché. Condamné à mort en Israël, en 1988, pour avoir été « Ivan le Terrible », il a été acquitté en 1993 en raison de doutes sérieux sur son identité et sa participation au massacre de Treblinka, avant d'être à nouveau condamné, en Allemagne, en mai 2011, à cinq années de prison pour sa complicité dans la mort de plus de 27 000 Juifs dans le camp d'extermination de Sobibor. Les péripéties personnelles de la vie de ce bourreau sont en elles-mêmes palpitantes. Mais, comme le montre brillamment l'ouvrage, elles le sont surtout en raison des immixtions constantes des intérêts contemporains dans les procès mémoriaux. Lorsque Demjanjuk a commencé à être inquiété à la fin des années 1970, il était citoyen américain, naturalisé pour avoir fui des terres communistes. Son dossier fut dès lors alimenté par le KGB, qui s'évertuait à prouver que les États- Unis accueillaient volontiers des criminels de guerre nazis. Quand les procédures furent engagées, c'est toute la communauté ukrainienne qui se mobilisa pour le défendre. L'enjeu n'était plus l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, mais l'innocence de la communauté ukrainienne et la légitimité de son combat contre le bolchevisme, fût-ce au prix d'une compromission avec le nazisme. (...)
Certains articles, parmi les plus riches de ce maître livre, rapportent des échanges avec de jeunes Allemands sur les procès et « la faute allemande ». Le constat est lourd d'enseignement. Nos voisins sont tenaillés entre leur indépassable sentiment de culpabilité et l'orgueil non dissimulé que suscite chez eux le miracle économique de l'après-guerre. « En incitant une nation vaincue à se percevoir en vainqueur éco- nomique, on a accentué l'État de schizophrénie morale qui couve encore (...). La culpabilité de la nation est devenue le traumatisme de cette nation. (...) Le résultat est qu'il est presque impossible, en Allemagne, de formuler un objectif national clair. » Incapables de définir une ligne de partage équitable entre un remords toujours nécessaire et une identité réduite à la prospérité retrouvée, nos voisins habitent désormais un pays sans âme. (...)
Le Magazine littéraire, février 2016
Le IIIe Reich en tête à tête
par Marc Weitzmann
Publiée en 2002, mais encore inédite en français, une somme sidérante sur les ressorts psychiques des nazis, nourrie par des entretiens avec des dignitaires du Reich, mais aussi avec leurs enfants.
Voici sans doute l'un des livres les plus importants, troublants et dérangeants jamais écrits sur le nazisme. Il s'agit d'un recueil de longs reportages réalisés par la journaliste Gitta Sereny entre l'après-guerre et l'aube de notre siècle, repris et commentés par l'auteur en vue de la présente édition. L'écriture en est précise et simple - un exemple de journalisme littéraire à son meilleur -, les faits rapportés sont le plus souvent sidérants, la profondeur des questions posées est vertigineuse. Le sujet en est l'Allemagne et les Allemands depuis l'accession de Hitler au pouvoir. L'ouvrage se situe donc d'emblée dans le mauvais camp. Gitta Sereny, de nationalité britannique mais née autrichienne, n'en fait d'ailleurs pas mystère. Dès la première page, elle se présente en 1934, à 13 ans, débarquée à Nuremberg par hasard ; le train l'amenant chez sa mère à Vienne depuis l'Angleterre, où elle est en pension, est tombé en panne et elle découvre du même coup, toute heureuse, les célébrations du congrès nazi, celui-là même que la cinéaste Lena Riefenstahl est en train de filmer pour Hitler. « Je fus subjuguée par la vision de ces cohortes de militaires défilant dans une symétrie parfaite, par les nombreux enfants, par les visages joyeux qui m'entouraient. [...] Tour à tour rivée à mon siège ou debout, hurlant de joie avec des milliers d'autres participants, j'étais ravie. » Cet enthousiasme adolescent sera vite contrebalancé par son engagement en France dans la Résistance. Demeure la conscience d'être embarquée, historicisée. « Qui étais-je, qui étions-nous, nous tous, devenus partie prenante d'un conflit qui laisserait son empreinte sur le monde pour le restant du siècle et au-delà ? » C'est le souci constant de cette question, l'engagement moral individuel absolu de son auteur, et les risques qu'elle a pris avec elle-même pour y répondre (...) qui font de Dans l'ombre du Reich un livre d'une exceptionnelle densité. (...)
Dans l'ombre du Reich synthétise le travail de Gitta Sereny sur ce qu'il faut bien appeler l'« héritage » de Hitler, notamment dans ses entretiens avec Franz Stangl, le commandant de Sobibor et de Treblinka, reconnu coupable de la mort de 900000 personnes, à qui elle a consacré un ouvrage entier (Au fond des ténèbres), et dont elle livre ici un portrait saisissant, avec Albert Speer, l'architecte personnel de Hitler, qui dit avoir entretenu avec celui-ci une relation « érotique », avec François Genoud, le banquier suisse exécuteur testamentaire de Goebbels et de Hitler (qu'il avoue avoir « aimé »), qui est devenu par la suite financier des réseaux nazis, du FLN algérien, des mouvements palestiniens, du terroriste Carlos et de l'avocat Jacques Vergès, et qui s'est suicidé en 1996. Elle a rencontré les fabricants des faux carnets de Hitler, dont la publication fit scandale en 1983 : Gerd Heidemann, le journaliste allemand qui, après s'être acheté la carcasse moisie du yacht de Goering, l'avait retapé pour en faire un lieu de week-end d'anciens nazis, Konrad Kujau, un faussaire mythomane, fabricant de fausses toiles de Hitler - les deux furent manipulés, semble-t-il, par un ex-Waffen-SS, que Gitta Sereny nomme X, qui cherchait à gommer l'antisémitisme de Hitler avec ces faux carnets et dont le passe-temps favori aurait été de se déguiser en Peau-Rouge (Karl May, l'auteur du Demier des Mohicans, était l'auteur préféré de Hitler). La journaliste britannique s'est aussi entretenue, dans les années 1990, autour d'un thérapeute israélien, avec les enfants des dignitaires nazis, dont la figure la plus extraordinaire, dans le livre, est Martin Bormann Jr, né en 1930 - fils de Martin Bormann, intime de Hitler -, qui devint prêtre, puis théologien.
L'un des points les plus intéressants du livre est évidemment celui de la culpabilité. Là où les fils et filles, pourtant innocents, ne parviennent pas à s'en libérer - quitte à y attacher leur narcissisme -, les bourreaux, eux, se battent pour la refuser, tout en affirmant vouloir s'expliquer. Il est ainsi remarquable que Franz Stangl soit mort d'un arrêt cardiaque dix-neuf heures après avoir admis, pour la première fois, devant Gitta Sereny, sa responsabilité directe dans les massacres - chose qu'il semble avoir été en mesure de nier même à l'époque. Le récit de sa surprise à la fois horrifiée et excitée en découvrant les chambres à gaz de Sobibor - la hiérarchie nazie ne lui ayant pas expliqué précisément la nature du travail à accomplir - est de ce point de vue un modèle de perversion qui mériterait une analyse à part. Albert Speer, quant à lui, presse la journaliste d'aborder la question du génocide, pour mieux nier qu'il était au courant, avant d'admettre du bout des lèvres, effondré, qu'il savait. François Genoud, pour sa part, parle d'« exagérations ». Et c'est bien là l'un des grands mystères, qu'aucun de ces hommes, qui prétendirent se situer au-delà de la morale, ait été capable de se regarder en face.
Nous sommes là dans un univers hanté, infecté, un monde qui s'est survécu à lui-même, le monde du mal à l'état pur, dont nul ne sort complètement, pas même les fils les plus révoltés. Gitta Sereny fait preuve d'une force extraordinaire pour approcher certains de ces personnages, mais aussi, comme elle le fit face à Mary Bell, admettre ses propres réactions à leur égard sans pour autant rien céder de sa tenue morale (elle reconnaît des relations cordiales avec Albert Speer et parle d'une « amitié » avec François Genoud). Le niveau de détails et d'incarnation auquel elle parvient est aussi stupéfiant que cauchemardesque. Comme avec le film Shoah, mais cette fois dans la sphère des bourreaux, on a la sensation en lisant ce livre d'approcher physiquement ce qu'a dû être la réalité du nazisme. Et, comme dans Shoah, plus on s'approche, plus on sent que c'est vrai, moins on comprend comment cela a pu être. Et comment cela flotte encore autour de nous.
Le Figaro littéraire, 21 janvier 2016
La blessure allemande
par Jacques de Saint Victor
« Toujours vulnérable aux accusations de xénophobie, l'Allemagne a été contrainte par l'histoire à devenir la société la plus ouverte d'Europe. » Écrit à l'aube des années 2000, ce propos résonne bien étrangement aujourd'hui. Son auteur, Gitta Sereny, qui est morte en 2012, fut une grande journaliste cosmopolite, ayant connu dans sa jeunesse l'Allemagne nazie. Elle a commencé sa carrière en interrogeant après 1945 les plus grands criminels de guerre, comme Albert Speer ou Franz Stangl, le commandant de Treblinka, ou des personnalités moins compromises mais tout aussi révélatrices de l'aveuglement allemand, comme Leni Riefenstahl, Kurt Waldheim ou la dernière secrétaire de Hitler.
Elle évoque dans ce livre-témoignage ses rencontres. Mises bout à bout, elles font de cet ouvrage un portrait impressionniste mais très précieux de l'Allemagne nazie et, mieux encore, de l'Allemagne d'après-1945. (...) Un portrait passionnant de ce qui reste, au fond, l'impensé allemand.
(...) (Sereny) redonne vie à des réalités tragiques, comme par exemple ces centaines de milliers d'enfants polonais qui ont été capturés par les nazis parce qu'ils semblaient « racialement valables » (en gros : blonds avec des yeux bleus) et confiés durant la guerre à des familles allemandes en mal de descendance. Ce chapitre est certainement le plus déchirant. (...)
La lecture de Sereny souligne enfin le défi posé à l'Allemagne par l'incorporation de sa partie orientale. La dureté de la double expérience totalitaire (nazie, puis communiste) a rendu ses habitants moins sensibles à la culpabilité face au passé nazi.
Selon Sereny (qui, rappelons-le, écrit ce livre en 2001), une « blessure profonde et durable » pèse toujours sur les Allemands, qui ont cherché à se disculper en jouant d'abord la carte de l'aveuglement et du déni, puis celle du repentir et de la culpabilité.
Depuis 2000, il existerait, selon Sereny, une césure sociale à propos du passé. Les jeunes issus des milieux favorisés restent marqués par l'histoire sombre de leur pays. Mais ceux issus de milieux défavorisés, en particulier ceux de l'ancienne RDA, ont oublié ou négligé cette époque honteuse. La crise du système scolaire allemand paraît ne rien avoir à envier, à ce qu'en dit Sereny, à ce que nous connaissons en France, tout au moins sur ce point de la transmission du passé. Ce qui est particulièrement préoccupant, car l'Allemagne ne peut redevenir la principale nation d'Europe sans admettre sa responsabilité devant l'Histoire. On referme Sereny en craignant le « retour du refoulé ».
L'Express, 13 janvier 2016
Autopsies du nazisme
par Emmanuel Hecht
Les souvenirs réédités de l'ambassadeur André François-Poncet et les enquêtes sur l'Allemagne de la journaliste Gitta Sereny : le llle Reich avant, pendant, après.
(...) Gitta Sereny (1921-2012) est en Allemagne en même temps qu'André François-Poncet. La jeune Viennoise de 13 ans échoue au congrès de Nuremberg après la panne du train qui la ramène de son pensionnat anglais. Elle est « subjuguée par la vision de ces cohortes de militants défilant dans une symétrie parfaite ». Son dernier contact avec le IIIe Reich date de la fin des années 1980 : le premier procès de John Demjanjuk, gardien ukrainien du camp de Sobibor, qu'elle couvre pour un journal américain. Entre-temps, la jeune protestante découvre les ravages de l'antisémitisme à Vienne, l'Occupation à Paris (avant de filer à New York, via l'Espagne), l'aide aux réfugiés et aux enfants enlevés dans l'immédiat après-guerre et, enfin, le journalisme, où elle entre comme d'autres en religion. Monomaniaque, elle se consacre au traumatisme allemand (...). Elle rencontre aussi bien de jeunes Allemands qui se débattent avec la culpabilité de leurs parents que des figures du régime : Albert Speer, architecte en chef du Reich et ministre de l'Armement, Franz Stangl, commandant de Treblinka. Ou la cinéaste Leni Riefenstahl, en veine de confidences sur Hitler : « J'ai eu de la chance de ne pas être son type, il n'aimait que les "petites créatures". Je suppose que s'il avait voulu je serais devenue sa maîtresse. »