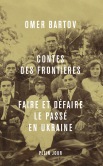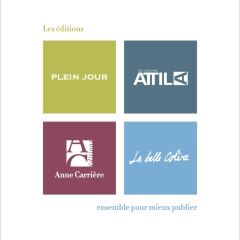En attendant Nadeau, 19 juillet 2024
Passé de l'Ukraine, présent d'Israël
Par Yaël Pachet
Les positions critiques au sujet d’Israël d’Omer Bartov et Saul Friedländer, deux historiens juifs attentifs aux tragédies contemporaines, sont bien connues (en particulier celles d’Omer Bartov, qui intervient régulièrement dans la presse américaine). Tous deux proposent deux livres, l’un consacré au passé de l’Ukraine, l’autre à l’actualité d’Israël. Deux façons de traverser un champ contemporain saturé par un usage de l’histoire hautement politisé.
Omer Bartov, connu en France pour son excellent ouvrage Anatomie d’un génocide (traduit par Marc-Olivier Bherer, éditions Plein Jour, 2021), aura fait de la ville natale de sa mère, Buczacz, petite bourgade d’une région qu’on appelle la Galicie orientale et qui est aujourd’hui en Ukraine (alors que la Galicie occidentale est en Pologne), un point d’ancrage indispensable pour approcher ce qu’on appelle aujourd’hui la Shoah par balles. On pourrait presque se réclamer soi-même de ce lieu, par une sorte de phénomène d’extension des origines, ou de fiction familiale freudienne, ou encore de ce que Marc Bloch appelait la hantise des origines : la propension à extraire du passé des explications causales, à le mettre en cause au sens propre. Pour les lecteurs qui ont des origines juives liées à ces territoires et qui ont du mal à fixer sur les cartes et dans leur esprit des lieux d’origine tour à tour polonais, turcs, ukrainiens, roumains, un point de fixation assumé avec autant de constance par un historien est une aubaine.
En réalité, pour beaucoup de Juifs dont les origines familiales sont désignées par Juifs de Bessarabie, de Podolie, de Volhynie, de Podlachie, de Galicie, c’est-à-dire par des noms qui désignent des régions qui ne correspondent pas au découpage des nations (indépendamment de la question des bouleversements que ces frontières ont subis), un désarroi identitaire sera inévitable, à moins qu’un témoignage ne vienne lui donner une tonalité particulière. Et d’ailleurs, même si le bouquet de souvenirs et de sensations qui leur aura été transmis révèle un paysage, ou les traits d’une ville, il leur restera encore à accomplir l’effort presque surhumain de faire correspondre les indications transmises à des réalités géographiques, politiques et historiques.
[...]
Ce que révèle le livre d’Omer Bartov, c’est que l’histoire n’est pas palpable en dehors du champ littéraire. Les Ruthènes, futurs Ukrainiens, apprennent en même temps à lire, à écrire, et à devenir des individus conscients de leurs nationalités. Le phénomène de la naissance d’un nationalisme est impossible à comprendre si on ne tient pas compte de son aspect proprement littéraire. Omer Bartov nous parle des écrivains ukrainiens qui ont jalonné le développement de la conscience nationale, comme Taras Chevtchenko, né en 1814 dans une famille de serfs et qui peut être considéré « comme l’un des prophètes de la nation ukrainienne moderne ». Il nous parle de Gogol qui écrivit Tarass Boulba en 1842 et dont le personnage-clé est directement inspiré de Bogdan Khmelnitski. Ce Cosaque zaporogue entraîna ses hommes dans une révolte contre les Polonais qui avaient colonisé les territoires des confins (confins pour les Polonais, c’est-à-dire des territoires éloignés vers le sud-est, que les Polonais ont cultivés, découpant ces terres nomades en grandes latifundas, territoires protégés par des mercenaires cosaques). Tout en se révoltant contre les Polonais, il entraîna les Ukrainiens à s’attaquer aux Juifs dans les pogromes. Dans la fiction littéraire, il y a une sorte de transparence idéologique, aisément repérable et infiniment précieuse pour comprendre que l’Histoire moderne est dans les mains de l’idéologie nationaliste. Cette expérience de Buczacz nous emmène aussi bien vers le passé que vers l’avenir et les temps présents : la situation en Ukraine, la situation en Pologne, la situation en Israël.
[...]
L'Ours, mars 2024
Faire et défaire le passé en UkraineRelier des imaginaires contradictoires
Par Jean-Louis Panné
C'est à un long voyage à travers le temps et l'espace auquel nous convie Omer Bartov. Ce voyage dans des temps révolus nous entraîne dans les régions méconnues et mystérieuses pour un Occidental de l'extrême ouest, vers les « confins», vers une Galicie dont l'histoire est partagée par les Polonais, les Ukrainiens ou Ruthènes, les Russes et les Juifs, aux imaginaires contradictoires.
L'histoire qu'il nous conte a un épicentre : la ville de Buczacz dont est native sa mère. Omer Bartov construit son récit pour donner à comprendre cette Galicie traversée de bouleversements dus à la modernité. Il s'appuie sur les romans, les témoignages et les archives d'originaires de Buczacz, cette ville tour à tour prospère ou déclinante.
D'où viennent l'antisémitisme et les pogroms ?
Les romans se réfèrent à une histoire ancienne qui remonte au XVIIe siècle, aux grandes révoltes paysannes. Déjà naît l'interrogation sur l'avenir des communautés juives soumises, au XIXe siècle, aux
discriminatoires lois tsaristes. D'où viennent l'antisémitisme et les pogroms ? Cette question est comme l'une des constantes de la recherche d'Omer Bartov. Il aboutit à un constat : « ... chaque
groupe vivant dans les confins voyait cet avenir de manière différente, et chacun avançait de son côté, sans se soucier de leurs voisins [Polonais, Juifs, Ruthènes]. Et, avec le temps, leurs chemins
divergèrent de plus en plus, jusqu'à ce que l'avenir radieux d'un groupe devienne un abime de désespoir pour un autre. » Avec la naissance des nationalismes qui gagnent l'Europe entière, la position,
le statut des Juifs s'en trouvent modifiés, d'autant que leur émancipation bouleverse un équilibre précaire. Apparaît alors «une nouvelle idéologie antisémite, qui faisait des Juifs le principal
obstacle à la formation d'un État-nation ethniquement homogène», écrit Omer Bartov. Par là s'annonce le tragique XXe siècle.
Si la mémoire de la vie à Buczacz s'est conservée, c'est grâce à ceux de ses enfants qui l'ont quittée avant 1914 ou avant 1939. Et l'on découvre des noms connus (pour d'autres raisons) comme celui
de Max Nomad ou bien celui du docteur Kanfer dont la fille Irène s'occupait encore dans les années 1980 à Paris du journal en yiddish Unzer Wort, si je me souviens bien - ce qui produit un sentiment
d'étrange proximité avec cette lointaine contrée d'Europe. [...]
Vaincre l'oubli
La dernière partie de son livre est consacrée à son dialogue avec sa mère, née en 1924, qui avait quitté Buczacz en 1935 pour aller s'établir en Palestine. Il rêvait de faire un voyage de « retour »
en sa compagnie, ce qui n'eut pas lieu. D'où ces pages particulièrement émouvantes par leur universalité parce qu'elle adresse une leçon à chacun d'entre nous : n'attendez pas pour interroger vos
proches sur leur vie et les épreuves traversées avant leur disparition, et que l'oubli n'efface tout... « J'ai pris conscience [...] à quel point je me suis lancé tardivement dans la recherche du
destin de ma famille », se reproche Omer Bartov. De cette conscience est né ce livre passionnant dont la trame est tissée de multiples éléments recueillis (littérature, cinéma, etc.), jusqu'à nous
apprendre que Freud a de lointains ancêtres à Buczacz !
Revue Chroniques noir et rouge, mars 2024
Faire et défaire le passé en Ukraine
Par Sylvain Boulouque
Omer Bartov prolonge son étude fouillée Anatomie d'un génocide, vie et mort dans une ville nommée Buczacz (Plein jour éditions, 2021, 444 pages, 24 euros) consacrée à la ville de Buczacz,
dans laquelle il décrivait les mécanismes mis en place par les nazis pour exterminer la communauté juive de la ville, avec la complicité d'une partie des communautés polonaise et ukrainienne locales.
Buczacz est située aux confins de l'ancienne Russie dans la province de la Galicie, avant-hier dans l'Empire austro-hongrois, hier en Pologne, aujourd'hui en Ukraine. Elle a été un centre important
de la vie culturelle. Plusieurs auteurs comme Samuel Agnon ou Stanislaw Kowalski y sont nés ou y ont vécu et les ouvrages sur la ville sont nombreux. Ils permettent à Omer Bartov de restituer la
complexité de la région.
Il y montre l'importance et la complexité du yiddishland révolutionnaire. Ce dernier a fourni des figures aujourd'hui oubliées comme les frères Natch et Mikhaïl Lozynski, militants libertaires ayant
immigré à Londres puis à New York, animateurs d'innombrables revues et journaux libertaires. C'est aussi de là que plusieurs cadres staliniens sont originaires. Il donne par exemple à lire le récit
de la vie d'Adlof Langer, devenu Ostap Dulski, qui après
avoir animé le soviet local, travaille pour l'appareil du Komintern en Pologne puis en France. Entré dans la Résistance en France, il rejoint la Pologne communiste où il intègre le Comité central du
Parti, multipliant les hommages à Staline, sans s'interroger une seconde sur les campagnes antisémites qui
existent en URSS et en Europe de l'Est. Devenu écrivain il reçoit le prix Lénine. Bartov analyse aussi les communautés ukrainienne et polonaise, il y analyse le poids de l'antisémitisme local, qui
sans être majoritaire tient une place importante. Les nationalistes ukrainiens de Petlioura à Bandera y ont commis des exactions, comme les nationalistes polonais. En dépit de cela, la ville de
Buczacz est restée un des symboles d'un monde disparu : le yiddishland.
Le Point, 23 février 2024
Omer Bartov : « L’ombre de l’Ukraine pèse sur Israël »
Par Baudouin Eschapasse
INTERVIEW. Historien spécialiste de l’Europe centrale, Omer Bartov établit dans son dernier livre des parallèles troublants entre l’Ukraine et Israël.
Après avoir exploré l'histoire de la ville de Buczacz dans Anatomie d'un génocide (Plein Jour, 2021), Omer Bartov continue de sonder le passé de l'Ukraine et singulièrement celui de la
Galicie, dont sont originaires nombre de Juifs ashkénazes aujourd'hui dispersés à travers le monde.
Dans son dernier livre Contes des frontières. Faire et défaire le passé en Ukraine, l'universitaire américano-israélien, professeur à l'université Brown, aux États-Unis, s'interroge sur
les modèles culturels et politiques qui ont émergé dans cette région qui s'étendait, avant-guerre, aux confins de la Pologne et de la Russie : « modèles » que les communautés
juives de ce territoire ont importés en Israël.
À l'heure où la guerre contre le Hamas se prolonge à Gaza, et au moment où le gouvernement de Benyamin Netanyahou est à nouveau contesté par une frange importante de l'opinion israélienne, cet ouvrage aborde indirectement une question sensible : le sionisme. Pour Omer Bartov, il ne fait aucun doute que le terreau dans lequel il a vu le jour a laissé des traces sur ce mouvement qui a donné naissance à l'État hébreu. Il s'en explique au Point.
Le Point : Votre dernier livre, qui mêle histoire et anthropologie, sonde la spécificité de la Galicie. Pourquoi y être revenu dans un nouvel ouvrage ?
Omer Bartov : Parce que la Galicie est un creuset particulièrement intéressant. L'histoire de cette région de l'Ukraine occidentale est singulière. Ce territoire a appartenu à de très nombreux pays avant que l'Ukraine n'accède réellement à l'indépendance. Il était rattaché à la Pologne dans l'entre-deux-guerres, après avoir été intégré, pendant de longues années, à l'empire austro-hongrois jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était auparavant le cœur battant de la « République des Deux Nations » : cette confédération née de l'alliance polono-lituanienne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. L'histoire du reste de l'Ukraine est assez différente…
En quoi cette histoire spécifique de la Galicie résonne-t-elle aujourd'hui avec notre époque ?
La Galicie est, en raison de l'histoire que je viens de brosser à grands traits, un mélange de nationalités et d'ethnies vraiment particulier. Y coexistent des communautés religieuses diverses depuis plusieurs siècles. Il y avait là des musulmans de longue date. Mais aussi, évidemment, des chrétiens… à la fois des Grecs orthodoxes, des orthodoxes [dépendants du patriarcat de Moscou, NDLR] et des catholiques romains. Ainsi que de nombreux Juifs. La Galicie a aussi été le berceau du nationalisme ukrainien, du nationalisme polonais et, dans une certaine mesure, du sionisme.
[...]
Pourquoi était-il important pour vous de revenir sur ce qui fonde l'ADN des trois nationalismes polonais, ukrainien et juif ?
Parce que nous ne pouvons envisager le sujet que globalement. Les Ukrainiens, les Polonais et les Juifs se sont dotés d'une « conscience nationale » dans cette zone au même moment et selon des modalités qui méritent qu'on s'y attarde. Le sujet reste éminemment sensible. J'en veux pour preuve les échanges que j'ai eus avec mon traducteur polonais qui marche sur des œufs quand il recourt à certains termes qui ont pris une connotation idéologique dans le discours politique contemporain : certains partis surfent sur une forme de « nostalgie » impériale.
En quoi l'histoire de la Galicie a-t-elle influencé le projet sioniste ?
La transition qu'a constituée le passage d'un monde multiethnique, dans lequel les gens vivaient côte à côte, à un univers composé de nations plus homogènes a laissé des traces.
La cohabitation des communautés dans ce territoire n'était pas toujours harmonieuse…
Certes, les minorités étaient souvent prises pour cibles. Les Juifs ont souffert de pogroms terribles. Mais c'était, si j'ose dire… la vie. C'est comme ça que vivaient les gens. Il y avait toutes sortes de frictions. Il y avait de la jalousie, du ressentiment, mais aussi, il faut le souligner, de la coopération. Il y avait des chevauchements linguistiques extraordinaires et il y avait de la créativité.
Qu'est-ce qui distingue le sionisme des nationalismes ukrainien et polonais à l'origine ?
Peu de choses en réalité. Le sionisme est un courant nationaliste libéral qui n'a rien à voir avec la religion. Il est l'expression d'un groupe ethnique qui aspire à vivre de manière autonome. Il affirme tout à la fois une spécificité culturelle et la volonté de pouvoir affirmer cette identité dans un espace où l'on peut vivre en sécurité. En ce sens, ce rêve d'indépendance formulé par les Juifs n'a rien de fondamentalement différent avec ce à quoi ont pu aspirer, à l'époque, les Ukrainiens ou les Polonais de Galicie.
Il y a néanmoins des nuances politiques. Le mouvement sioniste est loin d'être monolithique. Peut-on distinguer des courants en son sein ?
Évidemment, rien n'est simple dans un mouvement juif. Si l'on tient compte des sensibilités différentes, on peut envisager trois courants sionistes. Le premier serait celui auquel vous avez fait référence, celui d'Herzl. C'est un sionisme, au départ, strictement laïc et libéral. Mais auquel adhèrent rapidement les adeptes du judaïsme réformé : celui qui envisage la religion comme une affaire privée, qui ne s'exprime que dans l'enceinte des synagogues. Mais coexiste un autre sionisme, qui fait la place à une sorte d'identité ethno-religieuse. Il est porté par ceux qui ne veulent pas gommer les spécificités juives, ceux qui luttent contre ce qu'ils considèrent comme un danger : l'assimilation.
Existe aussi un troisième courant : le sionisme socialiste…
Oui. David Ben Gourion en est la figure la plus célèbre. Ce sionisme, comme celui d'Herzl, porte l'aspiration à un État « ouvert » qui n'a, je le répète, aucune connotation religieuse. Ce qui explique que certains courants juifs orthodoxes soient opposés à ce projet et se revendiquent antisionistes. Le courant sioniste socialiste doit cependant faire face à une autre forme de sionisme, incarné par « le parti révisionniste » dirigé par Vladimir Jabotinsky, qui va progressivement agréger les sionistes religieux.
[...]
Le Monde, 13 janvier 2024
« Contes des frontières » : dans la chair du Vieux Continent
Par Marc Semo
Dans ces terres des confins orientaux de l’Europe, sans cesse disputées durant des siècles entre la Russie, l’Empire ottoman et l’Autriche-Hongrie, on pouvait changer quatre ou cinq fois de pays dans
sa vie sans jamais avoir même quitté son village. C’étaient les frontières qui bougeaient dans cet immense espace qui s’étirait de la Baltique aux Balkans, « là où les grands empires de
la période moderne s’étendirent, se chevauchèrent, s’affrontèrent puis s’écroulèrent », rappelle l’historien Omer Bartov dans Contes des frontières. Il a voulu faire ressurgir un
monde disparu qui était un mélange de cultures, de langues, de peuples, de religions et, pour finir, de nations qui, à leur tour, se sont combattues jusqu’à devenir peu ou prou ethniquement homogènes
sous l’effet des tueries et des exodes.
« J’avais été frappé par l’amnésie collective que j’y rencontrais », écrit l’historien américain, professeur à l’université Brown (Rhode Island). Ce monde, dont la Galicie, le limes oriental de l’Autriche-Hongrie, était l’un des cœurs battants, a été presque totalement effacé. Nul aujourd’hui ne se souvient vraiment de ce que fut ce foisonnant mélange. Nul aujourd’hui ne se souvient de la brutalité avec laquelle cette « simplification » démographique fut mise en œuvre, notamment pendant la seconde guerre mondiale et après, avec l’extermination des juifs, les massacres entre nationalistes ukrainiens et polonais, puis l’expulsion, après la guerre, des Allemands de souche.
Héros et Salauds
[...]
Le déclic fut une conversation avec sa mère, en Israël, en 1995, pendant laquelle il comprit que l’univers de ses origines lui était totalement inconnu. « L’histoire de ma mère conduit
à ce livre », explique Omer Bartov dans le chapitre final, qui aurait pu – dû ? – être celui de son commencement.
L’histoire de sa famille, avec un grand-père sioniste et un autre, communiste, se confond avec celle de la ville d’origine, qui eut un bref moment de gloire internationale quand y fut signé, en 1672, un éphémère traité de paix entre le roi de Pologne et le sultan ottoman. Avec force détails, citations et références historiques et littéraires, il raconte, en mêlant les époques, la terre galicienne, ses moments de splendeur et ses innombrables drames, avec ses héros et ses salauds, nobles polonais, cosaques ukrainiens massacreurs, prêtres exaltés et rabbin faiseurs de miracles. Le tilleul pluricentenaire, en partie détruit par la foudre à la fin du XIXe siècle, qui se dresse toujours sur une place de la ville, résiste comme un ultime vestige de ce monde englouti.
Philosophie Magazine, 12 janvier 2024
“Contes des Frontières” : quand Omer Bartov convoque les mémoires de l’Ukraine
Par Philippe Garnier
Poursuivant son exploration d’une petite ville de l’Ukraine occidentale avec son nouveau livre Contes des frontières. Faire er défaire le passé en Ukraine, l’historien Omer Bartov lève le voile sur le passé multi-ethnique souvent douloureux du pays.
Jusqu’où va l’épaisseur d’une frontière ? Est-ce une simple ligne ou un ensemble de régions, voire de pays voisins ? Ces questions peuvent paraître spécieuses, et pourtant il existe bel et bien des pays-frontières, eux-mêmes composés d’une constellation de carrefours d’influences où langues, religions et cultures coexistent. D’une certaine façon, ils ont valeur de paradigme : ils montrent à quel point l’idée d’un « pays profond » peuplé d’autochtones est un leurre. Tout territoire est plus ou moins exposé aux autres, traversé par leur influence. Tout peuple est plus ou moins une mosaïque. L’Ukraine est l’une de ces vastes zones-frontières disputées au fil des siècles par les pouvoirs allemand, russe, austro-hongrois et ottomans.
Dans Anatomie d’un génocide, publié en 2021, Omer Bartov, professeur à l’université Brown, aux États-Unis, et historien de la Wehrmacht, explorait l’histoire multiculturelle de la ville de Buczacz (Boutchatch selon l’orthographe ukrainienne), dans la province aujourd’hui ukrainienne de Galicie. Cette passionnante enquête pouvait paraître exhaustive. Or Contes de frontières revient sur le même théâtre, dans la même ville. En historien obstiné, Bartov parvient à rendre inépuisable l’objet de ses recherches. À sa façon, sa démarche à la fois scientifique et narrative évoque celle, littéraire, de Georges Perec dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1982). À condition de poser d’autres questions, de changer d’angle, de régler autrement la focale, la petite ville de Buczacz devient un espace-temps infini.
Dans la méthode Bartov, la micro-histoire et la macro-histoire ne cessent de s’imbriquer. C’est en scrutant la vie des habitants ordinaires que l’on fait remonter l’une des plus contemporaines des questions politiques : celle de la coexistence des communautés: comment Juifs, Polonais et Ukrainiens qui partagent le même espace se perçoivent-ils ? Qu’est-ce qui, dans les variations de l’image de l’autre, rend possible ou non la coexistence ? Depuis sa fondation, la ville de Buczacz brasse les cultures, les confessions religieuses et les idéaux d’émancipation. Paradoxalement, cet espace ouvert devient au fil du temps un laboratoire de la clôture communautaire et du ghetto. Tout interagit comme dans une caisse de résonance où les pogroms puis la Shoah reviennent en un bruit de fond obsédant. Mêlant l’histoire de membres de sa propre famille – son grand-père et sa mère émigrant en Israël – à des personnages locaux plus ou moins illustres, parfois à des personnages de fiction puisés dans des œuvres littéraires, il parvient à exhumer ce qui reste le plus souvent inaccessible à l’historien : la sensibilité individuelle, le tissu complexe des représentations et enfin l’enchaînement des frustrations et des malentendus qui mène au meurtre de masse.
De quoi le passé sera-t-il fait ? demandait un humoriste soviétique habitué aux réécritures épisodiques de l’histoire de son pays. C’est en élaborant des récits fondateurs souvent tardifs que les communautés de Buczacz ont fini par s’inventer des mémoires antangonistes.
L'Obs, 11 janvier 2024
Aux origines d'un génocide
Par Julie Clarini
Historien israélien, professeur aux Etats-Unis, Omer Bartov a signé son maître ouvrage, Anatomie d’un génocide, en 2018. Consacré aux massacres commis pendant l’occupation allemande dans la ville de Buczacz, terre d’origine de ses grands-parents, ce livre, centré sur les meurtres entre voisins, révélait à quel point les interactions entre les communautés – juifs, Polonais, Ukrainiens – avaient été décisives dans le processus de l’extermination. Cette fois, Bartov nous propose ce qu’on appellerait à Hollywood le préquel. Contes des frontières raconte quatre siècles de coexistence sur cette terre des confins qu’est la Galicie (ukrainienne depuis 1939). Pour comprendre les grands pogroms du XVIIe siècle puis la Shoah, il s’intéresse aux représentations que chacun s’est faites, au cours de ces longs siècles, de soi-même et des autres. Légendes, contes, romans, personnages historiques, aident en buissonnant à reconstituer l’univers mental de ces communautés. Cet essai ample et foisonnant, qui fait de nous les témoins d’un monde riche et aboli, est traversé d’une interrogation douloureuse : comment se fait-il que la modernité et sa promesse d’émancipation, aux- quelles les juifs sont si nombreux à avoir cru, se soient retournées contre eux, attisant les passions identitaires à la source de leur extermination ?
Fnrace Culture, 14 décembre 2023
Par Guillaume Erner
Ukraine, Israël, quand les histoires se rencontrent
Dans son dernier livre, l'historien Omer Bartov revient sur l'histoire de sa famille et de son voyage de la Galicie ukraino-polonaire à Israël, à travers les soubresauts de l'histoire de la première partie du 20e siécle.
Alors que les atrocités du conflit israélo-palestinien continuent de diviser les étudiants de prestigieux campus américains, l'universitaire Omer Bartov se propose d'analyser la résurgence de l'antisémitisme dans le monde à la lumière de sa propre histoire familiale.
Un antisémitisme endémique dans les campus américains ?
L’historien Omer Bartov réagit d’abord aux polémiques qui ont lieu au sujet des universités américaines et de leur traitement du conflit israélo-palestinien : “il y a clairement une montée de l’antisémitisme aux États-Unis, comme dans d’autres parties du monde. Néanmoins, il y a aussi une tentative de faire taire toute critique de la politique israélienne. Cette tentative d’associer cette critique à de l’antisémitisme est également problématique. C’est un bannissement des discussions. Les étudiants, qui sont plus politisés que par le passé, prennent part à cette histoire”. Récemment, la directrice de l’Université de Pennsylvanie Elizabeth Magill avait proposé sa démission à la suite d’une audition controversée au Congrès américain, lors de laquelle elle n’aurait pas condamné les actions de certains de ses étudiants à l’encontre d’Israël.
De Buczacz à la Palestine, une histoire familiale
Dans son dernier livre Contes des frontières, faire et défaire le passé en Ukraine, qui paraîtra aux éditions Plein Jour en janvier 2024, Omer Bartov enquête sur sa propre histoire, celle de sa famille et de son voyage de la Galicie à la Palestine : “en 1935, ma mère avait onze ans et a quitté Buczacz pour la Palestine. Le reste de la famille est restée sur place et quelques années plus tard, ils ont été assassinés par les Allemands et des collaborateurs locaux. En 1995, j’ai parlé avec ma mère de son enfance en Galicie pour la première fois, des grands écrivains locaux comme Yosef Agnon. Je voulais comprendre les liens entre Israël et ce monde juif qui avait disparu à Buczacz au cours de la Seconde Guerre mondiale”.
À la recherche d'un monde perdu
Cette conversation a mené l’historien à consacrer une véritable étude historique à ce lieu et plus généralement à cette région, la Galicie : “ce monde avait selon moi besoin d’être reconstruit. Ce qui le singularisait, c’était la diversité qu’il accueillait. Différentes communautés nationales, ethniques et religieuses avaient coexisté pendant des siècles et je voulais comprendre comment il s’était désintégré”, explique-t-il. Le prochain livre qu’il souhaite écrire en serait alors la suite : “je veux comprendre comment ma génération a commencé à repenser le monde dans lequel nous avons grandi après la destruction de la civilisation précédente”, ajoute-t-il.
Pour réécouter l'émission, c'est par ici.
LH Le Mag, décembre 2023
Une Atlantide yiddish
Par Laurent Lemire
Dans ces Contes des frontières, l'historien israélo-américain Omer Bartov explore la Galicie multiethnique d'avant la Shoah.
Certains lieux sont à la fois dépositaires de la douceur et de la douleur de vivre. La Galicie en est un. Omer Bartov avait déjà documenté la tragédie d’une petite ville paisible devenue un enfer pour les Juifs avant et pendant la Shoah (Anatomie d’un génocide, vie et mort dans une ville nommée Buczacz, Plein Jour, 2021). Il revient ici en Galicie, sur cette « terre de sang » pour reprendre l’expression de l’historien américain Timothy Snyder, mais sur la longue durée, toujours avec cette méthode éprouvée, celle des archives et des témoignages − quand ily en a, pour la période la plus récente. « Ce livre raconte une histoire oubliée. Elle concerne un lieu et une civilisation emportés par la Seconde Guerre mondiale. »
Des révolutions du Printemps des peuples de 1848 au déclenchement de la guerre en 1939 en passant par le traumatisme de la Grande Guerre, ce professeur d’histoire européenne à Brown University (Rhode Island, États-Unis) montre la poussée nationaliste dans cette Europe orientale déchirée par les empires, entre Cosaques et Ottomans. La forte population juive ne résiste pas non plus aux coups de boutoirs idéologiques dans cette région qui s’affirmecomme le berceau des patriotismes ukrainien et polonais au XIXe siècle. Ce sont donc ces trois communautés, juive, polonaise et ukrainienne que l’historien israélo-américain étudie à travers le réel mais aussi l’imaginaire, examinant des récits et des romans, dont ceux de l’écrivain Samuel Agnon, Prix Nobel de littérature 1966, originaire de Buczacz. [...] La mère d’Omer Bartov part pour la Palestine avant la guerre, avant la Shoah, avant la création de l’État d’Israël. « Nous ne reverrons jamais le monde d’où nous venons, pense-t-elle. » C’est pour elle, pour lui, et pour tous les autres, qu’il a entrepris ce livre. Pour montrer, à hau- teur d’homme, ce que fut la vie de cette Atlantide yiddish à jamais engloutie.