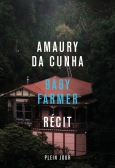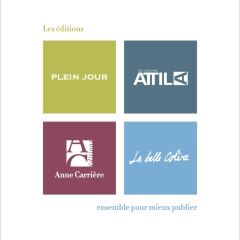Sept.info, hiver 2021/2022
Coupable ou non coupable ?
par Magali Bossi
1895, Nouvelle-Zélande. Minnie Dean est jugée et pendue à Invercargill. Son crime? L’infanticide. Originaire d’Ecosse, Minnie est une baby farmer
‒ une nourrice prête à adopter des enfants illégitimes contre de l’argent. De quoi racheter les péchés que la respectable société victorienne souhaite dissimuler. Malheureusement, le destin
rattrape Minnie lorsque deux bébés dont elle avait la charge meurent. Accidents ? Meurtres ? La police mène l’enquête... Dans Baby Farmer, c’est ce fait divers glauque, qui hante encore
les mémoires néo-zélandaises, qu’Amaury Da Cunha entend exhumer. Ecrivain, journaliste et photographe, il ne s’intéresse pas à Minnie par hasard : en 2020, il séjourne cinq mois à Randell
Cottage, une résidence d’écriture
à Wellington. Là, il plonge dans la vie de la baby farmer, entre réalité historique, misère sociale et folklore local. Dès lors, Baby Farmer propose bien plus que la peinture d’un fait divers ;
c’est le récit exploratoire d’un auteur en quête de vérité, qui procède à la manière d’un enquêteur. De rencontres en hasards, d’explications en rebondissements, Da Cunha tente de cerner son
objet, mais aussi sa propre motivation. Avec Baby Farmer, il nous envoûte.
L'Obs, 13 mai 2021
Baby Farmer
par Claire Julliard
Qui était vraiment Minnie Dean ? Une tueuse de sang-froid ? Une victime ? En Nouvelle-Zélande, cette nourrice infanticide est devenue un mythe gravé dans le folklore, une figure maléfique qui effraie encore les petits. Fasciné par ce personnage victorien, Amaury da Cunha est parti sur les traces d'une femme condamnée à mort et pendue en 1895. Son livre est l'histoire d'une obssession nationale qui fait écho à la mémoire de l'auteur. À partir de divers documents dont la confession de Minnie écrite au bord de l'abîme, c'est le portrait en creux d'une déroutante héroïne. À lire comme un roman.
Sud Ouest, 25 avril 2021
« Baby Farmer » d’Amaury da Cunha, chronique de la nourrice criminelle
par Erwan Desplanques
L’écrivain-photographe part sur les traces de l’unique femme condamnée à mort en Nouvelle-Zélande
Amaury da Cunha aime les histoires souterraines, enfouies dans les strates de la mémoire. Non content d’être l’un des photographes français les plus inspirés du moment, il traque par la littérature d’autres fantômes, absents proches — son frère, disparu en 2009 — ou lointains, comme cette "Minnie Dean", "première et seule femme condamnée à mort en Nouvelle-Zélande", en août 1895.
Elle était ce qu'on appelle une "baby farmer", nourrice de bâtards ou d'enfants abandonnés. Accusée d'avoir tué deux nourrissons, elle a fini pendue, devenant aussitôt él'équivalent du "croquemitaine" dans l'imaginaire néo-zélandais.
Ce que les images taisent
L'auteur ne cherche surtout pas à fictionner son destin mais à exhumer toutesl es traces en enquêtant sur place, au gré d'une résidence d'écriture à Willington. Il correspondand avec Jane Campion, visite la maison natale de Katherine Mansfield, tient son journal de bord, interroge des spécialistes, compulse le compte-rendu d'audience ou les rapport d'autopsie... Et cherche à lire ce que les images taisent, en travaillant le contraste et la note juste, jusqu'à percer le "coeur caché" de cette "fable noire".
France Inter, 6 mars 2021
par Emmanuel Khérad
"Un livre génial." Coup de coeur de Matthieu de la Librairie Goulard à Aix-en-Provence, à écouter ici à partir de 23'40''.
L'Humanité, 4 mars 2021
Les cartons à chapeaux de Minnie Dean![]()
par Alain Nicolas
Une "baby Farmer", en Nouvelle-Zélande, c'est ce que nou appelons une nourrice, comme elles qui accueillaient dans le Morvan les enfants de Paris. Minnie Dean était l'une d'elles. Nombre d'enfants naissent hors mariage, à la fin du XIXe siècle, malgré les rigoureux interdits de la morale protestante. Les petits bâtards atterrissent chez des femmes comme Minnie Dean, qu'on regarde d'un sale oeil. La mortalité des nourrissons, guère pire que la moyenne, est imputée au manque d'instinct maternel des baby farmers qui agissent par intérêt. Mais, avec Minnie Dean, c'est autre chose. Elles utilise le laudanum pour calmer les "pleurnicheuses", et la voilà avec deux enfants morts coup sur coup, qu'elle enterre dans des cartons à chapeaux. Elle aura le triste privilège d'être la seule femme exécutée en Nouvelle-Zélande. Son nom sera synonyme de de croquemitaine, utilisé pour faire tenir tranquilles les enfants turbulents. C'est sur les traces de ce personnage qu'Amaury da Cunha nous emmène dans cet ouvrage qui restitue l'esprit d'un pays et d'une époque, plus complexes qu'il n'y paraît.
Le Point.fr, 27 février 2021
Nouvelle-Zélande : la légende noire de Minnie Dean, tueuse d'enfants![]()
par Sophie Pujas
Était-elle coupable ? Elle fut la seule femme condamnée à mort en Nouvelle-Zélande, en 1895. L’écrivain Amaury da Cunha est parti sur ses traces.
C'est sur les traces de cette femme honnie, immigrée venue d'Écosse, sans doute dans l'espoir de se réinventer aux antipodes, qu'est parti Amaury da Cuhna. Il rejoint la Nouvelle-Zélande le temps d'une résidence d'écriture, et questionne tous ceux qui auraient pu s'intéresser à son héroïne, de Jane Campion à Fiona Kidman, en passant par quelques personnages fantasques qui partagent son obsession pour la criminelle. « Tous les aficionados de Minnie étaient-ils des timbrés ? Je ne m'excluais pas de cette liste de fous patentés. » L'enquête, littéraire, est aussi une exploration intime. Pourquoi une histoire s'empare-t-elle de nous ? C'est l'un des mystères explorés avec élégance par Amaury da Cunha, dans ce récit à l'éclat noir.
RCF Vaucluse, 27 février 2021
LH Le Mag, 28 janvier 2021
Aux antipodes
par Sean James Rose
Amaury da Cunha relate son périple en Nouvelle-Zélande sur les traces de la seule femme de l'île à avoir été condamnée à mort : Minnie Dean.
Son nom en Nouvelle-Zélande est associé à la figure du croquemitaine. « Tiens-toi bien, sinon tu auras affaire à Minnie Dean », menace-t-on les petits enfants pas sages. Accusée du meurtre d’un bébé, Minnie Dean a été pendue le 12 août 1895. Elle est la seule femme à avoir été condamnée à mort dans cette île d’Océanie tranquille, et dont on n’entend guère parler sous nos latitudes sauf à l’occasion d’un tremblement de terre ou d’un attentat. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi cette nature sublime auréolée d’un mystère inquiétant comme dans La leçon de piano de Jane Campion, film qu’avait vu Amaury da Cunha adolescent, avec sa grand-mère, et qui lui fit si forte impression.
Dans son nouveau livre, Baby Farmer, l’itinéraire géographique de l’écrivain se double d’un jeu de pistes dans le temps et les archives de cette affaire d’infanticide. Le titre qu’on pourrait traduire par « éleveuse de bébés » désigne ce métier, répandu à la fin du XIXe siècle, de mère de substitution contre rémunération – nounou mais en péjoratif, comme la Thénardier des Misérables. L’Écossaise Williamina, dite Minnie, mariée à un aubergiste néo-zélandais modeste, a adopté deux filles et « élève » une ribambelle de bambins, illégitimes et cachés. Ces bébés font pour ainsi dire bouillir la marmite. Minnie Dean vient d’accueillir un nouveau nourrisson, « bébé Carter », une fille de 10 mois, elle l’emmène avec elle dans le train qu’elle prend pour récupérer un autre enfant. Pour que les bébés ne pleurent pas, la baby farmer a une technique : un peu de laudanum dans le biberon. A-t-elle eu la main trop lourde ? Bébé Carter ne se réveille plus. On l’a retrouvée dans la boîte à chapeau de Minnie Dean. C’est l’effroi. Le procès pour meurtre s’ouvre, la presse se déchaîne. Le problème est que déjà nombre d’enfants dont Minnie Dean avait eu la charge sont morts accidentellement ou de maladie. Elle clamera son innocence jusqu’au bout mais nul ne la croira.
Amaury da Cunha, également photographe (au service photo du Monde), allie l’acuité d’une sensibilité visuelle à la curiosité de l’enquêteur existentiel. Ce périple en Nouvelle-Zélande est émaillé de rencontres avec des lieux, des gens, notamment l’artiste-peintre Janice Gill, qui a réalisé une série de tableaux sur Minnie Dean, et même avec un weta, gros grillon vernaculaire. [...] Étrangère, à double titre, parce que née ailleurs et femme, et parce qu’elle faisait pousser cette mauvaise graine d’enfants naturels, ces « bâtards » dont la bonne société victorienne ne pouvait souffrir l’existence.