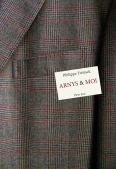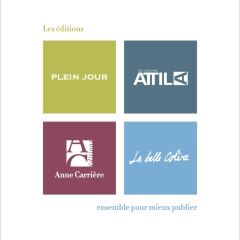Libération, 26 décembre 2019
"Arnys et moi", russes et costumes
par Claire Devarrieux
En parallèle de l'histoire de la très chic boutique de mode rive gauche, Philippe Trétiack évoque non sans humour sa saga familiale, autrement plus modeste et vouée à l'échec.
A voir l’image d’« une maison anglaise » et très française à la fois, usant du velours côtelé, du tweed et de la flanelle sans oublier les tissus italiens : Arnys, dédié au chic masculin, depuis 1933 à l’angle de la rue de Sèvres et de l’impasse Récamier, aura réussi cet exploit, avant que Berluti, du groupe LVMH, rachète la marque en 2012. Habiller les bourgeois de gauche, puiser dans le vestiaire populaire, c’était cela aussi, Arnys. Une palette esthétique et sociale évoluant avec le temps, que Philippe Trétiack analyse dans Arnys & moi.
Pourquoi « et moi » ? Parce que le récit met en parallèle deux trajectoires. La trajectoire montante est celle de la lignée de Jankel Grünberg, juif russe issu d’« une famille de lettrés ». Ses six frères ont émigré aux Etats-Unis, où ils ont fait fortune grâce à son aide. Jankel a choisi la France. Une chemiserie, puis cinq, son affaire fut reprise par ses fils, Léon et Albert, lui-même mourant à Auschwitz avec sa femme. Les fils de Léon, Michel et Jean Grimbert, héros malicieux et discrets du livre de Trétiack, ont à leur tour travaillé ensemble et fait d’Arnys le rendez-vous le plus smart de la rive gauche.
Pendant que Jankel exerçait son sens du commerce, les deux grands-pères de l’auteur, juifs « ukraino-russo-roumains » partant de plus bas, s’exilent en France, rive droite. Ils sont dans l’ébénisterie. Côté Trétiackov, on ouvre un magasin de confection pour dames. C’est le faubourg Saint-Antoine et non le faubourg Saint-Germain. [...]
Les trente costumes annuels de Pierre Bergé, l’alpaga noir de Claude Sautet : la saga d’Arnys est très people. La veste la plus célèbre, « la Forestière » (Serge Moati en a dix-neuf), confortable et doublée de jaune ou de rouge, a fait de François Fillon en 2000 un homme original, avant qu’il raccroche les gants en 2017 à cause de quelques costumes offerts. Ce n’était plus une audace mais une faute de goût.
Le Figaro, 6 décembre 2019
par Isabelle Spaak
L’histoire de la fameuse boutique de confection où défilait le tout Paris. boutique de confection où défilait le tout Paris.
À peine une page. Et quelques rappels par-ci par-là. En racontant la saga époustouflante de la boutique de confection Arnys, l’un des plus fins tailleurs pour hommes, fondé en 1933 à Paris, le journaliste et écrivain Philippe Trétiack balaye rapidement l’épisode des costumes sur mesure offerts à François Fillon par l'avocat Robert Bourgi. [...] D’ailleurs, à cette époque, Jean et Michel Grimbert, troisième génération à la tête d’Arnys et personnages balzaciens s’il en est, avaient cédé en 2012 leur prestigieuse affaire au groupe LVMH sous la bannière Berluti. Fin de la bourrasque Fillon.
Début du récit très émouvant au cours duquel Philippe Trétiack revisite le parcours de sa propre famille, issue de l'émigration juive d'Europe centrale comme celle des fondateurs d'Arnys. Quatre-vingt-dix ans d'histoire de France, ses hauts et ses bas vus à travers les salons d'un magasin au carrefour de la rue de Sèvres et du Bon Marché, face au Lutétia.
Une boutique où il n'a pourtant jamais mis les pieds. "Comme beaucoup, j'en observais les vitrines en m'interrogeant sur leur aspect bourgeois délicatement suranné, presque outrancier dans la mainmise et le contrôle de soi." Une sorte de "Jockey Club, sans credo auquel on adhérait en poussant la porte." Un "monde chabrolien", comme le décrivit l'écrivain Éric Reinhardt avant d'oser y pénétrer.
La quintessence du style français
Pour ceux qui fréquentent Arnys - et ils sont nombreux parmi les professeurs de médecine, politiques, acteurs, réalisateurs, psychanalystes, intellectuels, grands patrons, etc. -, la maison représente la quintessence du style français, voire du chic parisien, mâtiné d'une touche british.
Ancien journaliste au magazine ELLE, Philippe Trétiack n'a pas son pareil pour raconter les inspirations littéraires, les vêtements rappelant la panoplie militaire et ouvrière, telle la fameuse veste Forestière, dessinée à l'origine pour Le Corbusier, ou la Tonkin, vue dans le film de Jacques Becker Goupi Mains Rouges. Il raconte les doublures colorées inspirées des kimonos, les velours côtelés, les tissus italiens, le tomber, l'élégance en toutes circonstances (y compris avec quelques kilos en trop). Claude Moati, Pierre Bergé, qui se fait faire une poche poitrine assez profonde pour y glisser une flûte de champagne et dont les vestes courtes taille 52 s'arrachent désormais chez les fripiers, Claude et Jacques Lanzmann, les Brasseur père et fils, le sculpteur César, Philippe Noiret, Pierre Restany, François Pinault... Tous sont des habitués d'Arnys.
Mais il est une autre histoire de coupes et d'ourlets dans laquelle se plonge et nous plonge l'auteur. Celle de sa mère, la belle Pauline aux yeux revolver qui s'lchine et s'abîme de l'autre côté de la Seine, square Trousseau, dans un magasin de prêt-à-porter pour dames qu'elle déteste. Comme par un effet de miroir, les échecs réitérés de Pauline en regard de la flamboyante réussite d'Arnys raconté par son fils permettent enfin à celui-ci de redécouvrir le sourire d'une femme qu'il avait cru oublier et de se confronter à ses fragilités.
Le Canard enchaîné, 13 novembre 2019
Mesure et démesure
par Dominique Simonnot
En toute modestie, l'auteur a donné du "et moi" dans son titre, et "Le Canard" aurait aussi pu dire "Arnys et nous" ! Car la célèbre maison était un peu la sienne : François Fillon s'y habillait et s'y faisait offrir de beaux costumes. C'est même l'"affaire" qui a donné à Trétiack l'idée d'écrire ce livre sur l'épopée des frères Grimbert, Juifs russes, et de la comparer à celle de sa famille juive venue de Roumanie. Des vies extraordinaires, faites, hélas, d'exils, de déportations, de morts, mais aussi d'invraisemblable débrouillardise.
Les Grimbert et les Trétiack ont, en France, oeuvré dans le schmattès, le textile. Les premiers avaient le génie de la réussite, les seconds, celui du fiasco. Les Grimbert installent leur magasin rive gauche, à Paris, où, après avoir séduit des profs avec leurs vêtements "à l'anglaise", ils comptent bientôt parmi leurs clients des célébrités. Sous Mitterand, toute la "gauche caviar" y défile et achète à tour de bras cette horrible veste Forestière, encore adorée de beaucoup. La mère de Philippe Trétiack tient boutique près de Nation, chez Pauline, aux lettres calligraphiées façon Art nouveau, et y entasse ses mochetés achetées en gros dans le Sentier.
Un exemple donne la mesure du canyon qui les sépare. Il y avait chez Arnys, à l'étage, une pièce sacrée, réservée aux clients les plus prestigieux. Ornée de toiles historiques destinées à faire croire que la maison existait depuis des siècles... [...]
"Se pourrait-il, se demande l'auteur, que tout ceci n'ait été qu'une histoire juive ?" Sans aucun doute !
Le Point, 7 novembre 2019
Tiré à quatre épingles
par Laurence Caracalla
"La mode n'a de légèreté que sa réputation", écrit Philippe Trétiack. Aussi les costumes sur mesure d'Arnys étaient-ils déjà mythiques chez les intellectuels (Gide, Sartre) ou le monde politique, avant de faire la une de la presse avec veux de François Fillon pensant la présidentielle de 2017. Longtemps grand reporteur à Elle, l'auteur de L'architecture à toute vitesse, retrace avec la même énergie la saga de cette prestigieuse maison dans "Arnys et moi". Les frères Grimbert partirent de Ruisse pour inaugurer en 1933 leur boutique, aujourd'hui disparue, et connaître une réussite fulgurante. En parallèle, Trétiack, lui-même issu de cette émigration juive, raconte l'histoire de sa propre famille, qui tenta de percer dans la création vestimentaire, sans succès, et livre de drôles d'anecdotes sur les célèbres clients, de Roland Barthes à Omar Bongo. Cette construction à deux étages, entre les heures de gloire de ce Jockey Club de l'étoffe, cette "obédience sans credo à laquelle on adhérait en poussant une porte", offre une stimulante réflexion sur l'échec, le luxe, les mondanités et la réussite. Mais surtout une épopée sans faux plis.
L'Officiel, 28 octobre 2019
Pourquoi il faut lire "Arnys & Moi" de Philippe Trétiack
par Jean-François Guggenheim
Il faut le reconnaître, peu de gens, dans le grand public, avaient entendu parler d’Arnys, avant ce qu’il convient d’appeler ''l’affaire Fillon''.
[...] Arnys, l’aboutissement du périple d’une famille juive ayant fui l’Ukraine à la fin du XIXème siècle. Un grand-père œuvrant dans la chemise, deux fils élevés dans les meilleures écoles, dont l’un, suivant des études de médecine, mais qui, atteint d’une maladie, ne peut exercer son métier. Atavisme oblige, l’ex futur médecin et son frère ouvrent boutique à Saint-Germain-des-Prés. Le quartier se prête alors peu aux effets de mode. La mode est ailleurs, au-delà de la Seine, Rive droite.
Pourtant, talent aidant, peu à peu, les artistes de Montparnasse, les intellectuels du quartier Latin, les hommes politiques de tous bords, gens des médias et architectes, vont faire du lieu un club exclusif où l’on vient chercher cette mode aux goûts d’Angleterre et pourtant si française, ces tissus sélectionnés, choisis, coupés sur mesure, pour des résidences secondaires que l’on imagine être des châteaux ou quelques demeures patriarcales. Arnys devient mythique. S’y croisent les mandarins de l’école de médecine, Claude Sautet et Pierre Bergé, Orson Welles et Roland Barthes. La Forestière, veste si chic pour les séjours à la campagne y fait fureur. ''Arnys & Moi ?'' Mais qui est donc ce Moi ? Un Moi sans X, ni accablant ni accablé. Philippe Trétiack, écrivain, grand reporter trente ans durant au magazine Elle, est passé à maintes reprises devant l’échoppe de luxe, sans jamais en ouvrir la porte. Le scandale arrive et il s’intéresse à la chose, à l’histoire de ce lieu hors normes. A cette histoire fait écho la sienne. Lui aussi est issu d’une famille juive ukrainienne arrivée vers ce paradis qu’est la France à la fin du XIXème siècle. Chez lui aussi, on a donné dans la fringue. Son grand-père, sa mère. Un écho mineur. Face aux fastes d’Arnys situé à Saint-Germain-des-Prés, la boutique familiale du Faubourg Saint-Antoine semble bien minable. Les intellectuels du VIème arrondissement ne ressemblent guère aux prostituées du Sentier. C’est cette double sociologie, sur près d’un siècle d’histoire française, où la mode, fricote avec la nippe, que l’auteur nous raconte. Un livre savant, tendre, forcément fashion.
Télérama, 9 octobre 2019
par Nathalie Crom
Les costumes sur mesure offerts par l’avocat Robert Bourgi à François Fillon, et la tornade médiatique et politique qui s’ensuivit ont sérieusement malmené le beau souci de discrétion du gentlemen’s club que se voulait le tailleur Arnys, installé depuis les années 1930 à deux pas de Saint-Germain-des-Prés. Mais si l’idée est venue au journaliste et écrivain Philippe Trétiack de se pencher sur l’histoire de cette entreprise familiale — propriété de Philippe et Michel Grimbert, les petits-fils du fondateur, jusqu’à son rachat par le groupe LVMH en 2012 —, c’est aussi parce qu’il y a trouvé des échos à l’itinéraire de sa propre famille : « À l’échelle du siècle fracassé, l’histoire des Grimbert est presque un archétype. Du moins pour ceux qui comme moi se trouvent unis dans une même appartenance, une même généalogie de l’exil par procuration […]. Des grands-parents pauvres, sans terre, sans patrimoine et reclus dans des villages aux noms imprononçables, un jour polonais, le lendemain ukrainiens, le surlendemain russes ou de nouveau polonais… »
Comme Jankel Grünberg, le fondateur de la dynastie des Grimbert, les grands-parents ashkénazes de l’auteur sont arrivés en France à l’aube du xxe siècle, fuyant les pogroms. Et comme lui, c’est dans le commerce d’habillement qu’ils se sont lancés à Paris. Mais pas avec le même succès : alors que, sur la rive gauche, la chic boutique des Grimbert prospérait chaque décennie davantage, aimantant les élites tant intellectuelles qu’artistiques et politiques (de Roland Barthes à Orson Welles, de Claude Sautet à Pierre Bergé…) et devenant une authentique institution, dans celle des Trétiack, installée dans le populaire faubourg Saint-Antoine, Pauline, la mère de l’écrivain, ne vendit jamais que des chemisiers bon marché achetés chez les grossistes du Sentier et en conçut un désappointement durable. Cette implication généalogique et autobiographique enveloppe de mélancolie le récit enlevé, passionnant, fourmillant de détails et d’humour, dans lequel Philippe Trétiack retrace la saga de la maison Arnys, en sonde l’esprit et le génie — une certaine façon de sentir et d’accompagner les mutations de la société. [...]
RCJ, 7 octobre 2019
par Jonathan Siksou
France Inter, 7 octobre 2019
par Nicolas Demorand
« C'est un texte intime et sophistiqué, une scène de la vie parisienne, un petit bout d'histoire de France vu à travers la vitrine d'un tailleur. »
À écouter ici
Causeur.fr, 6 octobre 2019
Philippe Trétiack raconte Arnys, la marque préférée de François Fillon
par Thomas Morales
De Blum à Fillon, le tout-Paris s'est habillé au 14 rue de Sèvres de 1933 à 2012. Philippe Trétiack en retrace l'histoire dans Arnys & moi.
Plus qu’une maison de confection, un état d’esprit, peut-être le secret le mieux gardé des hommes élégants. La boutique Arnys fut pendant quatre-vingt ans l’antichambre du pouvoir « rose pâle », le salon où l’on cause des dernières nouveautés littéraires, le club de la presse des éditorialistes les plus médiatiques et le repaire campagnard des patrons du CAC 40. Face au Lutétia, à deux pas du Bon Marché dans cet ultra-protégé VIIème arrondissement, Arnys a exprimé un style très français, une forme de décontraction élaborée comme si le poids social pouvait être allégé par la couleur.
Trois générations impasse Récamier
Un snobisme intellectuel qui a emprunté au vestiaire ouvrier des tenues utilitaires pour les détourner de leur fonction première, un entre-deux qui hésite entre le chic et le confortable, tout en n’utilisant que des matières nobles. Philippe Trétiack, grand reporter, spécialiste de l’architecture vient d’écrire le meilleur livre de sociologie politique de l’année. Dans Arnys & moi, il raconte l’histoire de cette impasse Récamier sur trois générations, d’une mode masculine qui fit office de signe de reconnaissance sociale. De sésame aussi. On s’habillait chez Arnys comme on était compagnons de la Libération ou anciens des Brigades Internationales. Des connivences se nouaient dans les salons d’essayage autour d’une cravate ou d’un costume en alpaga. Une intimité de tissus.
Le goût pour un classicisme sobrement débridé et néanmoins la volonté de se distinguer sans outrager. Nous n’étions pas du côté des tailleurs italiens flamboyants, ni d’une anglomanie totalement assumée. Une troisième voie qui sied à merveille à cet antre de la social-démocratie. Comment ce coin de Saint-Germain-des-Prés est devenu le point cardinal des puissants ? Trétiack mêle à ce récit, son parcours familial et le destin des commerçants juifs de l’habillement au cours du XXème siècle. Ce supplément d’âme et de drôlerie donne à son texte une chair et une profondeur qui vont bien au-delà de la radiographie classique d’un magasin pour élites mondialisées. « Plus qu’un commerce, un monde à part, une école d’élégance et, mieux, un rare club masculin » écrit-il, pour souligner le caractère presque magique d’Arnys et la puissance de son aura sur les petits garçons.
Un clochard poète devant l'entrée
Il en fallait du courage pour ouvrir la porte de cette auguste bâtisse, elle en intimidait plus d’un. Souvenez-vous du clochard poète qui faisait les cent pas devant l’entrée, vendant sa prose au mépris des caprices de la météo ou, vers la fin de l’aventure commerçante, du break Mini « société » des patrons garé juste devant ! Vous pénétriez dans un monde hors des contingences matérielles, assez étrange, à la fois sobre par le mobilier et complètement fantasque au regard des couleurs improbables de certaines vestes. Les prix affichés pouvaient glacer l’atmosphère. C’est pourquoi le nuancier bigarré réchauffait les cartes Platinium. Il n’était pas rare d’y croiser un ponte de l’édition, un présentateur télé ou un ministre inamovible. Trétiack explique très bien qu’avant-guerre, l’emplacement n’avait rien de très prestigieux.
[...] Arnys attire d’abord une clientèle de professeurs de médecine, d’universitaires ou d’écrivains. Puis, au fil des Trente Glorieuses, sous la pression immobilière, la résidence secondaire devenant un nouvel acquis social et une liberté de mouvement voire de mœurs, les acheteurs s’éloignent d’une certaine rigueur vestimentaire. [...] La clientèle dorée sur tranches appréciait les coupes amples, l’originalité et la qualité des fournisseurs. Arnys enrichissait ses liasses d’échantillons tout en conservant des idées plutôt à « gôche ».
Jacques Laurent, Gabriel Matzneff, Claude Sautet...
Un progressisme de bon aloi ce qui n’empêcha pas les gens de droite de se vêtir chez eux, bien au contraire. Pour Fillon, l’expérience lui coûtera une présidentielle. Mais avant lui, Jacques Laurent, Gabriel Matzneff, Claude Sautet furent des habitués. De Daniel Cordier à Roger Tallon ou de Serge Moati à Pierre Bergé, Arnys a habillé tout ce qui comptait dans la capitale de personnalités en vue. En 1966, les frères Grimbert, Michel et Jean, reprennent l’affaire et lui donnent cette patine unique. Leur silhouette replète ou leur moustache conquérante ont marqué l’imaginaire de la rue de Sèvres. Et puis leur produit phare, la Forestière, veste iconique comme disent les magazines de mode, inspirée par Le Corbusier, maintes fois copiée mais jamais égalée est le marqueur d’une époque. D’une parenthèse enchantée où certains hommes de pouvoir n’avaient pas la démagogie de s’habiller en prêt-à-porter.
Grazia, 4 octobre 2019
Tailleur d'élite
par Bertrand Rocher
Dans "Arnys & moi", le journaliste Philippe Trétiack retrace l'histoire de l'enseigne Arnys, jadis plébiscitée par la jet-set Rive gauche.
De 1993 à 2012, Arnys était un secret si bien gardé que le passionné de mode que vous êtes n'y était jamais entré...
Cette adresse bourgeoise a été brutalement mise en lumière en 2017 lorsqu'on a appris que François Fillon s'y était fait offrir trois complets par un affairiste. Elle dessine pourtant une sociologie des élites françaises. Écrivains, politiques, promoteurs s'y sont succédé. Régler sa note chez Arnys (de 7'000 à 12'000 euros par costume) valait cotisation à un club huppé qui vous donne un statut social. Même Yves Saint Laurent était demandeur.
En quoi consistait le style Arnys ?
Le fondateurs étaient des juifs d'Ukraine. Leur génie a été de définir un style profondément français... alors qu'on les croyait anglais. Les Grimbert se sont inspirés de notre patrimoine pour dessiner et baptiser leurs vêtements. Leur veste forestière, conçue à la demande de Le Corbusier, vient ainsi du film de Jacques Becker, Goupi mains rouges (1943). Ce sont eux qui ont popularisé le style ouvriériste et provincial chic de l'intelligentsia. Un emblème ? Michel Piccoli dans Les Choses de la vie de Claude Sautet (1970).
Y a t-il une nostalgie Arnys ?
Oui, notamment chez les Asiatiques. Depuis que la marque est passée sous pavillon Berluti (LVMH), les classtiques Arnys sont très recherchés. Comme certains des soixante costumes que Pierre Bergé commandait annuellement. Arnys, c'était une qualité supérieure de tissu et de savoir-faire, mais aussi un cénacle masculin où l'on refaisait le monde. On n'y venait pas juste pour se faire tailler un costume d'exception. C'était une école d'élégance intemporelle.
L'Express, 28 septembre 2019
Arnys & moi
par Jérôme Dupuis
C’est la boutique qui a peut-être coûté la dernière présidentielle à François Fillon. Bienvenue chez Arnys, maison de vêtements masculins chics de la Rive gauche (absorbée par Berluti en
2012), ses costumes sur mesure à 5 000 euros, ses clients célèbres (Orson Welles, Romain Gary et même Yves Saint Laurent),
ses couleurs chatoyantes... Philippe Trétiack s’est livré à un exercice journalistico-littéraire original : la monographie d’un magasin. Car les costumes de tweed d’Arnys cachent la saga
familiale des Grimbert sur trois générations, depuis les confins de l’Ukraine, berceau de la famille, d’origine juive, jusqu’au 14, rue de Sèvres, face au Lutetia, adresse de la marque depuis 1933
(maintenant Berluti Sèvres). Arnys est plus qu’une boutique : un club pour hommes, un signe de distinction sociale, une franc-maçonnerie du tissu, où les élus se reconnaissent à un revers
discret ou à une doublure violette. On dit que c’est Le Corbusier qui, ayant besoin d’un vêtement ample et boutonné lui permettant de faire de grands gestes sur les chantiers, serait à l’origine
de la fameuse Forestière, cette veste à petit col et doublure de soie qui fit fureur chez les intellectuels (Barthes, Claude Lanzmann...). Pierre Bergé commandait 30 costumes par an, avec une
petite poche spécialeen hauteur pour y loger sa flûte de champagne lors des cocktails. Les frères Grimbert créèrent même un modèle en hommage au personnage de Tonkin dans le fabuleux film
Goupi Mains rouges, et Claude Sautet habilla nombre de ses cadres des Trente Glorieuses avec des costumes de la maison. La belle plume de Philippe Trétiack entrecroise cette saga
balzacienne avec des bribes de souvenirs personnels, sa famille ayant connu un destin étrangement parallèle à celui des Grimbert. Ajoutons enin que l’ouvrage arbore la couverture en tweed la plus
chic de cette rentrée littéraire.
Les Échos Week-end, 27 septembre 2019
Par Thierry Gandillot
Sans l’affaire Fillon, le grand public n’aurait jamais entendu parler d’Arnys, maison de couture fondée en 1933, sise au 14, rue de Sèvres, et fréquentée dans la plus grande discrétion par le
tout-Paris. Gide, Montherlant, Antoine Blondin, Jules Roy, Gabriel Matzneff, Jean-Claude Milner, Michel Polac, Serge Moati, François Pinault, Michel Winock, Pierre Bergé ou Yves Saint-Laurent ont
été ou sont clients. On y achetait des vêtements, d’abord, bien sûr, dont la célèbre veste Forestière, conçue pour Le Corbusier, devenue l’étendard du succès maison ; mais on discutait
beaucoup aussi chez les frères Grimbert. Parfois, il fallait déployer des trésors de diplomatie pour éviter qu’au sortir d’une cabine d’essayage François-Marie Banier ne croise l’avocat des
Bettencourt, Me Olivier Metzner ; ou que Gilles Pudlowski n’en vienne aux mains avec un restaurateur assassiné dans l’une de ses chroniques. Le livre de Philippe Trétiack, ancien grand
reporter à Elle, drôle et informé, fourmille d’anecdotes savoureuses. Mais surtout, il analyse avec finesse – un peu à la manière du Roland Barthes des Mythologies – comment
les Grimbert
ont bâti leur réputation et leur fortune, détaille les stratégies marketing, psychosociales voire éditoriales, qui leur ont permis de toujours rester dans l’air du temps. Mais Trétiack ne
s’arrête pas à Sèvres-Babylone, il nous emmène également rue du Faubourg Saint-Antoine dans le sillage de ses deux grands-pères juifs d’origine ukraino-russo-roumaine. Tandis
que la famille Grimbert grimpe quatre à quatre les barreaux de l’échelle sociale, le commerce des Trétiack fait du sur-place du côté de la Bastille. La maman, qui tient la boutique, n’a pas la
fibre commerçante. Qu’importe ! Arnys & moi fait revivre tout ce petit monde oublié avec élégance, humour et tendresse.
ELLE, 13 septembre 2019
Sur mesure
Propos recueillis par Marion Ruggieri
Dans "Arnys & moi", Philippe Trétiack, ancien journaliste à ELLE, noue l'histoire du célèbre tailleur de la rive gauche avec celle de sa famille. Du cousu main !
ELLE : Quand on dit "Arnys", on pense à l'affaire des costumes de l'affaire FIllon. C'est le point de départ du livre ?
Philippe Trétiack : Ce qui m'a intrigué, c'est qu'on n'ait jamais rien écrit sur cette marque de vêtements masculins mythiques, qui dessine, de 1933 à 2012, une sociologie des élites
françaises. On voit y arriver, par périodes, les professions qui montent : les mandarins de la médecine, les hommes politiques, les promoteurs, les banquiers, les gens des médias, les acteurs... Dans
un quartier de Paris emblématique, le Quarier latin. [...]
ELLE : À travers l'incroyable histoire de la famille Grimbert, fondatrice d'Arnys, vous dévoilez un peu celle de votre famille, elle aussi issue de l'immigration juive russe... et dans la confection !
Philippe Trétiack : Le vêtement, c'est ce qu'il y a de plus facile à emporter quand il faut fuir : c'est ce qu'on dit toujours et c'est vrai. Pareil pour le savoir... Ma mère avait une petite boutique de fringues qu'elle détestait, qui n'a rencontré ni gloire ni succès, mais elle lisait un livre par jour, comme les Grimbert qui étaient très littéraires. Ça permet, entre autres, de montrer que chez les Juifs il y en a qui réussissent et d'autres non - il n'y a pas que des riches !
ELLE : Avec Arnys, on traverse l'Occupation, les Trente Glorieuses et l'lpoque gauche caviar des années 1980...
Philippe Trétiack : Quand la France découvre la maison individuelle et ressemble à un film de Claude Sautetm Arnys se met à dessiner des vêtements pour cette bourgeoisie qui veut aller à la campagne - c'est Michel Piccoli dans "Les Choses de la vie", d'ailleurs habillé par Arnys. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une famille juive a tenté de concevoir un style français, en plongeant dans ce qui était le costume d'avant la Révolution. Comme le dit Balzac, "c'était la France de la soie avant qu'elle ne tombe dans le drap" - autrement dit les tissus venus d'Angleterre. Cette maison, qui a souvent été considérée comme anglaise, avait la volonté de créer un style français. Pour ma part, je n'ai jamais poussé la porte de la boutique, il me semblait que c'était un peu une mode de gros barbus...
ELLE : Puis Arnys a été racheté par Berluti...
Philippe Trétiack : Aujourd'hui, on est dans l'ère du meschandising internationalisé. L'emblématique veste Forestière a d'ailleurs été retaillée, plus étroite, dans des couleurs plus neutres, afin d'être vendue dans le monde entier - alors que Le Corbusier, qui l'avait fait créer pour lui, la voulait assez ample pour pouvoir lever les bras ! Heureusement, Berluti a gardé la "grande mesure", effectuée par les anciens tailleurs de chez Arnys, à l'étage de la boutique.
ELLE : Aujourd'hui, la marque est culte. Japonais et Coréens en sont fans. QUi a été le client le plus emblématique ?
Philippe Trétiack : Pierre Bergé, qui achetait 25 à 30 costumes par saison, soit 60 par an, entre 7'000 et 12'000 euros pièce. Il faisait tout réaliser en trois exemplaires. Dans les ventes, on reconnaît ses modèles à l'énoncé : "veste courte, taille 52, Franch Billionnaire". Par ailleurs, la poche de poitrine est suffisamment profonde pour y glisser une flûte de champagne. Toute une époque.
Livres Hebdo, 6 septembre 2019
Écrivain sur mesure
Par Sean James Rose
Reporter, critique d’architecture, écrivain... Philippe Trétiack, bourlingueur touche-à-tout, dévide la bobine d’une histoire de famille de tailleurs.
Tout commence avec les costumes de Fillon. Tiens, se dit-il, voilà un excellent sujet. Philippe Trétiack, journaliste-reporter, critique d’architecture et écrivain toujours à l’affût d’un angle original, a l’intuition que chez le tailleur de l’élite politique ont dû se croiser pas mal d’acteurs de l’histoire contemporaine. Sis à Saint-Germain-des-Prés, Arnys qui fournissait la garde-robe du malheureux candidat de la droite à la présidentielle a vu défiler les politiciens de tous bords. Une contre-histoire, côté vestiaire.
Philippe Trétiack en parle à son épouse, Elisabeth, de retour d’un dîner, et qui justement partageait la table de Michel Grimbert, propriétaire d’Arnys. Il se trouve qu’Elisabeth Trétiack est aussi l’attachée de presse de la maison d’édition Plein jour dirigée par Sibylle Grimbert, la fille de Michel... Small world. Un livre sur la boutique tenue par les frères Grimbert, Michel et Jean, et rachetée en 2012 par LVMH, est signé, mais ce qui paraît ces jours-ci n’est pas la seule saga de ces princes de l’habillement masculin. A leur histoire se mêle celle d’une autre boutique de vêtements. Dans Arnys et moi, Philippe Trétiack raconte aussi sa mère, cette brocanteuse dans l’âme et reine des puces, qui avait un magasin de nippes. Avec le livre resurgissent les souvenirs, sensations en boule dans les vieilles armoires d’une enfance à Paris, lorsqu’il accompagnait sa mère acheter du tissu dans le Sentier. Deux boutiques, deux histoires à l’opposé. Les Grimbert sont « des habillés », des tailleurs reconnus, épanouis dans leur art des ciseaux et de l’épingle, « nous, des “déshabillés”, les perdants d’un commerce qui n’avait jamais plu à ma mère », explique Philippe Trétiack. Pourtant les deux familles venaient peu ou prou du même endroit : des juifs de l’Est – Ukraine, Pologne, Russie, Roumanie – de cette Mitteleuropa, où l’on changeait moult fois de nationalité sans jamais bouger de chez soi, juifs qui reçurent « le malheur en héritage », et dont tant dans les familles ont péri dans les camps. De la judéité, il a gardé un certain sens de l’absurde – les misères de Job rachetées par l’autodérision de Woody Allen. « On se tire d’embarras sans se tirer d’affaire », sourit Philippe Trétiack.
Une inoxydable « jeunhomie »
C’est bien par le désarmorçage d’un réel où plane encore l’ombre menaçante de Moscou que Philippe Trétiack fait une entrée fracassante en librairie. Son premier livre est un guide pratique du collabo en cas d’invasion soviétique. A « Apostrophe », Bernard Pivot lit un extrait de Bienvenue à l’Armée rouge (JC Lattès, 1984), une phrase à savoir en russe : « C’est un coup monté, ce saucisson sec ne m’appartient pas. » Eclat de rire général. C’est le best-seller assuré.
[...] Architecte de formation, tombé dans le journalisme par hasard (après la visite d’une exposition sur le saxophone avec une amie journaliste à Télérama, il se voit confier un article, vu qu’il jouait de cet instrument), il s’intéresse toujours à la question urbanistique : Faut-il pendre les architectes ? (Seuil, 2001). Grand reporter à Elle, il rapporte pour le féminin des sujets comme « La mode chez les mollahs », qui lui valut le prix Louis-Hachette. Il avait publié une en- quête fort risquée sur la mafia, La vie blindée (Seuil, 1992). Philippe Trétiack ne tient pas en place. Car celui qui a vécu « l’exil par procuration » n’est-il pas toujours un peu afasat, comme disait sa mère en yiddish, « de traviole », « à côté ». Tenir en place ? Quelle place ? C’est nulle part. Ou tout l’espace.